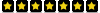Démarche de soins EHPAD AS
Modérateurs : Modérateurs, Aides-soignants
Démarche de soins EHPAD AS
Bonjour je voudrais votre avis sur ma démarche de soins, par contre nous n'utilisons pas les besoins de Virginia Henderson donc j'espère que certains pourront m'aider.
Identification :
Nom : T
Prénom : L
Date de naissance : 19/02/1932.
Âge : 83 ans.
Date et motif d’entrée, antécédents, traitement :
Date d’entrée : 02/12/2o14.
Motif d’entrée :
- Maladie d’Alzheimer.
Antécédents personnels :
Médicaux:
- Primo infection au Bacille de Koch.
- HTA
- Maladie d’Alzheimer
Chirurgicaux:
- Aucun.
Résumer du séjour :
Mme T à son entrée était beaucoup agitée et déambuler beaucoup, une fiche de crise à été mise en place afin de surveiller et de mettre en place des actions concernant son agitation. Depuis Mme T déambule moins mais à tendance à être plus irritable en fin de journée.
Traitement actuel :
- Anti Alzheimer.
- Antihypertenseur.
- Bêtabloquant.
- Anxiolytique.
- Neuroleptique atypique (antipsychotique).
- Antidépresseur.
- Hypolipémiant.
Portrait de la personne :
Physique :
Poids : 55Kg
Taille : 162 cm
IMC : 21
Psychologique : Anxieuse
Capacité : Incapacité partielle aux actes de la vie quotidienne.
Habitude de vie : Aucun régime alimentaire particulier, elle aime cuisiner, jouer au loto et se promener.
Environnement familial et/ou social :
Etat civil : Veuve depuis 20 ans.
Situation administrative (prise en charge social) : Mutuelle et CPAM
Personne de ressource : x
Personne de confiance : Son fils.
Situation professionnelle : retraité, ancienne couturière.
Famille : 1 fils, 1 petite fille et 1 petits fils.
Animaux : Pas d’animaux.
Entourage : Famille.
Visite : Pas souvent.
Devenir : Pas de changement d’établissement ou de retour à domicile prévu.
Démarche clinique et démarche de soins :
Signe: Maladie d’Alzheimer
- Affection neurodégénérative. Elle se caractérise par des troubles de la mémoire à court terme, des fonctions d’exécution et de l’orientation dans le temps et l’espace. La personne malade perd progressivement ses facultés cognitives et son autonomie. Provoquant une démence sénile.
Risques réels ou potentiels :
- Isolement
- Dépression
- Aphasie (trouble du langage)
- Apraxie (trouble du mouvement)
- Dysorthographie (trouble de l’écriture)
- Altération de l’état général (perte d’autonomie).
Réaction humaine :
- Incapacité partielle aux actes de la vie quotidienne.
- Anxieuse.
Signe : Hypertension Artérielle
- C’est l’élévation importante de la pression du sang dans les artères, elle persiste alors que le sujet est au repos.
Risque Réels ou potentiels :
- Hémorragique
- Infarctus du myocarde.
- AVC.
- Ischémique.
- Anévrisme.
- Athérome.
- Insuffisance rénale. -
Ensuite je retranscrit tout ça à l'écrit pour présenter à l'oral de cette façon :
Madame T est atteinte de la maladie d’Alzheimer, lié à l’âge et qui se manifeste par des troubles cognitifs et mnésiques ainsi qu’une désorientation spatio-temporelle, une altération des capacités d’encodage des informations, une anxiété et une capacité partielle aux actes de la vie quotidienne.
Les risques sont :
- Un risque d’isolement, de dépression, d’aphasie, d’apraxie ainsi que de dysorthographie et pour finir une altération de l’état général se traduisant par une perte totale de son autonomie.
Mes actions en lien avec ce problème de santé sont :
- Je rythme la journée de Mme T afin qu’elle ne soit pas perdue.
- Je l’accompagne dans les actes de la vie quotidienne telle que la toilette, le repas, les activités, le gouter et le coucher.
- Je stimule Mme T lors de la toilette afin de préserver son autonomie et favoriser l’estime d’elle-même en respectant ses habitudes de vies (crème anti ride, coiffures, lui faire choisir ses vêtements).
- Je l’incite à participer aux activités de la résidence et adapter au mieux l’activité à sa pathologie afin de développer ses capacités cognitives, motrices ou sensorielles.
- Je la rassure et la valorise lors de la toilette ou bien lors d’une activité.
Madame T a un problème d’hypertension artérielle qui est lié à l’âge et qui se manifeste par une somnolence et des confusions, une irritabilité en fin de journée.
Les risques sont:
- Il y a tout d’abord un risque hémorragique, un risque d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébrale, d’accident ischémique, d’anévrisme, d’athérome (favorise le risque d’apparition ou d’aggravation) ou encore d’insuffisance rénale.
-
Mes actions en lien avec ce problème de santé sont :
- M’assurer que Mme T ai bien dormi et lui proposer une sieste en début d’après-midi afin qu’elle puisse récupérer son sommeil.
- Vérifier que Mme T hydrate bien et l’inciter à boire quotidiennement.
- J’observe tout changement d’état clinique et préviens l’IDE s’il y en a.
- Je lui propose de l’aide pour la toilette et pour l’accompagner en salle à manger ou au salon afin qu’elle ne soit pas toute seule si malaise.
- Je rassure Mme T.
Identification :
Nom : T
Prénom : L
Date de naissance : 19/02/1932.
Âge : 83 ans.
Date et motif d’entrée, antécédents, traitement :
Date d’entrée : 02/12/2o14.
Motif d’entrée :
- Maladie d’Alzheimer.
Antécédents personnels :
Médicaux:
- Primo infection au Bacille de Koch.
- HTA
- Maladie d’Alzheimer
Chirurgicaux:
- Aucun.
Résumer du séjour :
Mme T à son entrée était beaucoup agitée et déambuler beaucoup, une fiche de crise à été mise en place afin de surveiller et de mettre en place des actions concernant son agitation. Depuis Mme T déambule moins mais à tendance à être plus irritable en fin de journée.
Traitement actuel :
- Anti Alzheimer.
- Antihypertenseur.
- Bêtabloquant.
- Anxiolytique.
- Neuroleptique atypique (antipsychotique).
- Antidépresseur.
- Hypolipémiant.
Portrait de la personne :
Physique :
Poids : 55Kg
Taille : 162 cm
IMC : 21
Psychologique : Anxieuse
Capacité : Incapacité partielle aux actes de la vie quotidienne.
Habitude de vie : Aucun régime alimentaire particulier, elle aime cuisiner, jouer au loto et se promener.
Environnement familial et/ou social :
Etat civil : Veuve depuis 20 ans.
Situation administrative (prise en charge social) : Mutuelle et CPAM
Personne de ressource : x
Personne de confiance : Son fils.
Situation professionnelle : retraité, ancienne couturière.
Famille : 1 fils, 1 petite fille et 1 petits fils.
Animaux : Pas d’animaux.
Entourage : Famille.
Visite : Pas souvent.
Devenir : Pas de changement d’établissement ou de retour à domicile prévu.
Démarche clinique et démarche de soins :
Signe: Maladie d’Alzheimer
- Affection neurodégénérative. Elle se caractérise par des troubles de la mémoire à court terme, des fonctions d’exécution et de l’orientation dans le temps et l’espace. La personne malade perd progressivement ses facultés cognitives et son autonomie. Provoquant une démence sénile.
Risques réels ou potentiels :
- Isolement
- Dépression
- Aphasie (trouble du langage)
- Apraxie (trouble du mouvement)
- Dysorthographie (trouble de l’écriture)
- Altération de l’état général (perte d’autonomie).
Réaction humaine :
- Incapacité partielle aux actes de la vie quotidienne.
- Anxieuse.
Signe : Hypertension Artérielle
- C’est l’élévation importante de la pression du sang dans les artères, elle persiste alors que le sujet est au repos.
Risque Réels ou potentiels :
- Hémorragique
- Infarctus du myocarde.
- AVC.
- Ischémique.
- Anévrisme.
- Athérome.
- Insuffisance rénale. -
Ensuite je retranscrit tout ça à l'écrit pour présenter à l'oral de cette façon :
Madame T est atteinte de la maladie d’Alzheimer, lié à l’âge et qui se manifeste par des troubles cognitifs et mnésiques ainsi qu’une désorientation spatio-temporelle, une altération des capacités d’encodage des informations, une anxiété et une capacité partielle aux actes de la vie quotidienne.
Les risques sont :
- Un risque d’isolement, de dépression, d’aphasie, d’apraxie ainsi que de dysorthographie et pour finir une altération de l’état général se traduisant par une perte totale de son autonomie.
Mes actions en lien avec ce problème de santé sont :
- Je rythme la journée de Mme T afin qu’elle ne soit pas perdue.
- Je l’accompagne dans les actes de la vie quotidienne telle que la toilette, le repas, les activités, le gouter et le coucher.
- Je stimule Mme T lors de la toilette afin de préserver son autonomie et favoriser l’estime d’elle-même en respectant ses habitudes de vies (crème anti ride, coiffures, lui faire choisir ses vêtements).
- Je l’incite à participer aux activités de la résidence et adapter au mieux l’activité à sa pathologie afin de développer ses capacités cognitives, motrices ou sensorielles.
- Je la rassure et la valorise lors de la toilette ou bien lors d’une activité.
Madame T a un problème d’hypertension artérielle qui est lié à l’âge et qui se manifeste par une somnolence et des confusions, une irritabilité en fin de journée.
Les risques sont:
- Il y a tout d’abord un risque hémorragique, un risque d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébrale, d’accident ischémique, d’anévrisme, d’athérome (favorise le risque d’apparition ou d’aggravation) ou encore d’insuffisance rénale.
-
Mes actions en lien avec ce problème de santé sont :
- M’assurer que Mme T ai bien dormi et lui proposer une sieste en début d’après-midi afin qu’elle puisse récupérer son sommeil.
- Vérifier que Mme T hydrate bien et l’inciter à boire quotidiennement.
- J’observe tout changement d’état clinique et préviens l’IDE s’il y en a.
- Je lui propose de l’aide pour la toilette et pour l’accompagner en salle à manger ou au salon afin qu’elle ne soit pas toute seule si malaise.
- Je rassure Mme T.
Re: Démarche de soins EHPAD AS
Manque de parler du travail en collaboration ave ide ,des transmissions écrites ....mais rien ne t empeche de presenter la demarche de soins selon les besoins de virginia henserson ? je me trompe ?
Re: Démarche de soins EHPAD AS
Oui les transmissions j'attend lundi pour tout prendre ainsi que ses constantes et tout ça mais le travail avec IDE il y en as pas tellement.. 
Re: Démarche de soins EHPAD AS
tu vas sur legifrance code sante publique et tu imprimes R.4311-4 et R 4311-5
Re: Démarche de soins EHPAD AS
que veux tu dire par Alzeihmer et hypertension liés à l'âge?
Re: Démarche de soins EHPAD AS
la maladie d alzheimer n est pas etudiée chez eleves as eas comme chez esi " maladie neurologique representant la cause la plus fréquente des demences chez la personne agée;;;
profitons ici pour nous rappeler d une définition de l oms sur la demense
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/fr/
et
Pour l’O.M.S., c’est une altération progressive de la mémoire suffisamment marquée pour handicaper les activités de la vie de tous les jours. Apparue au moins depuis six mois et associée à un trouble d’au moins l’une des fonctions suivantes : le calcul, le langage, le jugement, l’altération de la pensée abstraite, les praxies (lorsque la personne ne peut plus faire
les gestes), la gnosie (les personnes ne sont pas conscientes de leurs troubles) et puis les modifications de la personnalité.
profitons ici pour nous rappeler d une définition de l oms sur la demense
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/fr/
et
Pour l’O.M.S., c’est une altération progressive de la mémoire suffisamment marquée pour handicaper les activités de la vie de tous les jours. Apparue au moins depuis six mois et associée à un trouble d’au moins l’une des fonctions suivantes : le calcul, le langage, le jugement, l’altération de la pensée abstraite, les praxies (lorsque la personne ne peut plus faire
les gestes), la gnosie (les personnes ne sont pas conscientes de leurs troubles) et puis les modifications de la personnalité.
Re: Démarche de soins EHPAD AS
concernant l hta du a l age elle n'a pas tort
L’hypertension artérielle chez le sujet âgé
L’hypertension artérielle (HTA), maladie la plus fréquente du sujet âgé, concerne près de la moitié des personnes de plus de 65 ans. Cette augmentation de la tension artérielle avec l’âge porte principalement sur la pression artérielle systolique. En revanche, la pression artérielle diastolique semble se stabiliser vers l’âge de 60 à 65 ans. L’HTA est le principal facteur de risque cardio-vasculaire chez le sujet âgé. Cette pathologie est en effet une cause importante de morbidité et de mortalité. Un traitement anti-hypertenseur bien adapté, ainsi qu’une hygiène de vie et une nutrition appropriée, permettent aujourd’hui de réduire considérablement le risque de survenue de complications.
QU’EST-CE QUE L’HYPERTENSION ARTERIELLE ?
L’HTA se définit, selon les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, comme une pression artérielle systolique (PAS) supérieure à 140 mmHg et/ou une pression diastolique (PAD) supérieure à 90 mmHg. Selon les chiffres recueillis, on peut classer l’HTA en trois classes : légère, modérée et sévère. L’association de l’HTA à d’autres facteurs de risque cardio-vasculaires éventuels comme le tabagisme ou l’hypercholestérolémie, permet de quantifier le risque de voir se développer un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde dans les dix années à suivre.
PHYSIOPATHOLOGIE DU VIEILLISSEMENT ARTERIEL
Plusieurs modifications du système vasculaire sont observées avec l’âge. On constate une altération et une diminution relative des fibres élastiques remplacées par du collagène au sein de la paroi des artères. Cette évolution est à l’origine d’une plus grande rigidité des artères. D’autres modifications sont également observées comme un épaississement de la paroi artérielle, une augmentation du diamètre des artères de gros calibre et une altération de la fonction d’amortissement. Ces dernières contribuent à l’élévation de la pression artérielle systolique et à une diminution de la pression artérielle diastolique. La pression pulsée reflète alors le degré de rigidité des gros troncs artériels.
LES DIFFERENTES CAUSES D’HTA
L’HTA essentielle, c’est à dire sans étiologie précise, est la cause la plus fréquente et représente près de 90% des HTA du sujet âgé. Elle s’associe à des facteurs prédisposants comme la surcharge pondérale, la consommation excessive de sel ou d’alcool, voire un syndrome d’apnées du sommeil.
Les HTA secondaires, sont d’étiologie rénale lors d’une insuffisance rénale chronique ou d’une cause réno-vasculaire (sténose des artères rénales). Elles peuvent aussi être endocriniennes et notamment surrénalienne (phéochromocytome, hyperaldostéronisme primaire), ou iatrogènes.
LES COMPLICATIONS LIEES A L’HTA
L’atteinte cardiaque se traduit initialement par une altération de la fonction diastolique, puis, à un stade plus tardif, de la fonction systolique. On observe également une hypertrophie du ventricule gauche avec risque d’œdème aigu du poumon, d’infarctus du myocarde et de passage plus fréquent en troubles du rythme cardiaque. La dilatation progressive de l’oreillette gauche augmentant le risque de fibrillation auriculaire fait également partie des complications cardiaques potentielles de l’HTA.
L’atteinte cérébrale se traduit par la survenue d’accidents vasculaires ischémiques ou hémorragiques, de lacunes, voire de démence.
L’atteinte rénale est une néphropathie vasculaire associée à une insuffisance rénale.
http://www.saging.com/mise_au_point/lhy ... -sujet-age
L’hypertension artérielle chez le sujet âgé
L’hypertension artérielle (HTA), maladie la plus fréquente du sujet âgé, concerne près de la moitié des personnes de plus de 65 ans. Cette augmentation de la tension artérielle avec l’âge porte principalement sur la pression artérielle systolique. En revanche, la pression artérielle diastolique semble se stabiliser vers l’âge de 60 à 65 ans. L’HTA est le principal facteur de risque cardio-vasculaire chez le sujet âgé. Cette pathologie est en effet une cause importante de morbidité et de mortalité. Un traitement anti-hypertenseur bien adapté, ainsi qu’une hygiène de vie et une nutrition appropriée, permettent aujourd’hui de réduire considérablement le risque de survenue de complications.
QU’EST-CE QUE L’HYPERTENSION ARTERIELLE ?
L’HTA se définit, selon les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, comme une pression artérielle systolique (PAS) supérieure à 140 mmHg et/ou une pression diastolique (PAD) supérieure à 90 mmHg. Selon les chiffres recueillis, on peut classer l’HTA en trois classes : légère, modérée et sévère. L’association de l’HTA à d’autres facteurs de risque cardio-vasculaires éventuels comme le tabagisme ou l’hypercholestérolémie, permet de quantifier le risque de voir se développer un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde dans les dix années à suivre.
PHYSIOPATHOLOGIE DU VIEILLISSEMENT ARTERIEL
Plusieurs modifications du système vasculaire sont observées avec l’âge. On constate une altération et une diminution relative des fibres élastiques remplacées par du collagène au sein de la paroi des artères. Cette évolution est à l’origine d’une plus grande rigidité des artères. D’autres modifications sont également observées comme un épaississement de la paroi artérielle, une augmentation du diamètre des artères de gros calibre et une altération de la fonction d’amortissement. Ces dernières contribuent à l’élévation de la pression artérielle systolique et à une diminution de la pression artérielle diastolique. La pression pulsée reflète alors le degré de rigidité des gros troncs artériels.
LES DIFFERENTES CAUSES D’HTA
L’HTA essentielle, c’est à dire sans étiologie précise, est la cause la plus fréquente et représente près de 90% des HTA du sujet âgé. Elle s’associe à des facteurs prédisposants comme la surcharge pondérale, la consommation excessive de sel ou d’alcool, voire un syndrome d’apnées du sommeil.
Les HTA secondaires, sont d’étiologie rénale lors d’une insuffisance rénale chronique ou d’une cause réno-vasculaire (sténose des artères rénales). Elles peuvent aussi être endocriniennes et notamment surrénalienne (phéochromocytome, hyperaldostéronisme primaire), ou iatrogènes.
LES COMPLICATIONS LIEES A L’HTA
L’atteinte cardiaque se traduit initialement par une altération de la fonction diastolique, puis, à un stade plus tardif, de la fonction systolique. On observe également une hypertrophie du ventricule gauche avec risque d’œdème aigu du poumon, d’infarctus du myocarde et de passage plus fréquent en troubles du rythme cardiaque. La dilatation progressive de l’oreillette gauche augmentant le risque de fibrillation auriculaire fait également partie des complications cardiaques potentielles de l’HTA.
L’atteinte cérébrale se traduit par la survenue d’accidents vasculaires ischémiques ou hémorragiques, de lacunes, voire de démence.
L’atteinte rénale est une néphropathie vasculaire associée à une insuffisance rénale.
http://www.saging.com/mise_au_point/lhy ... -sujet-age
Re: Démarche de soins
Bonjours, je me permet de vous écrire, afin de vous posez quelques questions.
J'aurais voulu savoir, quelles sont les conséquences de la démence sénile* ? Et les préventions primaires et secondaires de cette pathologie ? (DS*)
Merci d'avance pour vos réponses à mes questions !
En espérant des réponses assez tôt afin que je puisse terminer mon rapport de stage de classe de seconde Bac Pro ASSP,lors d'un stage effectuer en EHPAD.
Bon après midi a vous !
J'aurais voulu savoir, quelles sont les conséquences de la démence sénile* ? Et les préventions primaires et secondaires de cette pathologie ? (DS*)
Merci d'avance pour vos réponses à mes questions !
En espérant des réponses assez tôt afin que je puisse terminer mon rapport de stage de classe de seconde Bac Pro ASSP,lors d'un stage effectuer en EHPAD.
Bon après midi a vous !
Re: Démarche de soins EHPAD AS
Existe t il une prévention de la vieillesse ?????? En unité de vie alzheimer et demenses apparentees il y a aussi bien des ex médecins, ex chirurgiens, avocats, ouvriers, sdf.... S il y a une prévention à la démence, au vieillissement naturel du corps et de l esprit je suis prenante
Un site conseillé OMS
Y
Un site conseillé OMS
Y