Stage Maternité , vos questions
Modérateurs : Modérateurs, ESI
-
Bec
Re: mater gynéco
misseringuette a écrit :coucou, est ce que quel q'un pourrait m'expliquer l'effet feed back en mater gynéco svp!
merci d'avance a tous ceux qui me répondrons
Je viens de finir le module, mais je n'ai pas la moindre idée de quoi tu parles! Au moins que tu parles du cycle hormonal de la femme???
Bec
- misseringuette
- Messages : 23
- Inscription : 27 nov. 2005 19:17
-
Bec
Les hormones sexuels sont principalement produites par nos gonades (ovaires dans le cas de la femme), sur ordre de l'hypothalamus et de l'hypophyse qui sont pour ainsi dire les chefs d'orchestre des glandes de notre corps.
L'hypothalamus, situé dans le cerveau, produit une hormone la GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) qui indique à l'hypophyse qu'elle doit produire deux hormones, la FSH (Hormone Folliculo-Stimulante) et la LH (Hormone Lutéinique).
La FSH et la LH vont ordonner aux ovaires de fabriquer de l'oestradiol ou progestérone qui vont intervenir dans la maturation folleculaire, la préparation de l'endomètre et la production de glaire cervical qui va faciliter la montée des spermatozoides.
La présence dans le sang en quantité suffisante des hormones ainsi produites est un signal qui indique à l'hypothalamus et à l'hypophyse qu'ils peuvent arrêter de produire la GnRH, la FSH et la LH. Le niveau d'hormones est ainsi régulé par ce que l'on appelle une rétroaction (ou un feedback) négative.
A la fin du cycle, s'il n'y a pas de fécondation, les taux des hormones sexuels dans le sang vont chuté, qui vont indiquer au couple hypophysaire/hypothalamus de se remettre à produire du GnRH et du FSH/LH
Voilà
(infos synthétisé du site http://www.sts67.org/fra_details_endo_steroides.htm)
Bec
L'hypothalamus, situé dans le cerveau, produit une hormone la GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) qui indique à l'hypophyse qu'elle doit produire deux hormones, la FSH (Hormone Folliculo-Stimulante) et la LH (Hormone Lutéinique).
La FSH et la LH vont ordonner aux ovaires de fabriquer de l'oestradiol ou progestérone qui vont intervenir dans la maturation folleculaire, la préparation de l'endomètre et la production de glaire cervical qui va faciliter la montée des spermatozoides.
La présence dans le sang en quantité suffisante des hormones ainsi produites est un signal qui indique à l'hypothalamus et à l'hypophyse qu'ils peuvent arrêter de produire la GnRH, la FSH et la LH. Le niveau d'hormones est ainsi régulé par ce que l'on appelle une rétroaction (ou un feedback) négative.
A la fin du cycle, s'il n'y a pas de fécondation, les taux des hormones sexuels dans le sang vont chuté, qui vont indiquer au couple hypophysaire/hypothalamus de se remettre à produire du GnRH et du FSH/LH
Voilà
(infos synthétisé du site http://www.sts67.org/fra_details_endo_steroides.htm)
Bec
Dernière modification par Bec le 05 févr. 2006 17:16, modifié 2 fois.
- misseringuette
- Messages : 23
- Inscription : 27 nov. 2005 19:17
- Loupiac
- Gold VIP

- Messages : 5587
- Inscription : 02 juin 2004 09:06
- Localisation : En mode reconversion
Sur un autre forum, Loupiac a écrit :Nous sommes de véritables machines à Hormones. Qu'une seule soit défaillante et tout est plus délicat!
Gonadolibérine. Syn. (angl.) Gn-RH (gonadotropin-releasing hormone), Gn-RF (gonadotropin-releasing factor), LH-RH (luteinizing hormone-releasing hormone), LH-RF (luteinizing hormone-releasing factor). Décapeptide synthétisé par l’hypothalamus, agissant sur l’hypophyse pour la synthèse et la libération des gonadotrophines.
Gonadotrophine (du gr. gône "semence", -trophe et suff. ine). Syn. gonadostimuline, hormone gonadotrope. Terme générique désignant un groupe d’hormones protéiques dotées d’une activité stimulante sur les glandes génitales (ovaires ou testicules). On distingue deux grands groupes: les gonadotrophines hypophysaires (FSH, LH et prolactine), et la gonadotrophine chorionique.
FSH (angl., abrév. pour follicle stimulating hormone). Syn. hormone folliculostimulante, follitropine. Hormone glycoprotéique de poids moléculaire de 31 000 daltons, sécrétée par les cellules gonadotropes de l’antéhypophyse. La FSH est, comme la TSH, la LH et l’hCG, constituée de deux chaînes polypeptidiques alpha et bêta. La chaîne alpha est commune aux quatre hormones, alors que la chaîne bêta confère à chacune d’elles sa spécificité biologique et immunologique. La sécrétion de FSH est permanente chez l’homme, cyclique chez la femme, mais présente durant les deux phases folliculaire et lutéale du cycle menstruel; elle stimule la maturation et le fonctionnement des cellules de Sertoli et granulosa. La sécrétion de FSH est stimulée par la gonadolibérine, modulée par les stéroïdes sexuels, déprimée par l’inhibine.
LH (angl., abrév. pour luteinizing hormone). Syn. hormone lutéinisante, ICSH (interstitial cell stimulating hormone), lutropine. Hormone glycoprotéique de poids moléculaire de 29 000 daltons, sécrétée par les cellules gonadotropes de l’antéhypophyse. La sécrétion de LH est permanente chez l’homme, cyclique chez la femme, avec une augmentation en fin de phase folliculaire, un pic préovulatoire puis une décroissance en phase lutéale. La LH agit sur de nombreuses cellules gonadiques, en favorisant la synthèse des stéroïdes sexuels; chez la femme elle intervient de façon privilégiée dans l’ovulation. La sécrétion de LH est stimulée par la gonadolibérine, et modulée par les stéroïdes sexuels.
Prolactine (de pro-, et lat. lactus "lait"). Syn. hormone galactogène, hormone lactogénique, hormone lutéotrope, lactostimuline, PRL. Hormone polypeptidique, de poids moléculaire de 22 000 daltons, sécrétée par l’antéhypophyse.Son action principale est représentée par le développement et le maintien de la lactogenèse, mais elle possède en outre de très nombreuses actions sur la reproduction, la croissance, la balance hydro-électrolytique, etc. Nombre de ces actions font intervenir une synergie avec les stéroïdes sexuels au niveau des organes cibles. La régulation de sa sécrétion fait intervenir des facteurs hypothalamiques et gonadiques de stimulation (TRH, œstrogènes) et de nombreuses amines cérébrales. Parmi celles-ci, la dopamine exerce un effet puissamment frénateur. Une hyperprolactinémie peut entraîner chez la femme une galactorrhée et des troubles gonadiques (aménorrhée, anovulation ou une insuffisance lutéale), et chez l’homme des troubles sexuels et de la fécondité aboutissant à un tableau général d’hypogonadisme.
Stéroïdes hormonaux. Syn. hormones stéroïdes. Groupe de substances hormonales dérivées des stérols, qui sont formées à partir du cholestérol, et isolées à partir de glandes endocrines (corticosurrénale, ovaire, testicule, placenta). Les substances stéroïdes possèdent un noyau cyclo-pentano-phénanthrénique comportant trois cycles hexagonaux A, B, C et un cycle pentagonal D. On classe les stéroïdes hormonaux en trois groupes, suivant la constitution de leur squelette carboné en: dérivées de l’estrane à 18 atomes avec généralement une fonction phénolique en 3, appelés phénolstéroïdes et qui correspondent aux œstrogènes naturels; dérivés de l’androstane à 19 atomes de carbone, qui correspondent aux androgènes; dérivés du pregnane à 21 atomes de carbone, qui correspondent aux glucocorticoïdes, aux minéralocorticoïdes et à la progestérone.
Œstrogènes (de œstrus, et -gène). Syn. estrogènes. Groupe de stéroïdes hormonaux possédant un squelette carboné à 18 atomes de carbone et un cycle A aromatique porteur d’une fonction phénolique en 3. Les œstrogènes naturels sont synthétisés chez la femme dans les follicules ovariens, dans le corps jaune et dans le placenta au cours de la grossesse, chez l’homme dans les testicules. Cette synthèse s’effectue à partir des androgènes grâce à une 19-hydroxylase, puis grâce à un système enzymatique permettant l’aromatisation du noyau A. L’action physiologique des œstrogènes s’exerce sur les voies génitales et sur les caractères sexuels féminins à la puberté. Ils possèdent en outre une action sur les métabolismes hydroélectrolytique, protéique et lipidique.
Inhibine B (Mc Cullagh, 1932). Protéine hydrosoluble, non stéroïde, d’origine gonadique, sécrétée dans le testicule par les cellules de Sertoli et dans l’ovaire par celles de la granulosa: cette sécrétion est stimulée par la FSH. Par rétrocontrôle, l’inhibine freine dans l’hypophyse la production de FSH.
Progestérone (de pro-, lat. gestare "porter", et suff. d’hormone). Hormone du groupe stéroïde constituée par un noyau prégnane à 21 atomes de carbone. Hormone provenant principalement du corps jaune de l’ovaire. Elle est produite également par le placenta et, en faible quantité, par le testicule et la corticosurrénale.
2 enfants en pleine forme
A nouveau infirmière, mais où ? Telle est la question
Coucou toi, ça va ? Woooohoooo Ma signature fait 4 lignes.
A nouveau infirmière, mais où ? Telle est la question
Coucou toi, ça va ? Woooohoooo Ma signature fait 4 lignes.
Accouchement et sonde urinaire
Bonsoir à tous!
Je suis en train de relire mon cours sur les soins IDE en maternité et je lis qu'après l'accouchemt une sonde urinaire est placé car la patiente a eu une anesthésie.
Mais une sonde urinaire est mise a chaque fois qu'une femme accouche ou que dans certain cas??Je suis perdue je sais pas si j'ai mal compris mon cours ou si je l'ai mal retranscri ou peut être qu'il y a pose a chaque accouchemt s'une SU.
Aidez moi svp je fais mes fiches et je veux pas écrire des bétises!!
Merci à vous et bonne soirée moi la mienne est déjà rempli par la réalisation mes fiches!!

Je suis en train de relire mon cours sur les soins IDE en maternité et je lis qu'après l'accouchemt une sonde urinaire est placé car la patiente a eu une anesthésie.
Mais une sonde urinaire est mise a chaque fois qu'une femme accouche ou que dans certain cas??Je suis perdue je sais pas si j'ai mal compris mon cours ou si je l'ai mal retranscri ou peut être qu'il y a pose a chaque accouchemt s'une SU.
Aidez moi svp je fais mes fiches et je veux pas écrire des bétises!!
Merci à vous et bonne soirée moi la mienne est déjà rempli par la réalisation mes fiches!!

IDE depuis le 1/12/2008 yeeeeaaaaaaaaaahhhhhhh!!
Le mode opératoire peut varier selon les équipes.
Avec une péridurale (ALR = anesthésie loco régionale), certaines équipes posent une sonde à demeure, mais le plus souvent, il est rélisé des sondages évacuateurs à intervalle réguliers, avec vérification de retour de diurèse à la levée de l'ALR. Le globe vésical est en effet la complication la plus fréquente de ce type d'anesthésie.
Lors d'une césarienne, une sonde à demeure est posée, pour des raisons de technique opératoire.
Il est possible qu'une femme qui supporte mal la péridurale lors de la césarienne finisse sous anesthésie générale. C'est aussi le cas des césariennes en urgence, ainsi que des césariennes avec contre indication de péri.
Pour un accouchement par voie basse, il est rare de faire des anesthésies générales, hormis s'il n'y a pas de péri, et qu'il faille faire un forceps ou une révision utérine.
Il est aussi possible d'utiliser le protoxyde d'azote (Kalinox, Meopea) mais là, pas question de sondage vésical !
Avec une péridurale (ALR = anesthésie loco régionale), certaines équipes posent une sonde à demeure, mais le plus souvent, il est rélisé des sondages évacuateurs à intervalle réguliers, avec vérification de retour de diurèse à la levée de l'ALR. Le globe vésical est en effet la complication la plus fréquente de ce type d'anesthésie.
Lors d'une césarienne, une sonde à demeure est posée, pour des raisons de technique opératoire.
Il est possible qu'une femme qui supporte mal la péridurale lors de la césarienne finisse sous anesthésie générale. C'est aussi le cas des césariennes en urgence, ainsi que des césariennes avec contre indication de péri.
Pour un accouchement par voie basse, il est rare de faire des anesthésies générales, hormis s'il n'y a pas de péri, et qu'il faille faire un forceps ou une révision utérine.
Il est aussi possible d'utiliser le protoxyde d'azote (Kalinox, Meopea) mais là, pas question de sondage vésical !
VB - IDE
- Kenny
- Star VIP
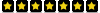
- Messages : 7689
- Inscription : 06 nov. 2003 18:18
- Localisation : sur les genoux de Nours
- Contact :
euhhh moi chaque accouchement que j'ai vu que ce soit avec ou sans ALR!! on a toujours fait un sondage évacuatueur ou poser une SV suivant les lieux!!! tout simplement pour vider la vessieavant l'accouchement afin qu'il n'y ait pas de soucis durant ce fameux accouchement!!! paraitrait qu'il y a des risques "d'éclatement "de vessie si celle ci est pleine durant l'accouchement!!! enfin ce sont les raisons qui m'ont été données
Membre du CODI: le Contre Ordre Des Infirmiers, venez nous rejoindre sur notre forum...
lors de mes accouchements c'est ce qu'il m'a été dit : une vessie pleine peut d'une part géner la descente du bébé, et d'autre part peut se déchirer à cause de la pression exercée par le passage du bébé.
Sur une voie basse sans péri c'est un va et vient juste avant la poussée, sur une césa avec peri ou AG c'est à demeure, le temps que la maman recouvre ses sensations de besoin d'uriner
Sur une voie basse sans péri c'est un va et vient juste avant la poussée, sur une césa avec peri ou AG c'est à demeure, le temps que la maman recouvre ses sensations de besoin d'uriner
Dernière modification par Vanice le 19 févr. 2006 11:03, modifié 1 fois.
On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui -P.Desproges
CLASS- Centre de Lutte Anti SMS : the fight goes on
CLASS- Centre de Lutte Anti SMS : the fight goes on
Quand je travaillais en salle de naissances, nous faisions des sondages évacuateurs avant l'accouchement et après dès lors qu'une péridurale était posée.
En cas de césarienne, comme l'a très bien dit V.Benet, une sonde à demeure était posée.
Pour les femmes qui accouchaient sans péri, elles urinaient toutes seules.
Je confirme ce que dit Vanice, il est impportant de vider fréquemment la vessie (permettre la descente du bébé et éviter les traumatismes)
C'est pour cela que dès que la femme est installée (position gynéco) le sondage évacuateur est le 1er geste effectué avant de la faire pousser.
En cas de césarienne, comme l'a très bien dit V.Benet, une sonde à demeure était posée.
Pour les femmes qui accouchaient sans péri, elles urinaient toutes seules.
Je confirme ce que dit Vanice, il est impportant de vider fréquemment la vessie (permettre la descente du bébé et éviter les traumatismes)
Kenny a écrit : paraitrait qu'il y a des risques "d'éclatement "de vessie si celle ci est pleine durant l'accouchement!!!
C'est pour cela que dès que la femme est installée (position gynéco) le sondage évacuateur est le 1er geste effectué avant de la faire pousser.
Chez nous, c'est pareil...
Si accouchement par voie basse / péridurale: sondage évacuateur à plusieurs reprises.
Si césar: sondage à demeure, sonde vésicale retirée le lendemain.
Si accouchement par voie basse / péridurale: sondage évacuateur à plusieurs reprises.
Si césar: sondage à demeure, sonde vésicale retirée le lendemain.
"Quand je serais grande, je serais un Ange. Et même si la réalité devait me brûler les ailes, rien ne m'empêchera d'atteindre les étoiles."











