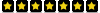TFE : Accompagnement d'un patient en fin de vie
Modérateurs : Modérateurs, ESI - TFE
Question de départ TFE sur les soins palliatifs
Bonjour je suis actuellement en 2eme anne et je dois avoir une idee sur mon theme et la question pour mon TFE
Le theme serait : La prise en charge d'un patient en fin de vie
Par contre le question je suis bloquée : J'aimerais aborder le role de l'infirmiere aupres de ses patient en soins palliatifs et ses difficultes et egalement la specificité du d'un service en soins palliatifs
Auriez vous une idee a me proposer
Merci d'avanceÉquipe de modération : Ce topic a été verrouillé et déplacé car il a déjà été traité et/ou ne figure pas dans le bon forum. Merci de consulter ce lien pour lire la suite.
Le theme serait : La prise en charge d'un patient en fin de vie
Par contre le question je suis bloquée : J'aimerais aborder le role de l'infirmiere aupres de ses patient en soins palliatifs et ses difficultes et egalement la specificité du d'un service en soins palliatifs
Auriez vous une idee a me proposer
Merci d'avanceÉquipe de modération : Ce topic a été verrouillé et déplacé car il a déjà été traité et/ou ne figure pas dans le bon forum. Merci de consulter ce lien pour lire la suite.
peut etre en lisant des docs sur le site HAS '"accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches"
et le rapport hennezel te donneront des ideesÉquipe de modération : Ce topic a été verrouillé et déplacé car il a déjà été traité et/ou ne figure pas dans le bon forum. Merci de consulter ce lien pour lire la suite.
et le rapport hennezel te donneront des ideesÉquipe de modération : Ce topic a été verrouillé et déplacé car il a déjà été traité et/ou ne figure pas dans le bon forum. Merci de consulter ce lien pour lire la suite.
TFE : Accompagnement d'un patient en fin de vie
Bonjour,
Je suis etudiante infirmière 3eme annee et j'effectue mon TFe sur l'importance de la communication dans l'accompagnement d'un patients en fin de vie dans ses derniers moments
Et serait 'il possible que des infirmieres ayant des expériences dans ce domaine de répondre à mes questions. Merci d'avance.
Dans quel service travaillez vous? Depuis combien de temps êtes vous diplomé?
Comment vous appercevez vous que le patient est "mourant"?
Vous est il arrivé d'accompagner un patient en fin de vie dans ses derniers moments? Si oui, Quelle communication privilégiez vous?
Les silences vous semblent t'ils important dans cette prise en charge?
La communication verbale est elle indispensable?
D'après vous, est ce un rôle IDE d'accompagner ces patients?Pourquoi?
Vous semble t'il difficile d'accompagner un patient "mourant"? Pourquoi?
Merci
Sinon voici mon email en MPÉquipe de modération : Ce topic a été verrouillé et déplacé car il a déjà été traité et/ou ne figure pas dans le bon forum. Merci de consulter ce lien pour lire la suite.
Je suis etudiante infirmière 3eme annee et j'effectue mon TFe sur l'importance de la communication dans l'accompagnement d'un patients en fin de vie dans ses derniers moments
Et serait 'il possible que des infirmieres ayant des expériences dans ce domaine de répondre à mes questions. Merci d'avance.
Dans quel service travaillez vous? Depuis combien de temps êtes vous diplomé?
Comment vous appercevez vous que le patient est "mourant"?
Vous est il arrivé d'accompagner un patient en fin de vie dans ses derniers moments? Si oui, Quelle communication privilégiez vous?
Les silences vous semblent t'ils important dans cette prise en charge?
La communication verbale est elle indispensable?
D'après vous, est ce un rôle IDE d'accompagner ces patients?Pourquoi?
Vous semble t'il difficile d'accompagner un patient "mourant"? Pourquoi?
Merci
Sinon voici mon email en MPÉquipe de modération : Ce topic a été verrouillé et déplacé car il a déjà été traité et/ou ne figure pas dans le bon forum. Merci de consulter ce lien pour lire la suite.
Dernière modification par Juju5544 le 03 mai 2009 18:06, modifié 1 fois.
Raison : Mail supprimé en raison du spam
Raison : Mail supprimé en raison du spam
Re: TFE : Accompagnement d'un patient en fin de vie
Force est de reconnaître que notre société a désappris ce qu’est le mourir. En effet, le lieu de la mort s’est déplacé du domicile, où le malade décédait entouré des siens, vers les institutions (hôpitaux, maisons de retraite…) où l’on a médicalisé la mort. L’expérience des générations précédentes, le bon sens acquis de la familiarité avec la fin de la vie ont peu à peu disparu. On se tourne vers les professionnels pour mourir.
On exige d’eux compétences, chaleur humaine, soutien et efficacité. Il leur revient donc d’avoir des attitudes et des pratiques appropriées
Qu’il soit redouté, attendu ou souhaité comme une délivrance, le moment de la mort de l’autre est souvent vécu comme une épreuve par ceux qui y assistent. Une épreuve qui suscite des sentiments de peur et d’angoisse.
Définition de la phase terminale
La phase terminale est le moment de la mort. Le décès est imminent et inévitable en l’absence de réanima¬tion. Elle se définit par l’apparition de la défaillance d’une ou plusieurs fonctions vitales. Il est important de ne pas confondre ce terme de « terminal » utilisé parfois simplement pour dire que les traitements spécifiques sont terminés. On entend parfois « maladie terminale » ou « malade terminal ».
La survie se compte en termes de quelques jours, quel¬quefois en heures, mais ne dépasse pas quelques semaines.
Déjà Bichat, en 1800 dans Recherche physiologique sur la vie et la mort, déclarait : « La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort. » Il précisait « l’homme meurt de trois façons : par l’encéphale, par le coeur ou par les poumons », définissant ainsi les trois grandes fonctions nécessaires à la vie.
La phase terminale est donc une bascule dans l’évo¬lution de la maladie annoncée par la défaillance des fonctions vitales : cardiocirculatoire, respiratoire et cé¬rébrale. Cette polydéfaillance est parfois provoquée par un épisode aigu (embolie pulmonaire, occlusion intesti-nale, infection
Sémiologie du mourir
La phase terminale se caractérise cliniquement par l’apparition des signes de régulation neurovégétative.
Mourir est un processus qui se déroule toujours de la même manière mais de façon plus ou moins rapide selon la cause. La mort survient parfois de façon brutale (in¬farctus du myocarde massif, engagement cérébral…).
Cependant, schématiquement, on peut distinguer deux moments différents la « phase pré agonique » et la phase agonique »
La phase pré agonique
On peut facilement l’identifier en observant les manifestations cliniques des réflexes neurovégétatifs. La conscience est variable et dépend essentiellement de la qualité de l’oxygénation cérébrale, en dehors d’éven¬tuelles pathologies neurologiques préexistantes. Le malade peut être calme ou agité, conscient ou inconscient.,dans un coma léger ou dans un état de confusion aiguë. S’il peut parler, il décrit parfois des hallucinations visuel¬les ou auditives à thème de mort : il voit par exemple les personnes décédées
…
La fréquence respiratoire s’accélère de façon réflexe. La respiration est plus ou moins efficace pour apporter une bonne oxygénation et des signes de cyanose périphé¬rique peuvent apparaître en particulier au niveau des lèvres et des doigts. L’encombrement bronchique est va¬riable. Son importance dépend de l’état de conscience et d’une éventuelle pathologie respiratoire sous-jacente.
Le pouls s’accélère, devient filant. La tension artérielle est variable à cette phase : elle peut être normale, déjà abaissée ou au contraire élevée du fait de l’hyper¬capnie et des marbrures périphériques. Celles-ci sont bien visibles au niveau des cuisses et traduisent la va¬soconstriction cutanée. Parfois, il existe également une vasoconstriction au niveau du territoire splanchnique qui se traduit par une ischémie du tube digestif entraî¬nant une diarrhée profuse.
Sans réanimation, qui vise à pallier à la défaillance des fonctions vitales, la phase préagonique évolue le plus souvent vers la phase agonique et le décès.
La phase agonique
C’est le moment même du « mourir ». Cette phase est irréversible et aboutit à la mort. Elle se caractérise par l’apparition des premiers signes de décérébration.
Les premiers signes de décérébration apparaissent : coma a réactif, hypotonie, disparition du réflexe cornéen. Il existe d’autres réflexes (occulocéphaliques, occulo¬vestibulaires) qui attestent de la décortication. Mais le cor¬néen est un des plus faciles à rechercher en pratique. Le réflexe normal correspond à une contraction de la pau¬pière et de la pupille (myosis) lorsque l’on touche la cornée avec un morceau de coton ou le coin d’une compresse. On dit qu’il est aboli quand on n’obtient plus de réponse à la stimulation de la cornée. Le myosis est souvent dif¬ficile à constater en raison des traitements morphiniques fréquemment associés. Ceux-ci n’altèrent pas le cligne-ment de la paupière.
La fréquence respiratoire diminue et devient irrégulière. L’encombrement est constant par hypersécrétion bronchique réflexe et contribue à rendre la respiration bruyante : c’est ce qu’on appelle les râles agoniques ou « gasp ». La cyanose s’intensifie.
Le pouls ralentit. La tension est basse voire imprenable, la vasoconstriction se lève et les marbrures disparais¬sent parfois.
La mort clinique légale est définie par l’arrêt des ac¬tivités cardiocirculatoire, respiratoire, encéphalique et neurovégétative.
Pendant la phase agonique, il n’y a pas de conscience, donc pas de perception, donc ni douleur, ni perception de la gêne respiratoire.
.
En phase agonique, les premiers signes de décérébra¬tion signent la mort corticale irréversible et indiquent la disparition des perceptions. Les râles agoniques corres¬pondent à la persistance de réflexes du tronc cérébral. Il s’agit d’une activité purement réflexe.
La phase agonique dure rarement plus de quelques heures.
L’objectif des soins en phase terminale est le confort. Ni les examens complémentaires ni les traitements de sup¬port sont indiqués
Pendant la phase préagonique : traitement de confort et le minimum de soinÉquipe de modération : Ce topic a été verrouillé et déplacé car il a déjà été traité et/ou ne figure pas dans le bon forum. Merci de consulter ce lien pour lire la suite.
On exige d’eux compétences, chaleur humaine, soutien et efficacité. Il leur revient donc d’avoir des attitudes et des pratiques appropriées
Qu’il soit redouté, attendu ou souhaité comme une délivrance, le moment de la mort de l’autre est souvent vécu comme une épreuve par ceux qui y assistent. Une épreuve qui suscite des sentiments de peur et d’angoisse.
Définition de la phase terminale
La phase terminale est le moment de la mort. Le décès est imminent et inévitable en l’absence de réanima¬tion. Elle se définit par l’apparition de la défaillance d’une ou plusieurs fonctions vitales. Il est important de ne pas confondre ce terme de « terminal » utilisé parfois simplement pour dire que les traitements spécifiques sont terminés. On entend parfois « maladie terminale » ou « malade terminal ».
La survie se compte en termes de quelques jours, quel¬quefois en heures, mais ne dépasse pas quelques semaines.
Déjà Bichat, en 1800 dans Recherche physiologique sur la vie et la mort, déclarait : « La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort. » Il précisait « l’homme meurt de trois façons : par l’encéphale, par le coeur ou par les poumons », définissant ainsi les trois grandes fonctions nécessaires à la vie.
La phase terminale est donc une bascule dans l’évo¬lution de la maladie annoncée par la défaillance des fonctions vitales : cardiocirculatoire, respiratoire et cé¬rébrale. Cette polydéfaillance est parfois provoquée par un épisode aigu (embolie pulmonaire, occlusion intesti-nale, infection
Sémiologie du mourir
La phase terminale se caractérise cliniquement par l’apparition des signes de régulation neurovégétative.
Mourir est un processus qui se déroule toujours de la même manière mais de façon plus ou moins rapide selon la cause. La mort survient parfois de façon brutale (in¬farctus du myocarde massif, engagement cérébral…).
Cependant, schématiquement, on peut distinguer deux moments différents la « phase pré agonique » et la phase agonique »
La phase pré agonique
On peut facilement l’identifier en observant les manifestations cliniques des réflexes neurovégétatifs. La conscience est variable et dépend essentiellement de la qualité de l’oxygénation cérébrale, en dehors d’éven¬tuelles pathologies neurologiques préexistantes. Le malade peut être calme ou agité, conscient ou inconscient.,dans un coma léger ou dans un état de confusion aiguë. S’il peut parler, il décrit parfois des hallucinations visuel¬les ou auditives à thème de mort : il voit par exemple les personnes décédées
…
La fréquence respiratoire s’accélère de façon réflexe. La respiration est plus ou moins efficace pour apporter une bonne oxygénation et des signes de cyanose périphé¬rique peuvent apparaître en particulier au niveau des lèvres et des doigts. L’encombrement bronchique est va¬riable. Son importance dépend de l’état de conscience et d’une éventuelle pathologie respiratoire sous-jacente.
Le pouls s’accélère, devient filant. La tension artérielle est variable à cette phase : elle peut être normale, déjà abaissée ou au contraire élevée du fait de l’hyper¬capnie et des marbrures périphériques. Celles-ci sont bien visibles au niveau des cuisses et traduisent la va¬soconstriction cutanée. Parfois, il existe également une vasoconstriction au niveau du territoire splanchnique qui se traduit par une ischémie du tube digestif entraî¬nant une diarrhée profuse.
Sans réanimation, qui vise à pallier à la défaillance des fonctions vitales, la phase préagonique évolue le plus souvent vers la phase agonique et le décès.
La phase agonique
C’est le moment même du « mourir ». Cette phase est irréversible et aboutit à la mort. Elle se caractérise par l’apparition des premiers signes de décérébration.
Les premiers signes de décérébration apparaissent : coma a réactif, hypotonie, disparition du réflexe cornéen. Il existe d’autres réflexes (occulocéphaliques, occulo¬vestibulaires) qui attestent de la décortication. Mais le cor¬néen est un des plus faciles à rechercher en pratique. Le réflexe normal correspond à une contraction de la pau¬pière et de la pupille (myosis) lorsque l’on touche la cornée avec un morceau de coton ou le coin d’une compresse. On dit qu’il est aboli quand on n’obtient plus de réponse à la stimulation de la cornée. Le myosis est souvent dif¬ficile à constater en raison des traitements morphiniques fréquemment associés. Ceux-ci n’altèrent pas le cligne-ment de la paupière.
La fréquence respiratoire diminue et devient irrégulière. L’encombrement est constant par hypersécrétion bronchique réflexe et contribue à rendre la respiration bruyante : c’est ce qu’on appelle les râles agoniques ou « gasp ». La cyanose s’intensifie.
Le pouls ralentit. La tension est basse voire imprenable, la vasoconstriction se lève et les marbrures disparais¬sent parfois.
La mort clinique légale est définie par l’arrêt des ac¬tivités cardiocirculatoire, respiratoire, encéphalique et neurovégétative.
Pendant la phase agonique, il n’y a pas de conscience, donc pas de perception, donc ni douleur, ni perception de la gêne respiratoire.
.
En phase agonique, les premiers signes de décérébra¬tion signent la mort corticale irréversible et indiquent la disparition des perceptions. Les râles agoniques corres¬pondent à la persistance de réflexes du tronc cérébral. Il s’agit d’une activité purement réflexe.
La phase agonique dure rarement plus de quelques heures.
L’objectif des soins en phase terminale est le confort. Ni les examens complémentaires ni les traitements de sup¬port sont indiqués
Pendant la phase préagonique : traitement de confort et le minimum de soinÉquipe de modération : Ce topic a été verrouillé et déplacé car il a déjà été traité et/ou ne figure pas dans le bon forum. Merci de consulter ce lien pour lire la suite.