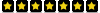Actualités 2009
Modérateurs : Modérateurs, Concours IFSI
Re: Actualités 2009
Cancer : faites du sport et… dormez Chez les femmes en tout cas, la pratique d’une activité physique contribue à diminuer le risque de cancer.
A une condition toutefois ! Pour tirer le meilleur de la pratique d’un sport, il est impératif de bien dormir. Alors Mesdames, faites le plein de sommeil…
Le Pr James Mc Clain du National Cancer Institute américain, est parvenu à ce constat après avoir suivi pendant 10 ans, près de 6 000 femmes. Parmi ces dernières, 604 souffraient d’un cancer. Au cours de ce suivi, elles devaient renseigner précisément leur niveau d’activité physique et leur temps de sommeil.
Logiquement, les plus sportives ont présenté le risque le moins élevé de développer un cancer, quel qu’il soit. Toutefois, les bénéfices ont été encore plus importants parmi les femmes qui dormaient au minimum 7 heures par nuit en moyenne. « Notre étude montre clairement que la durée de sommeil modifie les bénéfices de l’activité physique sur le risque de cancer », souligne l’auteur.
En un seul clic, trouvez toutes les équivalences entre médicaments génériques et princeps ! Kelmed ? C’est un tout nouveau moteur de recherche d’équivalence entre médicaments génériques et princeps commercialisés, accessible tant au grand public qu’aux professionnels de santé. Il permet de retrouver en un clic, le nom d’un médicament et celui de son équivalent générique.
Ce moteur d’un genre nouveau permet donc au patient de trouver les médicaments génériques correspondant à son médicament habituel. A l’inverse, il lui permet aussi de retrouver le nom du médicament d’origine de son médicament générique. Il peut prendre connaissance du ou des excipients à effet notoire dont la présence peut nécessiter des précautions d’emploi pour certaines catégories de patients. Cette information est également disponible sur l’étui et la notice du médicament.
Autre avantage de ce service entièrement gratuit, la possibilité de s’y connecter 24 heures sur 24 et notamment au cours d’un déplacement ou de vacances à l’étranger. Enfin Kelmed, développé par Biogaran, laboratoire français de médicaments génériques, s’avère très utile pour éviter aux patients de prendre deux fois le même traitement sous des noms différents ! Pour y accéder : http://www.biogaran.fr.
Inciter au don de spermatozoïdesDeux cent quarante-huit hommes ont poussé, en 2006, la porte d'un Cecos (centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme humain). 248 hommes qui ont accepté de donner leurs spermatozoïdes. Il en aurait fallu plus du double : la même année, 2 837 couples, confrontés à des problèmes de fertilité, étaient en attente de don.
Sur le thème "Et si vous offriez l'espoir de devenir parents", l'Agence de la biomédecine lancera, lundi 24 novembre, une campagne nationale d'information pour inciter au don de spermatozoïdes. "Nous ne demandons pas seulement des cellules, mais la possibilité de faire des enfants ; le donneur doit comprendre la dimension de son geste", souligne le professeur Jean-Luc Bresson, président de la fédération des Cecos.
Strictement encadré par la loi de bioéthique de 2004, le don de spermatozoïdes est - comme tous les dons d'éléments du corps humain - anonyme, gratuit et soumis à un consentement écrit.
Pour être donneur, l'homme doit être en bonne santé, âgé de moins de 45 ans et être père d'au moins un enfant. S'il est en couple, sa conjointe devra elle aussi signer un consentement. En outre, afin d'éviter le risque de consanguinité pour les générations futures, la loi limite à dix le nombre d'enfants issus d'un don de spermatozoïdes d'un seul et même donneur.
Ce don est utilisé dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation (AMP) pour les couples confrontés à une infertilité masculine médicalement diagnostiquée ou pour éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.
"La révélation de la stérilité de l'homme est toujours très douloureuse, c'est une grande meurtrissure", constate le professeur Jacques Lansac, président du Collège national des gynécologues-obstétriciens (CNGOF). "Il est important de dissocier la paternité biologique de la paternité du coeur ; cette dernière est, pour moi, prépondérante", ajoute-t-il.
Afin d'éviter toute contestation de paternité - notamment en cas de séparation -, le couple qui recourt au don donne son consentement devant un juge ou un notaire, qui l'informe des règles de filiation. En 2006, 1 122 enfants sont nés suite à un don de spermatozoïdes sur les 20 042 naissances issues de l'AMP.
Sida: la France lance une expérimentation de tests rapides
Des tests de dépistage rapide du sida, permettant de savoir en une demi-heure si on est contaminé ou pas, vont être expérimentés en France auprès d'un millier d'homosexuels par des bénévoles de l'association Aides, dans le cadre d'un programme de recherche.
Lors d'une conférence de presse à Paris, la ministre de la santé Roselyne Bachelot a rappelé que malgré cinq millions de dépistage par an "des dizaines de milliers de personnes ignorent leur séropositivité".
De fait, selon les estimations, quelque 36.000 personnes séropositives n'ont pas connaissance de leur infection ou ne se font pas suivre médicalement, et un tiers des séropositifs sont dépistés à un stade avancé de l'infection, rendant l'efficacité du traitement plus aléatoire.
La loi française ne reconnaît pas le droit à des acteurs non médicaux de réaliser des tests de dépistage, mais la Haute autorité de santé a estimé le mois dernier que les tests rapides constituaient "un outil complémentaire intéressant au modèle classique de dépistage" et proposé la mise en place de projets de recherche "comportant une évaluation structurée".
L'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) lance une étude sur le dépistage, coordonnée par le Pr Yazdan Yazdanpanah, qui doit évaluer sur deux ans la pertinence de tests rapides non-médicalisés dans la communauté homosexuelle, avec l'association Aides.
A ce jour, tous les tests de dépistage du VIH en France sont réalisés par des personnels médicaux ou para-médicaux. Pour cette expérimentation, les tests seront conduits dans les locaux de Aides, par des volontaires de l'association spécialement formés.
Ces tests rapides existent dans d'autres pays -Suisse, Grande-Bretagne, Canada, Etats-Unis...- mais y sont effectués par des personnels médicaux, selon Bruno Spire. La mise en oeuvre par des associations ne prévaut selon lui semble-t-il qu'à Barcelone, où les centres de dépistage n'existent pas.
"On est plutôt en pointe", dit Jean-Marie Le Gall (Aides).
Le milieu associatif "devient acteur à part entière de la recherche", s'est réjoui Jean-François Delfraissy, directeur de l'ANRS.
Les villes cibles sont Montpellier, puis Lille (février 2009), Bordeaux (avril 2009) et Paris (début du deuxième semestre 2009). Au total, un millier de tests y seront effectués par un simple prélèvement de sang au doigt, comme pour les diabétiques.
La fiabilité des tests, limitée dans les trois premiers mois après la contamination, devient très comparable ensuite à celle des tests médicaux classiques, selon le Pr Yazdanpanah.
Toute séropositivité découverte par le test rapide devra en tout état de cause être confirmée par un test classique, administré par un personnel médical.
Le test rapide sera suivi par une action de soutien et de conseils de prévention de la part des associations. "L'accompagnement et l'écoute, on le fait depuis 25 ans", a noté Bruno Spire, chercheur à l'Inserm et président de Aides, pour qui cette expérimentation devrait prouver que "les profanes de Aides sont capables d'attirer les personnes vers plus de prévention, et de les accompagner".
Pour lui, cela permettra aussi aux chercheurs de "mieux comprendre les besoins de ceux qui sont exposés".
L'ANRS va aussi lancer toute une gamme d'études sur la prévention et le dépistage du sida, notamment sur l'utilisation des tests rapides dans les services d'urgence des hôpitaux
A une condition toutefois ! Pour tirer le meilleur de la pratique d’un sport, il est impératif de bien dormir. Alors Mesdames, faites le plein de sommeil…
Le Pr James Mc Clain du National Cancer Institute américain, est parvenu à ce constat après avoir suivi pendant 10 ans, près de 6 000 femmes. Parmi ces dernières, 604 souffraient d’un cancer. Au cours de ce suivi, elles devaient renseigner précisément leur niveau d’activité physique et leur temps de sommeil.
Logiquement, les plus sportives ont présenté le risque le moins élevé de développer un cancer, quel qu’il soit. Toutefois, les bénéfices ont été encore plus importants parmi les femmes qui dormaient au minimum 7 heures par nuit en moyenne. « Notre étude montre clairement que la durée de sommeil modifie les bénéfices de l’activité physique sur le risque de cancer », souligne l’auteur.
En un seul clic, trouvez toutes les équivalences entre médicaments génériques et princeps ! Kelmed ? C’est un tout nouveau moteur de recherche d’équivalence entre médicaments génériques et princeps commercialisés, accessible tant au grand public qu’aux professionnels de santé. Il permet de retrouver en un clic, le nom d’un médicament et celui de son équivalent générique.
Ce moteur d’un genre nouveau permet donc au patient de trouver les médicaments génériques correspondant à son médicament habituel. A l’inverse, il lui permet aussi de retrouver le nom du médicament d’origine de son médicament générique. Il peut prendre connaissance du ou des excipients à effet notoire dont la présence peut nécessiter des précautions d’emploi pour certaines catégories de patients. Cette information est également disponible sur l’étui et la notice du médicament.
Autre avantage de ce service entièrement gratuit, la possibilité de s’y connecter 24 heures sur 24 et notamment au cours d’un déplacement ou de vacances à l’étranger. Enfin Kelmed, développé par Biogaran, laboratoire français de médicaments génériques, s’avère très utile pour éviter aux patients de prendre deux fois le même traitement sous des noms différents ! Pour y accéder : http://www.biogaran.fr.
Inciter au don de spermatozoïdesDeux cent quarante-huit hommes ont poussé, en 2006, la porte d'un Cecos (centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme humain). 248 hommes qui ont accepté de donner leurs spermatozoïdes. Il en aurait fallu plus du double : la même année, 2 837 couples, confrontés à des problèmes de fertilité, étaient en attente de don.
Sur le thème "Et si vous offriez l'espoir de devenir parents", l'Agence de la biomédecine lancera, lundi 24 novembre, une campagne nationale d'information pour inciter au don de spermatozoïdes. "Nous ne demandons pas seulement des cellules, mais la possibilité de faire des enfants ; le donneur doit comprendre la dimension de son geste", souligne le professeur Jean-Luc Bresson, président de la fédération des Cecos.
Strictement encadré par la loi de bioéthique de 2004, le don de spermatozoïdes est - comme tous les dons d'éléments du corps humain - anonyme, gratuit et soumis à un consentement écrit.
Pour être donneur, l'homme doit être en bonne santé, âgé de moins de 45 ans et être père d'au moins un enfant. S'il est en couple, sa conjointe devra elle aussi signer un consentement. En outre, afin d'éviter le risque de consanguinité pour les générations futures, la loi limite à dix le nombre d'enfants issus d'un don de spermatozoïdes d'un seul et même donneur.
Ce don est utilisé dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation (AMP) pour les couples confrontés à une infertilité masculine médicalement diagnostiquée ou pour éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.
"La révélation de la stérilité de l'homme est toujours très douloureuse, c'est une grande meurtrissure", constate le professeur Jacques Lansac, président du Collège national des gynécologues-obstétriciens (CNGOF). "Il est important de dissocier la paternité biologique de la paternité du coeur ; cette dernière est, pour moi, prépondérante", ajoute-t-il.
Afin d'éviter toute contestation de paternité - notamment en cas de séparation -, le couple qui recourt au don donne son consentement devant un juge ou un notaire, qui l'informe des règles de filiation. En 2006, 1 122 enfants sont nés suite à un don de spermatozoïdes sur les 20 042 naissances issues de l'AMP.
Sida: la France lance une expérimentation de tests rapides
Des tests de dépistage rapide du sida, permettant de savoir en une demi-heure si on est contaminé ou pas, vont être expérimentés en France auprès d'un millier d'homosexuels par des bénévoles de l'association Aides, dans le cadre d'un programme de recherche.
Lors d'une conférence de presse à Paris, la ministre de la santé Roselyne Bachelot a rappelé que malgré cinq millions de dépistage par an "des dizaines de milliers de personnes ignorent leur séropositivité".
De fait, selon les estimations, quelque 36.000 personnes séropositives n'ont pas connaissance de leur infection ou ne se font pas suivre médicalement, et un tiers des séropositifs sont dépistés à un stade avancé de l'infection, rendant l'efficacité du traitement plus aléatoire.
La loi française ne reconnaît pas le droit à des acteurs non médicaux de réaliser des tests de dépistage, mais la Haute autorité de santé a estimé le mois dernier que les tests rapides constituaient "un outil complémentaire intéressant au modèle classique de dépistage" et proposé la mise en place de projets de recherche "comportant une évaluation structurée".
L'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) lance une étude sur le dépistage, coordonnée par le Pr Yazdan Yazdanpanah, qui doit évaluer sur deux ans la pertinence de tests rapides non-médicalisés dans la communauté homosexuelle, avec l'association Aides.
A ce jour, tous les tests de dépistage du VIH en France sont réalisés par des personnels médicaux ou para-médicaux. Pour cette expérimentation, les tests seront conduits dans les locaux de Aides, par des volontaires de l'association spécialement formés.
Ces tests rapides existent dans d'autres pays -Suisse, Grande-Bretagne, Canada, Etats-Unis...- mais y sont effectués par des personnels médicaux, selon Bruno Spire. La mise en oeuvre par des associations ne prévaut selon lui semble-t-il qu'à Barcelone, où les centres de dépistage n'existent pas.
"On est plutôt en pointe", dit Jean-Marie Le Gall (Aides).
Le milieu associatif "devient acteur à part entière de la recherche", s'est réjoui Jean-François Delfraissy, directeur de l'ANRS.
Les villes cibles sont Montpellier, puis Lille (février 2009), Bordeaux (avril 2009) et Paris (début du deuxième semestre 2009). Au total, un millier de tests y seront effectués par un simple prélèvement de sang au doigt, comme pour les diabétiques.
La fiabilité des tests, limitée dans les trois premiers mois après la contamination, devient très comparable ensuite à celle des tests médicaux classiques, selon le Pr Yazdanpanah.
Toute séropositivité découverte par le test rapide devra en tout état de cause être confirmée par un test classique, administré par un personnel médical.
Le test rapide sera suivi par une action de soutien et de conseils de prévention de la part des associations. "L'accompagnement et l'écoute, on le fait depuis 25 ans", a noté Bruno Spire, chercheur à l'Inserm et président de Aides, pour qui cette expérimentation devrait prouver que "les profanes de Aides sont capables d'attirer les personnes vers plus de prévention, et de les accompagner".
Pour lui, cela permettra aussi aux chercheurs de "mieux comprendre les besoins de ceux qui sont exposés".
L'ANRS va aussi lancer toute une gamme d'études sur la prévention et le dépistage du sida, notamment sur l'utilisation des tests rapides dans les services d'urgence des hôpitaux
Re: Actualités 2009
1ère convention de la société face au cancer
La Ligue contre le cancer organise le dimanche 23 novembre 2008 à la Grande Arche de la Défense la 1ère convention de la société face au cancer sous le haut patronage et en présence du Président de la République, de la Ministre de la Santé et de très nombreuses personnalités. L'objectif ? Engager toute la société dans un nouvel élan collectif décisif afin de gagner des vies sur la maladie mais aussi pour améliorer la qualité de vie des malades et de leurs proches.
Depuis les 1ers Etats généraux des malades atteints de cancer de 1998, la lutte contre le cancer a connu des changements radicaux autorisant de nouveaux espoirs. Les doléances portées par les malades et leur entourage ont suscité une mobilisation collective qui a notamment conduit à la loi dite Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, au Plan cancer et à la prise en considération du rôle de l'entourage des malades.
De nouveaux défis
Cette dynamique de changements majeurs, accompagnés par la Ligue, autorise à penser, qu'aujourd'hui les problèmes sont connus. Seulement, les solutions apportées jusque-là, qu'elles soient sociales ou thérapeutiques, se heurtent à de nouveaux défis liés aux modifications profondes de la société (nouveaux traitements parfois coûteux, questions de l'emploi, du pouvoir d'achat, des nouveaux modes de communication et d'échange, etc.). "C'est en mobilisant la société dans son ensemble que nous pourrons durablement changer nos rapports à la maladie, aux malades et à la question du cancer afin de lutter plus efficacement tant au niveau thérapeutique, qu'économique et social" affirme la Ligue.
Un élan collectif
La 1ère convention de la société face au cancer engage toute la société dans un nouvel élan collectif décisif afin de gagner des vies sur la maladie mais aussi pour améliorer la qualité de vie des malades et de leurs proches. Vivre avec un cancer ou après un cancer est une réalité qui dépasse les seules compétences des professionnels de santé et qui interpelle de nouveaux acteurs sociaux jusqu'ici peu ou pas mobilisés.
Pour cela, 1a convention de la société face au cancer rassemblera autour des malades et de leurs proches, professionnels de santé, chercheurs, acteurs sanitaires et sociaux, associations, élus, chefs d'entreprise, représentants syndicaux, personnalités internationales, artistes, sportifs, grand public... tous ceux qui ont un rôle à jouer pour apporter ensemble de nouvelles solutions à de nouveaux défis.
L'avenir de la lutte contre le cancer ne peut désormais se concevoir qu'avec un changement du rapport de la société au malade et à la maladie. Désormais, plus que l'image de la maladie, c'est le regard que la société porte sur le malade ou l'ancien malade qu'il est urgent de modifier.
Cancers : les pesticides sur la sellette ? Deux associations, l’Alliance Santé Environnement et le Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations futures, lancent une campagne visant à renforcer la réglementation relative à l’utilisation des pesticides, insecticides et autres fongicides.
« En Europe, chaque année, au minimum un cancer diagnostiqué sur cent peut être directement imputable à l’exposition aux pesticides », rappellent-elles.
La campagne Pesticides et Cancers s’articule autour de plusieurs objectifs. Plus spécifiquement, elle vise les responsables politiques. Les deux associations militent en effet pour l’interdiction des pesticides reconnus ou simplement suspectés d’être néfastes pour la santé. Elles recommandent par ailleurs, « la mise en place de stratégies de santé publique et de plans cancer nationaux où la réduction de l’exposition aux pesticides serait une mesure de prévention primaire » .
Autres ambitions, informer et sensibiliser le public. « Nous souhaitons accroître l’information du public sur les liens entre pesticides et cancers, et mobiliser les citoyens ». Rappelons que les effets des pesticides sur la santé ont déjà fait l’objet d’études très sérieuses en France. Notamment auprès des agriculteurs. Avec des résultats très préoccupants. Par ailleurs, les pesticides sont également au cœur d’un colloque organisé le 25 novembre à Paris au Ministère de l’Ecologie, dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne sur le thème Environnement chimique, reproduction et développement de l’enfant.
La Ligue contre le cancer organise le dimanche 23 novembre 2008 à la Grande Arche de la Défense la 1ère convention de la société face au cancer sous le haut patronage et en présence du Président de la République, de la Ministre de la Santé et de très nombreuses personnalités. L'objectif ? Engager toute la société dans un nouvel élan collectif décisif afin de gagner des vies sur la maladie mais aussi pour améliorer la qualité de vie des malades et de leurs proches.
Depuis les 1ers Etats généraux des malades atteints de cancer de 1998, la lutte contre le cancer a connu des changements radicaux autorisant de nouveaux espoirs. Les doléances portées par les malades et leur entourage ont suscité une mobilisation collective qui a notamment conduit à la loi dite Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, au Plan cancer et à la prise en considération du rôle de l'entourage des malades.
De nouveaux défis
Cette dynamique de changements majeurs, accompagnés par la Ligue, autorise à penser, qu'aujourd'hui les problèmes sont connus. Seulement, les solutions apportées jusque-là, qu'elles soient sociales ou thérapeutiques, se heurtent à de nouveaux défis liés aux modifications profondes de la société (nouveaux traitements parfois coûteux, questions de l'emploi, du pouvoir d'achat, des nouveaux modes de communication et d'échange, etc.). "C'est en mobilisant la société dans son ensemble que nous pourrons durablement changer nos rapports à la maladie, aux malades et à la question du cancer afin de lutter plus efficacement tant au niveau thérapeutique, qu'économique et social" affirme la Ligue.
Un élan collectif
La 1ère convention de la société face au cancer engage toute la société dans un nouvel élan collectif décisif afin de gagner des vies sur la maladie mais aussi pour améliorer la qualité de vie des malades et de leurs proches. Vivre avec un cancer ou après un cancer est une réalité qui dépasse les seules compétences des professionnels de santé et qui interpelle de nouveaux acteurs sociaux jusqu'ici peu ou pas mobilisés.
Pour cela, 1a convention de la société face au cancer rassemblera autour des malades et de leurs proches, professionnels de santé, chercheurs, acteurs sanitaires et sociaux, associations, élus, chefs d'entreprise, représentants syndicaux, personnalités internationales, artistes, sportifs, grand public... tous ceux qui ont un rôle à jouer pour apporter ensemble de nouvelles solutions à de nouveaux défis.
L'avenir de la lutte contre le cancer ne peut désormais se concevoir qu'avec un changement du rapport de la société au malade et à la maladie. Désormais, plus que l'image de la maladie, c'est le regard que la société porte sur le malade ou l'ancien malade qu'il est urgent de modifier.
Cancers : les pesticides sur la sellette ? Deux associations, l’Alliance Santé Environnement et le Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations futures, lancent une campagne visant à renforcer la réglementation relative à l’utilisation des pesticides, insecticides et autres fongicides.
« En Europe, chaque année, au minimum un cancer diagnostiqué sur cent peut être directement imputable à l’exposition aux pesticides », rappellent-elles.
La campagne Pesticides et Cancers s’articule autour de plusieurs objectifs. Plus spécifiquement, elle vise les responsables politiques. Les deux associations militent en effet pour l’interdiction des pesticides reconnus ou simplement suspectés d’être néfastes pour la santé. Elles recommandent par ailleurs, « la mise en place de stratégies de santé publique et de plans cancer nationaux où la réduction de l’exposition aux pesticides serait une mesure de prévention primaire » .
Autres ambitions, informer et sensibiliser le public. « Nous souhaitons accroître l’information du public sur les liens entre pesticides et cancers, et mobiliser les citoyens ». Rappelons que les effets des pesticides sur la santé ont déjà fait l’objet d’études très sérieuses en France. Notamment auprès des agriculteurs. Avec des résultats très préoccupants. Par ailleurs, les pesticides sont également au cœur d’un colloque organisé le 25 novembre à Paris au Ministère de l’Ecologie, dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne sur le thème Environnement chimique, reproduction et développement de l’enfant.
- virginieeva
- Fidèle

- Messages : 206
- Inscription : 29 mai 2008 13:37
Re: Actualités 2009
Actualités du 20 novembre 2008
PENURIE DE PERSONNELS HOSPITALIERS ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Le 20 Novembre 2008 - (Infirmiers.com) : Pour faire face à la pénurie de soignants et améliorer l'atractivité des métiers hospitaliers, des délégations régionales de l'Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH) expériementent un dispositif de d’Amélioration des Conditions de Travail dans les Etablissements de Santé
Communiqué de presse de l'ANFH
Pénurie de personnels hospitaliers : Comment séduire par les conditions de travail ?
Le point sur le dispositif expérimenté en Languedoc-Roussillon et PACA
Le secteur sanitaire et social public fait face à une vague de départs à la retraite sans précédent. Dans un contexte de concurrence avec le secteur privé, la question de l’attractivité des métiers hospitaliers et médico-sociaux publics est désormais un enjeu majeur pour assurer le renouvellement des effectifs. Pour répondre à cette problématique, les délégations régionales ANFH* Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur expérimentent depuis 2007 un projet appelé PACTES (Projet d’Amélioration des Conditions de Travail dans les Etablissements de Santé). Elles proposent ainsi un programme de formation-action et d’audits destinés à améliorer les conditions de travail des personnels soignants de la fonction publique hospitalière. Réunis à Tarascon le 22 octobre prochain, les représentants des établissements adhérents (Cf. liste ci-dessous) effectuent un premier bilan d’étape du projet PACTES.
Projet expérimental PACTES en région Languedoc-Roussillon et PACA
Si les deux régions sont particulièrement attractives, les départs à la retraite et le coût de l’immobilier notamment génèrent de réelles difficultés pour conserver et attirer des professionnels dans la Fonction Publique compte tenu de leur niveau de rémunération. Le besoin en IDE (infirmiers diplômés d’Etat) est très important et l’appareil de formation initiale reste insuffisant pour répondre au renouvellement générationnel.
Afin de répondre à la pénurie de personnel, les instances de l’ANFH Languedoc-Roussillon et PACA ont décidé de renforcer l’attractivité du secteur hospitalier public en améliorant les conditions de travail. Le projet PACTES s’attache à agir en ce sens sur trois champs :
• la réduction des troubles musculo-squelettiques,
• la prévention des troubles psychologiques,
• la reconnaissance des compétences.
Un audit « ergonomie » pour réduire les troubles musculo-squelettiques
La réduction des troubles musculo-squelettiques doit agir sur plusieurs dimensions de la vie de l’hôpital : l’équipement, l’architecture des bâtiments et le management des équipes. Equipements adaptés aux contraintes professionnelles (sièges assis-debout, rangement ergonomique), architecture orientée pour répondre aux besoins des personnels, choix intégrant la sécurité des agents (revêtements de sol faiblement glissants), la prise en compte de ces éléments nécessite le soutien des cadres.
Pour répondre à ces enjeux, le dispositif PACTES prévoit un audit « ergonomie » par établissement, la formation d’un référent et un accompagnement à la mise en œuvre d’une activité physique pour créer les conditions d'une application dans les quotidiens de travail.
Un consultant à disposition pour prévenir les troubles psychologiques
La prévention des troubles psychologique nécessite de concilier de façon équilibrée vie professionnelle et vie personnelle. Le dispositif PACTES active en ce sens trois leviers :
• l’aménagement des horaires de travail permettant d’adapter ou de compenser les horaires les plus incompatibles avec la vie personnelle,
• le respect des risques chronobiologiques favorisant la compensation des pénibilités spécifiques,
• l’association des agents à la détermination des plannings afin de réduire les changements de dernière minute et de favoriser le chevauchement entre équipes successives.
Le dispositif PACTES propose l’intervention d’un consultant pour prendre en compte les deux derniers leviers.
Former des tuteurs et des chefs de projet pour mettre en valeur les compétences
Six paramètres sont identifiés pour reconnaître les compétences :
• démontrer que les pratiques et le soignant, en tant que personne, sont appréciés à leur juste valeur, notamment lors de temps de discussion pour construire collectivement et en multidisciplinaire des pratique et des méthodes.
• l’organisation du travail doit favoriser le partage des connaissances de façon pluridisciplinaire tout en préservant les territoires de compétences propres à chaque métier.
• l’autonomie professionnelle
• l’influence des patients sur l’organisation des soins (comment les réaliser, le meilleur moment…)
• le développement de la recherche infirmière et la production d’un savoir sur les pratiques de nursing et d’éducation,
• le développement des postes de soignant référent, tuteur et expert pour les professionnels expérimentés et reconnus par leurs pairs (le tutorat aide-soignant peut être expérimenté aussi bien que le tutorat infirmier).
Le dispositif PACTES se propose de répondre à ces questions en formant des tuteurs, et en accompagnant la mise en œuvre du tutorat dans les établissements via la formation des chefs de projets.
Une démarche méthodologique adaptée
Si les conditions de travail ne relèvent pas, a priori, des missions d’un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), l’ANFH a cependant été reconnue porteur de projet par les trente établissements participants, notamment grâce à la place centrale qu’elle occupe au sein de la communauté hospitalière. Atout précieux pour piloter les dimensions « réseau» du projet, cette place de coordinateur permet de générer des synergies entre établissements et de favoriser des actions correctrices reproductibles qui seront évaluées.
Au sein des établissements adhérents, un référent dédié au projet est désigné, garant de l’implication et de l’adaptation des actions aux problématiques spécifiques des établissements.
Les actions proposées sont à la carte : les établissements peuvent mettre en œuvre le ou les volets d’actions qu’ils souhaitent au regard du contexte dans lequel ils évoluent et de leurs priorités.
Le projet PACTES en chiffres :
• 90 acteurs du projet réunis à Tarascon le 22 octobre (représentants des établissements, partenaires, prestataires, Comité de Pilotage, équipe projet).
• 27 établissements dans le projet employant plus de 48 000 agents.
• Près de 3 000 agents sont directement concernés par les actions menées, soit 6% de l'effectif global.
• 230 personnes participeront aux formations pour un total de 1600 journées.
• 2800 IDE sont diplômés par an sur les deux régions alors que le besoin est estimé à au moins 3000 pour tout le secteur.
• 20 000 IDE travaillent aujourd’hui dans les établissements publics des 2 régions et le besoin existe tant dans le secteur médico-social que sanitaire.
• Le projet PACTES représente un investissement de 840 000 euros.
SECURITE SOCIALE
Le Sénat adopte à son tour le budget de la Sécu
Les groupes UMP et du Nouveau centre (NC) ont voté pour. Les groupes socialiste, radical et citoyen (SRC) et de la gauche démocrate et républicaine (GDR, PC et Verts) ont voté contre
Le Sénat a adopté à son tour, jeudi 20 novembre, après les députés, le projet de budget de la Sécu pour 2009 marqué par un déficit aggravé par la crise. Les députés avaient voté le texte le 4 novembre dernier.
Ce texte, composé de près d'une centaine d'articles sur lesquels ont été déposés environ 650 amendements, prévoit de contenir le déficit des comptes sociaux à 8,6 milliards d'euros grâce à un plan de redressement de 6 milliards d'euros. Il entend poursuivre "l'effort de redressement" de la Sécu, en faisant des économies, des transferts de ressources et de nouvelles recettes dont 1 milliard d'euros de taxe sur les complémentaires santé (mutuelles ou assurances privées). Il met également en place un "forfait social" de 2% à la charge des employeurs.
La psychiatrie française va de plus en plus mal
Comme en boomerang, l'affaire réveille toutes les plaies de la psychiatrie. Le meurtre d'un jeune homme en pleine rue, mercredi 12 novembre, par un patient schizophrène échappé de l'hôpital psychiatrique de Grenoble, a secoué les équipes soignantes en santé mentale. Comme après l'affaire du double meurtre de Pau, en 2004, commis par un ancien patient de l'hôpital psychiatrique de la ville, médecins et soignants témoignent de la crise profonde de leur discipline. "On ne parle de la psychiatrie que quand il y a des faits divers, s'alarme Séverine Morio, infirmière à l'hôpital parisien Maison-Blanche. Mais c'est toute l'année que nous sommes en difficulté. On organise les ruptures de soin en faisant sortir trop tôt les patients, et ensuite on s'étonne qu'il y ait des passages à l'acte..."
Le drame de Grenoble intervient dans un contexte de crise latente, les appels à la grève se multipliant dans les services de psychiatrie. A l'hôpital de la Conception à Marseille, une équipe a observé un mois d'arrêt de travail, en octobre, pour refuser l'arrivée d'un patient réputé très violent ; le 6 novembre, une centaine de salariés de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, à Lyon, ont débrayé pour protester contre l'agression d'une infirmière par un patient qui ne voulait pas sortir de l'hôpital ; mardi 18 novembre, des soignants des hôpitaux parisiens de Sainte-Anne, Esquirol et Maison-Blanche observaient également une grève pour "lancer l'alerte sur la dégradation de la psychiatrie en France".
De fait, malgré l'effort consenti par l'Etat au titre du plan santé mentale 2005-2008 (plus d'1,5 milliard d'euros consacrés surtout aux rénovations d'établissement), les hôpitaux psychiatriques sont soumis à une forte contrainte financière.
En vingt ans, 50 000 lits d'hospitalisation ont été fermés, sans que les structures alternatives de prises en charge (appartements et centres d'accueil thérapeutiques) aient été ouvertes en compensation. Comme les hôpitaux généraux, les hôpitaux psychiatriques doivent répondre aux impératifs de gestion médico-économique, qui imposent de rentabiliser au maximum les lits disponibles : "Résultat, on pratique de plus en plus une psychiatrie de turnover, de portes tournantes", s'insurge Nadia Missaoui, syndicaliste CGT à Maison-Blanche.
Les soignants souffrent de ne plus pouvoir s'occuper suffisamment de leurs patients. "Le mot d'ordre, c'est des hospitalisations de plus en plus courtes, de quelques jours seulement, alors que les traitements mettent trois semaines à agir, explique Mme Morio. Du coup, on met dans la rue des patients pas encore stabilisés et qui ne savent pas où aller." Il n'est pas rare que les soignants retrouvent leurs patients sur le trottoir, alcoolisés et délirants... avant qu'ils ne décompensent à nouveau et soient renvoyés à l'hôpital. "Le matin, on est rivés à nos plannings pour savoir quel patient on va pouvoir faire sortir parce qu'il y en a trois qui attendent dans le couloir, dénonce Agnès Cluzel, de l'hôpital Bichat. Et quand ils sortent, ils n'ont souvent que le numéro du SAMU social dans la main."
En face, les familles ont souvent un sentiment d'abandon. "Beaucoup de malades mentaux sont hors de tout soin, s'alarme Anne Poiré, écrivain, auteur d'Histoire d'une schizophrénie, Jérémy, sa famille, la société (éd. Frison-Roche). Les patients viennent d'eux-mêmes à l'hôpital et on ne les soigne pas. On est dans une situation de déni de soin et de non-assistance à personne en danger." Mme Poiré relate le cas d'une jeune femme qui avait fait une bouffée délirante. Sortie contre son gré de l'hôpital public, elle s'est présentée dans une clinique privée qui a refusé de la prendre et l'a renvoyée vers l'hôpital d'où elle venait. Sur le chemin, elle s'est suicidée.
Dans ce contexte, l'annonce par Nicolas Sarkozy, au lendemain du drame de Grenoble, d'un durcissement de la loi de 1990 sur l'hospitalisation sans consentement est perçue avec inquiétude par les soignants. Le président de la République veut créer un fichier des personnes hospitalisées d'office et durcir leurs conditions de sortie. "Nous sommes tous favorables à une réforme, mais nous refusons l'exploitation éhontée d'un fait divers pour servir la cause sécuritaire, s'insurge Norbert Skurnik, président du Syndicat des psychiatres de secteur. Qu'une population aussi inoffensive que les schizophrènes soit stigmatisée est inadmissible : ce sont nos patients qui sont en danger par manque de soins, pas l'inverse !"
Pourtant, la psychiatrie est loin de rester sourde aux injonctions sécuritaires. Confrontées à des patients agressifs du fait d'un défaut de prise en charge, les équipes recourent de plus en plus à la contention et aux chambres d'isolement. A côté des cinq unités pour malades difficiles (UMD), réservées pour des séjours de six à douze mois, se créent aujourd'hui des unités de soins intensifs psychiatriques (USIP) pour de plus courts séjours : l'hôpital recrée en son sein les murs qu'il a tenté d'abolir au début des années 1980.
"On est dans le paradoxe permanent, explique Serge Klopp, cadre infirmier. Au nom de la désinstitutionnalisation, on a fermé les lits et on nous dit aujourd'hui qu'il faut enfermer les plus dangereux. Alors on multiplie les placements en chambre d'isolement, parce qu'on n'a pas le temps de les soigner quand ils sont en crise. Comme on ne peut plus contenir l'angoisse du psychotique par une présence rassurante, ils passent à l'acte beaucoup plus souvent. Résultat, on est dans le rapport de force et la gestion de la violence." Entre sa mission de soin et l'impératif de sécurité qui s'impose à elle, la psychiatrie se débat de plus en plus dans les injonctions contradictoires.
Un test rapide pour dépister le sida en 2009
Aides lancera, courant 2009, une campagne de dépistage rapide du sida menée par des volontaires de l'association. Le but est de sensibiliser une grande partie de la population qui ignore encore sa séropositivité.
Des tests de dépistage rapide du sida, permettant de savoir en une demi-heure si on est contaminé ou pas, vont être expérimentés en France auprès d'un millier d'homosexuels par des bénévoles de l'association Aides, dans le cadre d'un programme de recherche.
Lors d'une conférence de presse à Paris, la ministre de la santé Roselyne Bachelot a rappelé que malgré cinq millions de dépistage par an "des dizaines de milliers de personnes ignorent leur séropositivité". De fait, selon les estimations, quelque 36000 personnes séropositives n'ont pas connaissance de leur infection ou ne se font pas suivre médicalement, et un tiers des séropositifs sont dépistés à un stade avancé de l'infection, rendant l'efficacité du traitement plus aléatoire.
Des tests réalisés par des volontaires
La loi française ne reconnaît pas le droit à des acteurs non médicaux de réaliser des tests de dépistage, mais la Haute autorité de santé a estimé le mois dernier que les tests rapides constituaient "un outil complémentaire intéressant au modèle classique de dépistage" et proposé la mise en place de projets de recherche "comportant une évaluation structurée".
L'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) lance une étude sur le dépistage, coordonnée par le Pr Yazdan Yazdanpanah, qui doit évaluer sur deux ans la pertinence de tests rapides non-médicalisés dans la communauté homosexuelle, avec l'association Aides.
A ce jour, tous les tests de dépistage du VIH en France sont réalisés par des personnels médicaux ou para-médicaux. Pour cette expérimentation, les tests seront conduits dans les locaux de Aides, par des volontaires de l'association spécialement formés.
Ces tests rapides existent dans d'autres pays -Suisse, Grande-Bretagne, Canada, Etats-Unis...- mais y sont effectués par des personnels médicaux, selon Bruno Spire. La mise en oeuvre par des associations ne prévaut selon lui semble-t-il qu'à Barcelone, où les centres de dépistage n'existent pas. "On est plutôt en pointe", dit Jean-Marie Le Gall (Aides). Le milieu associatif "devient acteur à part entière de la recherche", s'est réjoui Jean-François Delfraissy, directeur de l'ANRS.
Un millier de tests
Les villes cibles sont Montpellier, puis Lille (février 2009), Bordeaux (avril 2009) et Paris (début du deuxième semestre 2009). Au total, un millier de tests y seront effectués par un simple prélèvement de sang au doigt, comme pour les diabétiques. La fiabilité des tests, limitée dans les trois premiers mois après la contamination, devient très comparable ensuite à celle des tests médicaux classiques, selon le Pr Yazdanpanah.
Toute séropositivité découverte par le test rapide devra en tout état de cause être confirmée par un test classique, administré par un personnel médical.
Le test rapide sera suivi par une action de soutien et de conseils de prévention de la part des associations. "L'accompagnement et l'écoute, on le fait depuis 25 ans", a noté Bruno Spire, chercheur à l'Inserm et président de Aides, pour qui cette expérimentation devrait prouver que "les profanes de Aides sont capables d'attirer les personnes vers plus de prévention, et de les accompagner". Pour lui, cela permettra aussi aux chercheurs de "mieux comprendre les besoins de ceux qui sont exposés".
L'ANRS va aussi lancer toute une gamme d'études sur la prévention et le dépistage du sida, notamment sur l'utilisation des tests rapides dans les services d'urgence des hôpitaux.
Première greffe de trachée sans traitement post-opératoire
Le site de la revue médicale anglaise, The Lancet, a publié la description de la première greffe de trachée sans traitement à vie contre le rejet de l'organe greffé.
Une jeune mère colombienne de 30 ans, Claudia Castillo, souffrant de problèmes respiratoires, a bénéficié de la première greffe de trachée sans avoir besoin de prendre des médicaments immunosuppresseurs et pu ainsi retrouver une vie normale, selon une équipe internationale européenne.
Cette transplantation faite le 12 juin 2008 à Barcelone (Espagne), fondée sur l'utilisation de la trachée d'un donneur et de cellules souches adultes provenant de la jeune femme, est décrite mercredi en ligne dans la revue médicale britannique The Lancet par les équipes de Barcelone, de Padoue et de Milan (Italie) et de l'université de Bristol (Grande-Bretagne).
Après quatre ans d'errance de consultation en consultation, Claudia Castillo, victime d'une tuberculose trop tardivement diagnostiquée, a ainsi trouvé une solution à ses problèmes respiratoires. En mars, elle était devenue incapable de prendre soin de ses deux enfants ou d'effectuer de simples tâches domestiques.
Les dégâts sur sa bronche principale gauche sont tels qu'il ne lui reste que l'option classique de l'ablation du poumon gauche.
"Heureuse d'être guérie"
Pour éviter cette opération mutilante risquée, le professeur Paolo Macchiarini, spécialiste de chirurgie thoracique à Barcelone (Hospital Clinico de Barcelona) et ses collègues décident, avec l'aval des comités d'éthiques concernés, de tenter cette greffe d'un nouveau genre.
Sept centimètres de trachée d'une femme de 51 ans, décédée d'une hémorragie cérébrale, sont préalablement débarrassés de toutes ses cellules, afin de ne pas provoquer de rejet, une fois transplantés. On prélève alors sur la patiente colombienne des cellules souches de moelle osseuse : des cellules mésenchymateuses, capables de donner des cellules de cartilages ("chondrocytes"). D'autres cellules (des "cellules épithéliales") sont par ailleurs prises sur une partie saine de sa trachée. Ensuite, la trachée du donneur est placée dans un appareil, un "bioréacteur" spécialement conçu à cet effet, où on la fait tourner avec les cellules de la patiente. Ainsi l'organe est colonisé par les cellules de la future receveuse. Ce qui a permis d'éviter le traitement à vie contre le rejet de l'organe greffé.
Dix jours après la greffe, Claudia sortait de l'hôpital. Depuis, elle va bien et est désormais capable de monter deux étages ou de marcher 500 mètres sans s'arrêter et, peut-être plus important, de s'occuper de ses enfants, selon ses médecins. Elle se réjouit de "pouvoir profiter à nouveau de la vie" et se dit "heureuse d'être guérie".
Cette innovation en médecine pourrait bénéficier à d'autres maladies des voies respiratoires supérieures (déformation congénitale, certaines tumeurs, etc.) ne pouvant bénéficier de la chirurgie classique, selon l'université Barcelone.
Toutefois, pour une meilleure évaluation de ces résultats, un suivi médical sur des périodes plus longues apparaissent nécessaires, estiment deux Japonais, les docteurs Toshihiko Sato et Tatsuo Nakamura, de l'université de Kyoto, dans Lancet. La première transplantation de trachée avec donneur a été décrite dans la même revue en 1979.
Infertilité masculine: le "mâle" du siècle
Le nombre de spermatozoïdes a diminué de moitié en un demi-siècle. Une infertilité masculine qui met en péril de don de sperme. En cause, l'environnement chimique dont la nocivité est prouvée pour certains, supposée pour d'autres.
Dans un environnement saturé de chimie, les difficultés de reproduction et les malformations génitales chez les hommes sont désormais suffisamment avérées pour justifier d'alerter la population et de mobiliser les chercheurs.
De nombreuses études européennes et américaines ont fait apparaître une diminution de moitié du nombre de spermatozoïdes en 50 ans, tandis qu'augmentait le nombre de cancers des testicules -qui se développent généralement chez les jeunes hommes- et les malformations génitales chez les petits garçons.
Un colloque sur le thème "Environnement chimique, reproduction et développement de l'enfant", organisé mardi prochain par la secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, doit permettre un partage d'experiences entre scientifiques européens. Le soir du colloque, la chaîne franco-allemande Arte diffusera à 21h00 le film enquête "Mâles en péril" sur le sujet, suivi d'un débat.
"Féminisation"
"Il y a ceux qui disent qu'on ne sait pas tout et qu'il vaut mieux ne pas en parler et ceux, dont moi, qui considèrent qu'on en sait suffisamment et que plus on en parle, plus on fait avancer la connaissance et la prévention", a résumé Nathalie Kosciusko-Morizet mardi devant la presse.
En ligne de mire: les phtalates et le Bisphénol-A, des substances omniprésentes au quotidien, utilisées pour assouplir les plastiques, qui agissent comme des hormones féminines et sont considérés comme des "pertubateurs endocriniens".
"Les mécanismes sont différents mais le résultat est le même: une féminisation", explique le Pr Bernard Jégou, président du conseil scientifique de l'Inserm.
"Et ce n'est pas seulement l'individu exposé qui est concerné, mais aussi la génération suivante", insiste-t-il: "Nous sommes porteurs de l'exposition de nos arrières grands-parents aux perturbateurs endocriniens".
Moins de 350 hommes se sont présentés en 2006 pour un don de spermatozoïdes, pas assez pour répondre aux besoins, a souligné jeudi l'Agence de la biomédecine qui veut sensibiliser à ce don très intime, seule chance pour certains couples de donner naissance à un enfant.
"Trou noir"
A ce jour, indique-t-il, les études n'ont été conduites que dans les pays du nord et ont fait apparaître "un déclin avéré des spermatozoïdes dans les grandes villes comme Paris ou Edimbourg, avec une grande variabilité d'une région à l'autre". En France, Lille est ainsi mieux lotie que Toulouse.
Mais pour l'Afrique, l'Amérique Latine et la majorité de l'Asie, "c'est le trou noir".
Pendant des décennies, les Etats ont laissé s'installer sur le marché des produits dont ils n'avaient pas les moyens de financer les tests pour s'assurer de leur inocuité. Aujourd'hui, le règlement européen Reach oblige les industriels à enregistrer leurs molécules et à prouver leur inocuité, ce qui permettra à terme de dire "quelles sont celles qui posent problème".
La secrétaire d'Etat à l'Ecologie constate que "le monde politique a évolué sur le sujet et fait plus facilement place au doute".
Présidente du groupe parlementaire Santé et Environnement, en 2006, Nathalie Kosciusko-Morizet avait peiné à convoquer une journée de débats sur le sujet: l'industrie, hostile, avait trouvé à l'Assemblée de nombreux relais pour contrer son action.
"C'est aujourd'hui plus facile comme ministre que comme député", s'amuse-t-elle.
Elle est soutenue par le ministère de la Santé: Roselyne Bachelot devrait annoncer lors du colloque de mardi des mesures d'information en direction du grand public, surtout des femmes enceintes, a indiqué Didier Houssin, Directeur général de la Santé au ministère.
Même s'il continue de penser "qu'il est difficile de mettre l'accent sur des produits sur lesquels un doute subsiste, alors qu'il n'y a que des certitudes sur l'effet nocif du tabac et de l'alcool", M. Houssin admet qu'il convient d'adopter "une vision large des risques".
Cinq mises en examen dans l'affaire du corned-beef avarié
Le secteur de l'agroalimentaire est fortement touché par cinq mises en examen -dont celles des groupes Charal et Soviba- pour "tromperie aggravée", dans le cadre d'une enquête sur de la viande avariée qui a commencé en 2006.
Cinq sociétés du secteur agroalimentaire, dont les groupes Charal et Soviba, ont été récemment mises en examen pour "tromperie aggravée" dans le cadre d'une enquête sur des stocks de viandes avariées en boite découvertes à la société Covi à Cholet (Maine-et-Loire), a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Parmi les autres mis en examen figurent les sociétés Covi, Arcadie, et Desial, selon le site Internet du Point.
La juge Marie-Odile Bertella-Geffroy du pôle santé publique de Paris instruit depuis juillet 2007 une information judiciaire pour "tromperie sur les qualités substantielles et sur l'origine d'un produit, tromperies aggravées sur les risques pour la santé humaine, mise en vente de denrées corrompues et mise sur le marché de produits d'origine animale préjudiciables à la santé".
L'affaire avait débuté fin novembre 2006 avec la découverte lors d'un contrôle des services vétérinaires de viandes impropres à la consommation humaine dans l'usine de Covi à Cholet.
Environ 650 000 boîtes de corned beef de cette société avaient été rappelées en France et 550 000 autres consignées en France et dans quatre autres pays européens (Grèce, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande) à la suite de ce contrôle.
Cancers : les pesticides sur la sellette ? Deux associations, l’Alliance Santé Environnement et le Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations futures, lancent une campagne visant à renforcer la réglementation relative à l’utilisation des pesticides, insecticides et autres fongicides.
« En Europe, chaque année, au minimum un cancer diagnostiqué sur cent peut être directement imputable à l’exposition aux pesticides », rappellent-elles.
La campagne Pesticides et Cancers s’articule autour de plusieurs objectifs. Plus spécifiquement, elle vise les responsables politiques. Les deux associations militent en effet pour l’interdiction des pesticides reconnus ou simplement suspectés d’être néfastes pour la santé. Elles recommandent par ailleurs, « la mise en place de stratégies de santé publique et de plans cancer nationaux où la réduction de l’exposition aux pesticides serait une mesure de prévention primaire » .
Autres ambitions, informer et sensibiliser le public. « Nous souhaitons accroître l’information du public sur les liens entre pesticides et cancers, et mobiliser les citoyens ». Rappelons que les effets des pesticides sur la santé ont déjà fait l’objet d’études très sérieuses en France. Notamment auprès des agriculteurs. Avec des résultats très préoccupants. Par ailleurs, les pesticides sont également au cœur d’un colloque organisé le 25 novembre à Paris au Ministère de l’Ecologie, dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne sur le thème Environnement chimique, reproduction et développement de l’enfant.
Des suppléments de vitamines C et E, ce n’est pas la panacée !
Près de 15 000 médecins de sexe masculin suivis pendant 10 ans. Et une conclusion lapidaire : la supplémentation quotidienne en vitamines C et E ne protège pas contre les risques de cancers. De la prostate notamment...
Dans le cadre de la Physicians’ Health Study, le Dr Howard Sesso et ses collègues de Boston ont suivi pendant 10 ans donc, 15 000 confrères âgés de 50 ans et plus au début de l’enquête. Les participants ont pris quotidiennement, soit des gélules de vitamine C (500mg) et E ou un placebo.
« Au bout de 10 ans de suivi, nous n’avons trouvé aucune preuve permettant de conclure qu’une telle supplémentation apporte un bénéfice en termes de prévention des cancers, notamment de la prostate » explique l’auteur. Inutile donc de se jeter sans avis médical sur ces compléments alimentaires. D’autant, comme le conclut Michael Gaziano, co-auteur de ce travail : « Il est vrai que plusieurs travaux antérieurs ont montré les bénéfices d’un régime alimentaire riche en vitamine C et E. Il semble toutefois que ces vitamines prises dans le cadre d’une supplémentation n’aient pas les mêmes avantages que celles des aliments ».
Cancer de la vessie : diagnostiqué plus vite, mieux traité
Gagner du temps au diagnostic, c’est essentiel pour prendre les cancers de vitesse. Quels qu’ils soient.
Une nouvelle méthode d’examen de la vessie récemment présentée à Paris, permet de colorer préférentiellement les cellules malignes. Cette « cystoscopie en lumière bleue » favoriserait la prise en charge de pratiquement 20% des patients.
Ce n’est pas rien. On en compte dans le monde près de 350 000 chaque année. En France avec près de 10 000 nouveaux cas par an, cette maladie est au 7ème rang des cancers. Le cancer de la vessie enfin, est le 2ème cancer urinaire après celui de la prostate.
Si 82% des malades se recrutent parmi les hommes, c’est peut-être parce que les facteurs de risque –tabac et vapeurs industrielles- étaient jusque-là des apanages majoritairement masculins. Il est notoire par ailleurs, que les hommes se prêtent moins volontiers au dépistage systématique... Pourtant dès les premiers symptômes –besoins impérieux d’uriner, urines foncées ou rouges traduisant la présence de sang…- il est indispensable de consulter.
L’examen de référence pour affirmer ou éliminer le diagnostic de cancer vésical est la cystoscopie. Il consiste à glisser un endoscope extrêmement fin jusque dans la vessie en passant par les voies naturelles. Présentée à Paris par le Pr Didier Jacqmin (Hôpital universitaire de Strasbourg ) et testée par 19 centres d’exploration urinaires en Europe, la cystoscopie en lumière bleue aurait permis d’améliorer de 30% le taux de diagnostics positifs, qui échappaient à l’approche conventionnelle en lumière blanche (photo). Grâce à cela, 1 patient sur 5 atteint de tumeur confirmée, a pu bénéficier d’une prise en charge améliorée.
PENURIE DE PERSONNELS HOSPITALIERS ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Le 20 Novembre 2008 - (Infirmiers.com) : Pour faire face à la pénurie de soignants et améliorer l'atractivité des métiers hospitaliers, des délégations régionales de l'Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH) expériementent un dispositif de d’Amélioration des Conditions de Travail dans les Etablissements de Santé
Communiqué de presse de l'ANFH
Pénurie de personnels hospitaliers : Comment séduire par les conditions de travail ?
Le point sur le dispositif expérimenté en Languedoc-Roussillon et PACA
Le secteur sanitaire et social public fait face à une vague de départs à la retraite sans précédent. Dans un contexte de concurrence avec le secteur privé, la question de l’attractivité des métiers hospitaliers et médico-sociaux publics est désormais un enjeu majeur pour assurer le renouvellement des effectifs. Pour répondre à cette problématique, les délégations régionales ANFH* Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur expérimentent depuis 2007 un projet appelé PACTES (Projet d’Amélioration des Conditions de Travail dans les Etablissements de Santé). Elles proposent ainsi un programme de formation-action et d’audits destinés à améliorer les conditions de travail des personnels soignants de la fonction publique hospitalière. Réunis à Tarascon le 22 octobre prochain, les représentants des établissements adhérents (Cf. liste ci-dessous) effectuent un premier bilan d’étape du projet PACTES.
Projet expérimental PACTES en région Languedoc-Roussillon et PACA
Si les deux régions sont particulièrement attractives, les départs à la retraite et le coût de l’immobilier notamment génèrent de réelles difficultés pour conserver et attirer des professionnels dans la Fonction Publique compte tenu de leur niveau de rémunération. Le besoin en IDE (infirmiers diplômés d’Etat) est très important et l’appareil de formation initiale reste insuffisant pour répondre au renouvellement générationnel.
Afin de répondre à la pénurie de personnel, les instances de l’ANFH Languedoc-Roussillon et PACA ont décidé de renforcer l’attractivité du secteur hospitalier public en améliorant les conditions de travail. Le projet PACTES s’attache à agir en ce sens sur trois champs :
• la réduction des troubles musculo-squelettiques,
• la prévention des troubles psychologiques,
• la reconnaissance des compétences.
Un audit « ergonomie » pour réduire les troubles musculo-squelettiques
La réduction des troubles musculo-squelettiques doit agir sur plusieurs dimensions de la vie de l’hôpital : l’équipement, l’architecture des bâtiments et le management des équipes. Equipements adaptés aux contraintes professionnelles (sièges assis-debout, rangement ergonomique), architecture orientée pour répondre aux besoins des personnels, choix intégrant la sécurité des agents (revêtements de sol faiblement glissants), la prise en compte de ces éléments nécessite le soutien des cadres.
Pour répondre à ces enjeux, le dispositif PACTES prévoit un audit « ergonomie » par établissement, la formation d’un référent et un accompagnement à la mise en œuvre d’une activité physique pour créer les conditions d'une application dans les quotidiens de travail.
Un consultant à disposition pour prévenir les troubles psychologiques
La prévention des troubles psychologique nécessite de concilier de façon équilibrée vie professionnelle et vie personnelle. Le dispositif PACTES active en ce sens trois leviers :
• l’aménagement des horaires de travail permettant d’adapter ou de compenser les horaires les plus incompatibles avec la vie personnelle,
• le respect des risques chronobiologiques favorisant la compensation des pénibilités spécifiques,
• l’association des agents à la détermination des plannings afin de réduire les changements de dernière minute et de favoriser le chevauchement entre équipes successives.
Le dispositif PACTES propose l’intervention d’un consultant pour prendre en compte les deux derniers leviers.
Former des tuteurs et des chefs de projet pour mettre en valeur les compétences
Six paramètres sont identifiés pour reconnaître les compétences :
• démontrer que les pratiques et le soignant, en tant que personne, sont appréciés à leur juste valeur, notamment lors de temps de discussion pour construire collectivement et en multidisciplinaire des pratique et des méthodes.
• l’organisation du travail doit favoriser le partage des connaissances de façon pluridisciplinaire tout en préservant les territoires de compétences propres à chaque métier.
• l’autonomie professionnelle
• l’influence des patients sur l’organisation des soins (comment les réaliser, le meilleur moment…)
• le développement de la recherche infirmière et la production d’un savoir sur les pratiques de nursing et d’éducation,
• le développement des postes de soignant référent, tuteur et expert pour les professionnels expérimentés et reconnus par leurs pairs (le tutorat aide-soignant peut être expérimenté aussi bien que le tutorat infirmier).
Le dispositif PACTES se propose de répondre à ces questions en formant des tuteurs, et en accompagnant la mise en œuvre du tutorat dans les établissements via la formation des chefs de projets.
Une démarche méthodologique adaptée
Si les conditions de travail ne relèvent pas, a priori, des missions d’un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), l’ANFH a cependant été reconnue porteur de projet par les trente établissements participants, notamment grâce à la place centrale qu’elle occupe au sein de la communauté hospitalière. Atout précieux pour piloter les dimensions « réseau» du projet, cette place de coordinateur permet de générer des synergies entre établissements et de favoriser des actions correctrices reproductibles qui seront évaluées.
Au sein des établissements adhérents, un référent dédié au projet est désigné, garant de l’implication et de l’adaptation des actions aux problématiques spécifiques des établissements.
Les actions proposées sont à la carte : les établissements peuvent mettre en œuvre le ou les volets d’actions qu’ils souhaitent au regard du contexte dans lequel ils évoluent et de leurs priorités.
Le projet PACTES en chiffres :
• 90 acteurs du projet réunis à Tarascon le 22 octobre (représentants des établissements, partenaires, prestataires, Comité de Pilotage, équipe projet).
• 27 établissements dans le projet employant plus de 48 000 agents.
• Près de 3 000 agents sont directement concernés par les actions menées, soit 6% de l'effectif global.
• 230 personnes participeront aux formations pour un total de 1600 journées.
• 2800 IDE sont diplômés par an sur les deux régions alors que le besoin est estimé à au moins 3000 pour tout le secteur.
• 20 000 IDE travaillent aujourd’hui dans les établissements publics des 2 régions et le besoin existe tant dans le secteur médico-social que sanitaire.
• Le projet PACTES représente un investissement de 840 000 euros.
SECURITE SOCIALE
Le Sénat adopte à son tour le budget de la Sécu
Les groupes UMP et du Nouveau centre (NC) ont voté pour. Les groupes socialiste, radical et citoyen (SRC) et de la gauche démocrate et républicaine (GDR, PC et Verts) ont voté contre
Le Sénat a adopté à son tour, jeudi 20 novembre, après les députés, le projet de budget de la Sécu pour 2009 marqué par un déficit aggravé par la crise. Les députés avaient voté le texte le 4 novembre dernier.
Ce texte, composé de près d'une centaine d'articles sur lesquels ont été déposés environ 650 amendements, prévoit de contenir le déficit des comptes sociaux à 8,6 milliards d'euros grâce à un plan de redressement de 6 milliards d'euros. Il entend poursuivre "l'effort de redressement" de la Sécu, en faisant des économies, des transferts de ressources et de nouvelles recettes dont 1 milliard d'euros de taxe sur les complémentaires santé (mutuelles ou assurances privées). Il met également en place un "forfait social" de 2% à la charge des employeurs.
La psychiatrie française va de plus en plus mal
Comme en boomerang, l'affaire réveille toutes les plaies de la psychiatrie. Le meurtre d'un jeune homme en pleine rue, mercredi 12 novembre, par un patient schizophrène échappé de l'hôpital psychiatrique de Grenoble, a secoué les équipes soignantes en santé mentale. Comme après l'affaire du double meurtre de Pau, en 2004, commis par un ancien patient de l'hôpital psychiatrique de la ville, médecins et soignants témoignent de la crise profonde de leur discipline. "On ne parle de la psychiatrie que quand il y a des faits divers, s'alarme Séverine Morio, infirmière à l'hôpital parisien Maison-Blanche. Mais c'est toute l'année que nous sommes en difficulté. On organise les ruptures de soin en faisant sortir trop tôt les patients, et ensuite on s'étonne qu'il y ait des passages à l'acte..."
Le drame de Grenoble intervient dans un contexte de crise latente, les appels à la grève se multipliant dans les services de psychiatrie. A l'hôpital de la Conception à Marseille, une équipe a observé un mois d'arrêt de travail, en octobre, pour refuser l'arrivée d'un patient réputé très violent ; le 6 novembre, une centaine de salariés de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, à Lyon, ont débrayé pour protester contre l'agression d'une infirmière par un patient qui ne voulait pas sortir de l'hôpital ; mardi 18 novembre, des soignants des hôpitaux parisiens de Sainte-Anne, Esquirol et Maison-Blanche observaient également une grève pour "lancer l'alerte sur la dégradation de la psychiatrie en France".
De fait, malgré l'effort consenti par l'Etat au titre du plan santé mentale 2005-2008 (plus d'1,5 milliard d'euros consacrés surtout aux rénovations d'établissement), les hôpitaux psychiatriques sont soumis à une forte contrainte financière.
En vingt ans, 50 000 lits d'hospitalisation ont été fermés, sans que les structures alternatives de prises en charge (appartements et centres d'accueil thérapeutiques) aient été ouvertes en compensation. Comme les hôpitaux généraux, les hôpitaux psychiatriques doivent répondre aux impératifs de gestion médico-économique, qui imposent de rentabiliser au maximum les lits disponibles : "Résultat, on pratique de plus en plus une psychiatrie de turnover, de portes tournantes", s'insurge Nadia Missaoui, syndicaliste CGT à Maison-Blanche.
Les soignants souffrent de ne plus pouvoir s'occuper suffisamment de leurs patients. "Le mot d'ordre, c'est des hospitalisations de plus en plus courtes, de quelques jours seulement, alors que les traitements mettent trois semaines à agir, explique Mme Morio. Du coup, on met dans la rue des patients pas encore stabilisés et qui ne savent pas où aller." Il n'est pas rare que les soignants retrouvent leurs patients sur le trottoir, alcoolisés et délirants... avant qu'ils ne décompensent à nouveau et soient renvoyés à l'hôpital. "Le matin, on est rivés à nos plannings pour savoir quel patient on va pouvoir faire sortir parce qu'il y en a trois qui attendent dans le couloir, dénonce Agnès Cluzel, de l'hôpital Bichat. Et quand ils sortent, ils n'ont souvent que le numéro du SAMU social dans la main."
En face, les familles ont souvent un sentiment d'abandon. "Beaucoup de malades mentaux sont hors de tout soin, s'alarme Anne Poiré, écrivain, auteur d'Histoire d'une schizophrénie, Jérémy, sa famille, la société (éd. Frison-Roche). Les patients viennent d'eux-mêmes à l'hôpital et on ne les soigne pas. On est dans une situation de déni de soin et de non-assistance à personne en danger." Mme Poiré relate le cas d'une jeune femme qui avait fait une bouffée délirante. Sortie contre son gré de l'hôpital public, elle s'est présentée dans une clinique privée qui a refusé de la prendre et l'a renvoyée vers l'hôpital d'où elle venait. Sur le chemin, elle s'est suicidée.
Dans ce contexte, l'annonce par Nicolas Sarkozy, au lendemain du drame de Grenoble, d'un durcissement de la loi de 1990 sur l'hospitalisation sans consentement est perçue avec inquiétude par les soignants. Le président de la République veut créer un fichier des personnes hospitalisées d'office et durcir leurs conditions de sortie. "Nous sommes tous favorables à une réforme, mais nous refusons l'exploitation éhontée d'un fait divers pour servir la cause sécuritaire, s'insurge Norbert Skurnik, président du Syndicat des psychiatres de secteur. Qu'une population aussi inoffensive que les schizophrènes soit stigmatisée est inadmissible : ce sont nos patients qui sont en danger par manque de soins, pas l'inverse !"
Pourtant, la psychiatrie est loin de rester sourde aux injonctions sécuritaires. Confrontées à des patients agressifs du fait d'un défaut de prise en charge, les équipes recourent de plus en plus à la contention et aux chambres d'isolement. A côté des cinq unités pour malades difficiles (UMD), réservées pour des séjours de six à douze mois, se créent aujourd'hui des unités de soins intensifs psychiatriques (USIP) pour de plus courts séjours : l'hôpital recrée en son sein les murs qu'il a tenté d'abolir au début des années 1980.
"On est dans le paradoxe permanent, explique Serge Klopp, cadre infirmier. Au nom de la désinstitutionnalisation, on a fermé les lits et on nous dit aujourd'hui qu'il faut enfermer les plus dangereux. Alors on multiplie les placements en chambre d'isolement, parce qu'on n'a pas le temps de les soigner quand ils sont en crise. Comme on ne peut plus contenir l'angoisse du psychotique par une présence rassurante, ils passent à l'acte beaucoup plus souvent. Résultat, on est dans le rapport de force et la gestion de la violence." Entre sa mission de soin et l'impératif de sécurité qui s'impose à elle, la psychiatrie se débat de plus en plus dans les injonctions contradictoires.
Un test rapide pour dépister le sida en 2009
Aides lancera, courant 2009, une campagne de dépistage rapide du sida menée par des volontaires de l'association. Le but est de sensibiliser une grande partie de la population qui ignore encore sa séropositivité.
Des tests de dépistage rapide du sida, permettant de savoir en une demi-heure si on est contaminé ou pas, vont être expérimentés en France auprès d'un millier d'homosexuels par des bénévoles de l'association Aides, dans le cadre d'un programme de recherche.
Lors d'une conférence de presse à Paris, la ministre de la santé Roselyne Bachelot a rappelé que malgré cinq millions de dépistage par an "des dizaines de milliers de personnes ignorent leur séropositivité". De fait, selon les estimations, quelque 36000 personnes séropositives n'ont pas connaissance de leur infection ou ne se font pas suivre médicalement, et un tiers des séropositifs sont dépistés à un stade avancé de l'infection, rendant l'efficacité du traitement plus aléatoire.
Des tests réalisés par des volontaires
La loi française ne reconnaît pas le droit à des acteurs non médicaux de réaliser des tests de dépistage, mais la Haute autorité de santé a estimé le mois dernier que les tests rapides constituaient "un outil complémentaire intéressant au modèle classique de dépistage" et proposé la mise en place de projets de recherche "comportant une évaluation structurée".
L'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) lance une étude sur le dépistage, coordonnée par le Pr Yazdan Yazdanpanah, qui doit évaluer sur deux ans la pertinence de tests rapides non-médicalisés dans la communauté homosexuelle, avec l'association Aides.
A ce jour, tous les tests de dépistage du VIH en France sont réalisés par des personnels médicaux ou para-médicaux. Pour cette expérimentation, les tests seront conduits dans les locaux de Aides, par des volontaires de l'association spécialement formés.
Ces tests rapides existent dans d'autres pays -Suisse, Grande-Bretagne, Canada, Etats-Unis...- mais y sont effectués par des personnels médicaux, selon Bruno Spire. La mise en oeuvre par des associations ne prévaut selon lui semble-t-il qu'à Barcelone, où les centres de dépistage n'existent pas. "On est plutôt en pointe", dit Jean-Marie Le Gall (Aides). Le milieu associatif "devient acteur à part entière de la recherche", s'est réjoui Jean-François Delfraissy, directeur de l'ANRS.
Un millier de tests
Les villes cibles sont Montpellier, puis Lille (février 2009), Bordeaux (avril 2009) et Paris (début du deuxième semestre 2009). Au total, un millier de tests y seront effectués par un simple prélèvement de sang au doigt, comme pour les diabétiques. La fiabilité des tests, limitée dans les trois premiers mois après la contamination, devient très comparable ensuite à celle des tests médicaux classiques, selon le Pr Yazdanpanah.
Toute séropositivité découverte par le test rapide devra en tout état de cause être confirmée par un test classique, administré par un personnel médical.
Le test rapide sera suivi par une action de soutien et de conseils de prévention de la part des associations. "L'accompagnement et l'écoute, on le fait depuis 25 ans", a noté Bruno Spire, chercheur à l'Inserm et président de Aides, pour qui cette expérimentation devrait prouver que "les profanes de Aides sont capables d'attirer les personnes vers plus de prévention, et de les accompagner". Pour lui, cela permettra aussi aux chercheurs de "mieux comprendre les besoins de ceux qui sont exposés".
L'ANRS va aussi lancer toute une gamme d'études sur la prévention et le dépistage du sida, notamment sur l'utilisation des tests rapides dans les services d'urgence des hôpitaux.
Première greffe de trachée sans traitement post-opératoire
Le site de la revue médicale anglaise, The Lancet, a publié la description de la première greffe de trachée sans traitement à vie contre le rejet de l'organe greffé.
Une jeune mère colombienne de 30 ans, Claudia Castillo, souffrant de problèmes respiratoires, a bénéficié de la première greffe de trachée sans avoir besoin de prendre des médicaments immunosuppresseurs et pu ainsi retrouver une vie normale, selon une équipe internationale européenne.
Cette transplantation faite le 12 juin 2008 à Barcelone (Espagne), fondée sur l'utilisation de la trachée d'un donneur et de cellules souches adultes provenant de la jeune femme, est décrite mercredi en ligne dans la revue médicale britannique The Lancet par les équipes de Barcelone, de Padoue et de Milan (Italie) et de l'université de Bristol (Grande-Bretagne).
Après quatre ans d'errance de consultation en consultation, Claudia Castillo, victime d'une tuberculose trop tardivement diagnostiquée, a ainsi trouvé une solution à ses problèmes respiratoires. En mars, elle était devenue incapable de prendre soin de ses deux enfants ou d'effectuer de simples tâches domestiques.
Les dégâts sur sa bronche principale gauche sont tels qu'il ne lui reste que l'option classique de l'ablation du poumon gauche.
"Heureuse d'être guérie"
Pour éviter cette opération mutilante risquée, le professeur Paolo Macchiarini, spécialiste de chirurgie thoracique à Barcelone (Hospital Clinico de Barcelona) et ses collègues décident, avec l'aval des comités d'éthiques concernés, de tenter cette greffe d'un nouveau genre.
Sept centimètres de trachée d'une femme de 51 ans, décédée d'une hémorragie cérébrale, sont préalablement débarrassés de toutes ses cellules, afin de ne pas provoquer de rejet, une fois transplantés. On prélève alors sur la patiente colombienne des cellules souches de moelle osseuse : des cellules mésenchymateuses, capables de donner des cellules de cartilages ("chondrocytes"). D'autres cellules (des "cellules épithéliales") sont par ailleurs prises sur une partie saine de sa trachée. Ensuite, la trachée du donneur est placée dans un appareil, un "bioréacteur" spécialement conçu à cet effet, où on la fait tourner avec les cellules de la patiente. Ainsi l'organe est colonisé par les cellules de la future receveuse. Ce qui a permis d'éviter le traitement à vie contre le rejet de l'organe greffé.
Dix jours après la greffe, Claudia sortait de l'hôpital. Depuis, elle va bien et est désormais capable de monter deux étages ou de marcher 500 mètres sans s'arrêter et, peut-être plus important, de s'occuper de ses enfants, selon ses médecins. Elle se réjouit de "pouvoir profiter à nouveau de la vie" et se dit "heureuse d'être guérie".
Cette innovation en médecine pourrait bénéficier à d'autres maladies des voies respiratoires supérieures (déformation congénitale, certaines tumeurs, etc.) ne pouvant bénéficier de la chirurgie classique, selon l'université Barcelone.
Toutefois, pour une meilleure évaluation de ces résultats, un suivi médical sur des périodes plus longues apparaissent nécessaires, estiment deux Japonais, les docteurs Toshihiko Sato et Tatsuo Nakamura, de l'université de Kyoto, dans Lancet. La première transplantation de trachée avec donneur a été décrite dans la même revue en 1979.
Infertilité masculine: le "mâle" du siècle
Le nombre de spermatozoïdes a diminué de moitié en un demi-siècle. Une infertilité masculine qui met en péril de don de sperme. En cause, l'environnement chimique dont la nocivité est prouvée pour certains, supposée pour d'autres.
Dans un environnement saturé de chimie, les difficultés de reproduction et les malformations génitales chez les hommes sont désormais suffisamment avérées pour justifier d'alerter la population et de mobiliser les chercheurs.
De nombreuses études européennes et américaines ont fait apparaître une diminution de moitié du nombre de spermatozoïdes en 50 ans, tandis qu'augmentait le nombre de cancers des testicules -qui se développent généralement chez les jeunes hommes- et les malformations génitales chez les petits garçons.
Un colloque sur le thème "Environnement chimique, reproduction et développement de l'enfant", organisé mardi prochain par la secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, doit permettre un partage d'experiences entre scientifiques européens. Le soir du colloque, la chaîne franco-allemande Arte diffusera à 21h00 le film enquête "Mâles en péril" sur le sujet, suivi d'un débat.
"Féminisation"
"Il y a ceux qui disent qu'on ne sait pas tout et qu'il vaut mieux ne pas en parler et ceux, dont moi, qui considèrent qu'on en sait suffisamment et que plus on en parle, plus on fait avancer la connaissance et la prévention", a résumé Nathalie Kosciusko-Morizet mardi devant la presse.
En ligne de mire: les phtalates et le Bisphénol-A, des substances omniprésentes au quotidien, utilisées pour assouplir les plastiques, qui agissent comme des hormones féminines et sont considérés comme des "pertubateurs endocriniens".
"Les mécanismes sont différents mais le résultat est le même: une féminisation", explique le Pr Bernard Jégou, président du conseil scientifique de l'Inserm.
"Et ce n'est pas seulement l'individu exposé qui est concerné, mais aussi la génération suivante", insiste-t-il: "Nous sommes porteurs de l'exposition de nos arrières grands-parents aux perturbateurs endocriniens".
Moins de 350 hommes se sont présentés en 2006 pour un don de spermatozoïdes, pas assez pour répondre aux besoins, a souligné jeudi l'Agence de la biomédecine qui veut sensibiliser à ce don très intime, seule chance pour certains couples de donner naissance à un enfant.
"Trou noir"
A ce jour, indique-t-il, les études n'ont été conduites que dans les pays du nord et ont fait apparaître "un déclin avéré des spermatozoïdes dans les grandes villes comme Paris ou Edimbourg, avec une grande variabilité d'une région à l'autre". En France, Lille est ainsi mieux lotie que Toulouse.
Mais pour l'Afrique, l'Amérique Latine et la majorité de l'Asie, "c'est le trou noir".
Pendant des décennies, les Etats ont laissé s'installer sur le marché des produits dont ils n'avaient pas les moyens de financer les tests pour s'assurer de leur inocuité. Aujourd'hui, le règlement européen Reach oblige les industriels à enregistrer leurs molécules et à prouver leur inocuité, ce qui permettra à terme de dire "quelles sont celles qui posent problème".
La secrétaire d'Etat à l'Ecologie constate que "le monde politique a évolué sur le sujet et fait plus facilement place au doute".
Présidente du groupe parlementaire Santé et Environnement, en 2006, Nathalie Kosciusko-Morizet avait peiné à convoquer une journée de débats sur le sujet: l'industrie, hostile, avait trouvé à l'Assemblée de nombreux relais pour contrer son action.
"C'est aujourd'hui plus facile comme ministre que comme député", s'amuse-t-elle.
Elle est soutenue par le ministère de la Santé: Roselyne Bachelot devrait annoncer lors du colloque de mardi des mesures d'information en direction du grand public, surtout des femmes enceintes, a indiqué Didier Houssin, Directeur général de la Santé au ministère.
Même s'il continue de penser "qu'il est difficile de mettre l'accent sur des produits sur lesquels un doute subsiste, alors qu'il n'y a que des certitudes sur l'effet nocif du tabac et de l'alcool", M. Houssin admet qu'il convient d'adopter "une vision large des risques".
Cinq mises en examen dans l'affaire du corned-beef avarié
Le secteur de l'agroalimentaire est fortement touché par cinq mises en examen -dont celles des groupes Charal et Soviba- pour "tromperie aggravée", dans le cadre d'une enquête sur de la viande avariée qui a commencé en 2006.
Cinq sociétés du secteur agroalimentaire, dont les groupes Charal et Soviba, ont été récemment mises en examen pour "tromperie aggravée" dans le cadre d'une enquête sur des stocks de viandes avariées en boite découvertes à la société Covi à Cholet (Maine-et-Loire), a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Parmi les autres mis en examen figurent les sociétés Covi, Arcadie, et Desial, selon le site Internet du Point.
La juge Marie-Odile Bertella-Geffroy du pôle santé publique de Paris instruit depuis juillet 2007 une information judiciaire pour "tromperie sur les qualités substantielles et sur l'origine d'un produit, tromperies aggravées sur les risques pour la santé humaine, mise en vente de denrées corrompues et mise sur le marché de produits d'origine animale préjudiciables à la santé".
L'affaire avait débuté fin novembre 2006 avec la découverte lors d'un contrôle des services vétérinaires de viandes impropres à la consommation humaine dans l'usine de Covi à Cholet.
Environ 650 000 boîtes de corned beef de cette société avaient été rappelées en France et 550 000 autres consignées en France et dans quatre autres pays européens (Grèce, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande) à la suite de ce contrôle.
Cancers : les pesticides sur la sellette ? Deux associations, l’Alliance Santé Environnement et le Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations futures, lancent une campagne visant à renforcer la réglementation relative à l’utilisation des pesticides, insecticides et autres fongicides.
« En Europe, chaque année, au minimum un cancer diagnostiqué sur cent peut être directement imputable à l’exposition aux pesticides », rappellent-elles.
La campagne Pesticides et Cancers s’articule autour de plusieurs objectifs. Plus spécifiquement, elle vise les responsables politiques. Les deux associations militent en effet pour l’interdiction des pesticides reconnus ou simplement suspectés d’être néfastes pour la santé. Elles recommandent par ailleurs, « la mise en place de stratégies de santé publique et de plans cancer nationaux où la réduction de l’exposition aux pesticides serait une mesure de prévention primaire » .
Autres ambitions, informer et sensibiliser le public. « Nous souhaitons accroître l’information du public sur les liens entre pesticides et cancers, et mobiliser les citoyens ». Rappelons que les effets des pesticides sur la santé ont déjà fait l’objet d’études très sérieuses en France. Notamment auprès des agriculteurs. Avec des résultats très préoccupants. Par ailleurs, les pesticides sont également au cœur d’un colloque organisé le 25 novembre à Paris au Ministère de l’Ecologie, dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne sur le thème Environnement chimique, reproduction et développement de l’enfant.
Des suppléments de vitamines C et E, ce n’est pas la panacée !
Près de 15 000 médecins de sexe masculin suivis pendant 10 ans. Et une conclusion lapidaire : la supplémentation quotidienne en vitamines C et E ne protège pas contre les risques de cancers. De la prostate notamment...
Dans le cadre de la Physicians’ Health Study, le Dr Howard Sesso et ses collègues de Boston ont suivi pendant 10 ans donc, 15 000 confrères âgés de 50 ans et plus au début de l’enquête. Les participants ont pris quotidiennement, soit des gélules de vitamine C (500mg) et E ou un placebo.
« Au bout de 10 ans de suivi, nous n’avons trouvé aucune preuve permettant de conclure qu’une telle supplémentation apporte un bénéfice en termes de prévention des cancers, notamment de la prostate » explique l’auteur. Inutile donc de se jeter sans avis médical sur ces compléments alimentaires. D’autant, comme le conclut Michael Gaziano, co-auteur de ce travail : « Il est vrai que plusieurs travaux antérieurs ont montré les bénéfices d’un régime alimentaire riche en vitamine C et E. Il semble toutefois que ces vitamines prises dans le cadre d’une supplémentation n’aient pas les mêmes avantages que celles des aliments ».
Cancer de la vessie : diagnostiqué plus vite, mieux traité
Gagner du temps au diagnostic, c’est essentiel pour prendre les cancers de vitesse. Quels qu’ils soient.
Une nouvelle méthode d’examen de la vessie récemment présentée à Paris, permet de colorer préférentiellement les cellules malignes. Cette « cystoscopie en lumière bleue » favoriserait la prise en charge de pratiquement 20% des patients.
Ce n’est pas rien. On en compte dans le monde près de 350 000 chaque année. En France avec près de 10 000 nouveaux cas par an, cette maladie est au 7ème rang des cancers. Le cancer de la vessie enfin, est le 2ème cancer urinaire après celui de la prostate.
Si 82% des malades se recrutent parmi les hommes, c’est peut-être parce que les facteurs de risque –tabac et vapeurs industrielles- étaient jusque-là des apanages majoritairement masculins. Il est notoire par ailleurs, que les hommes se prêtent moins volontiers au dépistage systématique... Pourtant dès les premiers symptômes –besoins impérieux d’uriner, urines foncées ou rouges traduisant la présence de sang…- il est indispensable de consulter.
L’examen de référence pour affirmer ou éliminer le diagnostic de cancer vésical est la cystoscopie. Il consiste à glisser un endoscope extrêmement fin jusque dans la vessie en passant par les voies naturelles. Présentée à Paris par le Pr Didier Jacqmin (Hôpital universitaire de Strasbourg ) et testée par 19 centres d’exploration urinaires en Europe, la cystoscopie en lumière bleue aurait permis d’améliorer de 30% le taux de diagnostics positifs, qui échappaient à l’approche conventionnelle en lumière blanche (photo). Grâce à cela, 1 patient sur 5 atteint de tumeur confirmée, a pu bénéficier d’une prise en charge améliorée.
maman d'une louloute de 7 ans
ESI 2009/2012 à Sète
ESI 2009/2012 à Sète
- virginieeva
- Fidèle

- Messages : 206
- Inscription : 29 mai 2008 13:37
Re: Actualités 2009
Actualités 21 novembre 2008
REFORME LMD : DUREE HORAIRE DE LA FORMATION INFIRMIERE. La formation infirmière serait-elle en danger ?
Certaines organisations le disent. Selon elles, le ministère de la Santé envisagerait la mise à mal du diplôme d’Etat d’infirmier et de sa reconnaissance européenne.
Pour la CFDT santé-sociaux, ce discours opportuniste et mensonger fait preuve d’une méconnaissance des évolutions en matière de formation.
De quoi s’agit-il ?
Le groupe de travail sur la réingénierie du diplôme d’Etat d’infirmier, qui s’est réuni le 30 septembre 2008, a proposé une diminution de la durée horaire de la formation infirmière, à 4 200 h (moitié pratique, moitié théorie).
Pour la CFDT santé-sociaux, cette évolution prendrait en compte toutes les compétences nécessaires à l’exercice professionnel et conserverait l’entrée dans le dispositif Licence Master Doctorat (LMD) de la profession infirmière.
La CFDT santé-sociaux est favorable à ce que la durée de la formation soit portée à 4 620 h, dont 420 h de temps de travail personnel étudiant.
Cette option de diminuer le nombre d’heures de la formation favorisera :
• Le maintien pour les étudiants d’une qualité optimale de formation, sans en allonger la durée et en augmenter le coût ;
• Le débouché plus précoce sur le marché du travail et dans une période plus propice pour obtenir un poste ou de premiers remplacements ;
• La possibilité d’octroyer plus de congés aux étudiants.
Sida : une greffe de moelle osseuse fait reculer le VIH chez un patientRésultat isolé mais peut-être porteur d'espoir : une équipe allemande rapporte que le VIH est devenu indétectable chez un patient séropositif après une greffe de moelle osseuse provenant d'un donneur résistant au virus. Réalisée pour soigner une leucémie, cette intervention ne sera jamais un traitement du Sida. Mais cette réussite désigne une piste déjà connue : celle du récepteur CCR5, une des portes d'entrée du VIH...
parmi les donneurs, figurait une personne naturellement résistante au virus du Sida.
Devant l'opportunité qui s'offrait à eux, les médecins berlinois ont choisi la moelle osseuse provenant de cette personne bénéficiant de la mutation Delta 32, sans savoir ce qui allait se passer. La suite des événements a été pour l'instant heureuse. Plus de vingt mois après l'intervention et donc l'arrêt du traitement antirétroviral, le VIH reste indétectable.
Personne ne sait ce qui explique cette absence ni si elle est définitive. Gero Hütter insiste pour expliquer que ce résultat ne doit pas susciter de faux espoirs ni faire croire qu'une greffe de moelle osseuse pourrait guérir ou même soigner le Sida. Cette intervention chirurgicale (lourde) a été menée pour traiter la leucémie du patient et il n'est pas imaginable d'en étendre la prescription aux victimes du Sida. Toutefois, cette réussite désigne clairement le récepteur CCR5 comme une bonne cible potentielle pour enrayer le développement de la maladie. De quoi conforter les explorateurs de la piste génétique...
Leur réussite n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une publication scientifique et ne constitue qu'une observation isolée.
Le patient, un homme de 42 ans, est séropositif depuis dix ans, sous traitement antirétroviral (qui freine la multiplication du virus du Sida, le VIH) et n'a jamais développé la maladie. Atteint d'une leucémie, il a été soigné par une greffe de moelle osseuse à l'hôpital berlinois. Mais une telle opération impose de suspendre le traitement aux antirétroviraux car il provoquerait un rejet du greffon.
REFORME LMD : DUREE HORAIRE DE LA FORMATION INFIRMIERE. La formation infirmière serait-elle en danger ?
Certaines organisations le disent. Selon elles, le ministère de la Santé envisagerait la mise à mal du diplôme d’Etat d’infirmier et de sa reconnaissance européenne.
Pour la CFDT santé-sociaux, ce discours opportuniste et mensonger fait preuve d’une méconnaissance des évolutions en matière de formation.
De quoi s’agit-il ?
Le groupe de travail sur la réingénierie du diplôme d’Etat d’infirmier, qui s’est réuni le 30 septembre 2008, a proposé une diminution de la durée horaire de la formation infirmière, à 4 200 h (moitié pratique, moitié théorie).
Pour la CFDT santé-sociaux, cette évolution prendrait en compte toutes les compétences nécessaires à l’exercice professionnel et conserverait l’entrée dans le dispositif Licence Master Doctorat (LMD) de la profession infirmière.
La CFDT santé-sociaux est favorable à ce que la durée de la formation soit portée à 4 620 h, dont 420 h de temps de travail personnel étudiant.
Cette option de diminuer le nombre d’heures de la formation favorisera :
• Le maintien pour les étudiants d’une qualité optimale de formation, sans en allonger la durée et en augmenter le coût ;
• Le débouché plus précoce sur le marché du travail et dans une période plus propice pour obtenir un poste ou de premiers remplacements ;
• La possibilité d’octroyer plus de congés aux étudiants.
Sida : une greffe de moelle osseuse fait reculer le VIH chez un patientRésultat isolé mais peut-être porteur d'espoir : une équipe allemande rapporte que le VIH est devenu indétectable chez un patient séropositif après une greffe de moelle osseuse provenant d'un donneur résistant au virus. Réalisée pour soigner une leucémie, cette intervention ne sera jamais un traitement du Sida. Mais cette réussite désigne une piste déjà connue : celle du récepteur CCR5, une des portes d'entrée du VIH...
parmi les donneurs, figurait une personne naturellement résistante au virus du Sida.
Devant l'opportunité qui s'offrait à eux, les médecins berlinois ont choisi la moelle osseuse provenant de cette personne bénéficiant de la mutation Delta 32, sans savoir ce qui allait se passer. La suite des événements a été pour l'instant heureuse. Plus de vingt mois après l'intervention et donc l'arrêt du traitement antirétroviral, le VIH reste indétectable.
Personne ne sait ce qui explique cette absence ni si elle est définitive. Gero Hütter insiste pour expliquer que ce résultat ne doit pas susciter de faux espoirs ni faire croire qu'une greffe de moelle osseuse pourrait guérir ou même soigner le Sida. Cette intervention chirurgicale (lourde) a été menée pour traiter la leucémie du patient et il n'est pas imaginable d'en étendre la prescription aux victimes du Sida. Toutefois, cette réussite désigne clairement le récepteur CCR5 comme une bonne cible potentielle pour enrayer le développement de la maladie. De quoi conforter les explorateurs de la piste génétique...
Leur réussite n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une publication scientifique et ne constitue qu'une observation isolée.
Le patient, un homme de 42 ans, est séropositif depuis dix ans, sous traitement antirétroviral (qui freine la multiplication du virus du Sida, le VIH) et n'a jamais développé la maladie. Atteint d'une leucémie, il a été soigné par une greffe de moelle osseuse à l'hôpital berlinois. Mais une telle opération impose de suspendre le traitement aux antirétroviraux car il provoquerait un rejet du greffon.
maman d'une louloute de 7 ans
ESI 2009/2012 à Sète
ESI 2009/2012 à Sète
- virginieeva
- Fidèle

- Messages : 206
- Inscription : 29 mai 2008 13:37
Re: Actualités 2009
Je vous joins un dossier sur le virus si ça intéresse quelqu'un.
Les virus amis ou ennemis ?
1) Les virus amis ou ennemis ?
Les virus nous côtoient depuis des milliers d’années et nous nous sommes tellement bien adaptés à certains d’entre eux, et réciproquement, que de nombreux virus nous infectent sans que nous nous en rendions compte.
D’autres sont de redoutables machines de guerre comme le virus de la grippe Espagnole qui sévit entre 1918 et 1919 et qui tua plus de personnes que la Grande Guerre. N’oublions pas que le terme « virus » vient du mot latin qui signifiait « poison ».
Mais limiter notre connaissance du monde des virus aux seuls virus pathogènes serait une erreur. En effet, l’étude de la « virosphère » pourrait nous renseigner sur l’origine même de la vie et l’émergence de la biodiversité sur notre planète.
2) La virologie est une discipline récente
Bien avant la découverte de leur existence, Hippocrate (460-370 avant JC) baptisait herpès le fameux « bouton de fièvre », alors qu’Aristote décrivait précisément les symptômes de la rage (384-322 avant JC).
Les virus ont également joué un rôle direct dans l’Histoire. Comme le virus de la variole qui a participé à la perte des Aztèques face aux conquistadores au XIVème siècle. Les virus sont des parasites obligatoires, ils pénètrent dans une cellule vivante pour se multiplier et semblent dénués de vie lorsqu’ils sont à l’extérieur d’une cellule. Mais les avis sont partagés à ce sujet (Saib, 2006).
Dès la fin du XIXème siècle, la bactériologie prenait son essor avec la caractérisation des micro-organismes, rendue possible grâce à la microscopie et aux techniques de culture bactériennes.
Louis Pasteur, Robert Koch et leurs élèves découvraient une multitude de bactéries isolées par l’étude des maladies infectieuses. Mais certains scientifiques avaient néanmoins du mal à isoler ces micro-organismes dans certaines pathologies que l’on savait pourtant infectieuses. Certains osèrent alors évoquer l’existence d’entités plus petites que les bactéries, totalement différentes de ces micro-organismes.
Faire accepter leur existence était quasiment mission impossible face à la bactériologie triomphante. Invisibles à l’œil nu, impossible à multiplier sur un milieu nutritif artificiel, contrairement aux bactéries, les virus existaient-ils réellement ou étaient-ils le fruit de l’imagination trop fertile de ces quelques scientifiques ?
Dans les années 30, le microscope électronique allait lever toute ambiguïté : les virus existaient bel et bien. Un nouveau monde invisible s’offrait aux chercheurs.
3) Les virus, de redoutables machines à tuer
Depuis la découverte des premiers virus au début du XXème siècle, de nombreux virus ont été isolés, infectant les organismes des trois règnes du vivant, les bactéries, les archées et les eucaryotes.
Nous savons aujourd’hui que les virus sont retrouvés dans tous les biotopes, toutes les latitudes.
Entre les années 50 et 70, avec la mise au point de la vaccination et surtout l’éradication de la variole de la surface de notre planète annoncée en 1980 par l’OMS, nous pensions maîtriser le monde viral. C’était mal les connaître.
En 1983 était isolé le virus du SIDA qui continue à faire parler de lui avec plus de 40 millions de personnes infectées en 2006, dont plus de la moitié en Afrique. Depuis, de nouveaux virus pathogènes sont apparus ou réapparaissent régulièrement et font la une des journaux. On connaît aujourd’hui une multitude de virus pathogènes, certains peuvent même induire des cancers . Même si notre système immunitaire arrive souvent à avoir raison d’eux, certains virus arrivent à déjouer nos défenses, alors que la variabilité de leur patrimoine génétique leur permet d’échapper aux traitements disponibles. Le combat paraît sans fin. Même la mise au point des trithérapies pour lutter contre le VIH ou ce nouveau vaccin qui semble prometteur pour la lutte contre les papillomavirus responsables du cancer du col de l’utérus (Lire à ce sujet notre actualité) constituent des armes limitées face aux virus.
Aussi, le rapport que nous entretenons avec les virus a toujours été celui d’une proie face à son prédateur. Bien sûr, les virus associés à une maladie, chez l’homme, l’animal ou le végétal, sont mis en évidence aisément. Aussi, notre connaissance du monde viral se résume principalement aux virus « pathogènes ». Comment mettre en évidence un virus qui n’induit pas de maladies ? Evoquons cet autre aspect du monde viral.
4) De l’utilité du virus : de la thérapie génique à la lutte anti-tumoraleLes virus ont joué un rôle important dans le développement de la biologie. Dans les années 50, l’étude des virus de bactéries, les bactériophages, a permis la naissance d’une nouvelle discipline, la biologie moléculaire. Celle-ci vise à comprendre les mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire. Elle s’attache en particulier à étudier les molécules porteuses de l’information génétique (ADN et ARN), les protéines produites à partir des gènes, et la relation entre ces trois types de molécules.
De nombreux mécanismes moléculaires qui régissent la cellule ont été découverts grâce à l’étude des virus. Ces derniers détournent à leur profit de très nombreuses machineries cellulaires, mais subissent également divers processus cellulaires.
La mise au point des techniques de génie génétique dans les années 70 a conduit à utiliser les virus comme transporteur de gènes. Paul Berg (Prix Nobel de Chimie en 1980) souhaitait utiliser le virus de singe SV40 comme cheval de Troie, capable de transporter un gène « médicament » dans l’organisme d’un personne atteinte d’une maladie génétique. Depuis, de nombreuses tentatives furent entreprises avec différents types de virus, avec plus ou moins de réussite. Il a fallu 30 ans pour voir le premier réel succès de la thérapie génique. En utilisant un rétrovirus de souris, l’équipe du Professeur Alain Fischer à l’Hôpital Necker Enfants-Malades réussit à corriger un défaut génétique grave. Les enfants atteints par cette anomalie possèdent un système immunitaire déficient et sont par conséquent condamnés à vivre dans une enceinte stérile. Ce sont les fameux bébés-bulles. Introduisant la copie du gène non muté dans les cellules déficientes, le défaut du système immunitaire de ces dernières a été corrigé et les enfants ont pu goutter à la liberté.
cependant, certains enfants ont déclaré des leucémies suite à ce traitement, démontrant qu’il reste encore du travail pour que ces approches soient généralisées.
Outre la thérapie génique, les virus peuvent également être utiles pour lutter contre les infections bactériennes. Félix d’Hérelle à l’Institut Pasteur de Paris, découvrait des virus de bactéries, les bactériophages (littéralement mangeurs de bactéries) pendant la première guerre mondiale. Ces virus pénètrent dans les bactéries et les détruient. Il pense aussitôt à les utiliser pour combattre les infections bactériennes. Mais la découverte des antibiotiques dans les années 20 va couper court au développement de la phagothérapie. C’est l’apparition de souches bactériennes résistantes aux antibiotiques qui nous amène à repenser la place des phages dans notre panoplie thérapeutique (Clark and March, 2006 ; Skurnik and Strauch, 2006).
De manière encore plus surprenante, il existe des virus qui se multiplient spécifiquement dans les cellules tumorales, conduisant inexorable à leur destruction. Il s’agit des virus oncolytiques. Une dizaine de virus sont actuellement à l’étude (Liu et al., 2007; Szelechowski and Saib, 2005).
Ainsi, les virus peuvent constituer d’excellents outils thérapeutiques au service de l’homme. Mais comme pour toute approche thérapeutique, il convient de connaître parfaitement l’outil utilisé. Par conséquent, l’étude approfondie des virus et de leurs interactions avec les cellules qu’ils infectent est indispensable pour éviter tout effet adverse ou du moins les limiter.
5) Les virus comme moteurs de l’évolutionOn estime qu’il existe sur notre planète près de 1031 particules virales différentes, une diversité infiniment supérieure à celle cumulée des organismes des trois règnes du vivant (Hamilton, 2006). Aujourd’hui, nous en connaissons quelques 10000 différents, c’est dire notre ignorance à leur égard. Les milieux marins concentrent une grande majorité de ces virus, principalement des bactériophages, encore inconnus, qui semblent jouer un rôle crucial dans les équilibres marins (Angly et al., 2006).
Parce que considérés comme objets inertes, on pensait que les virus ne jouaient aucun rôle dans l’évolution. Aujourd’hui, nous savons que les virus ont leur propre histoire évolutive remontant à l’origine même de la vie. Certains scientifiques affirment que les virus pourraient être à l’origine de l’apparition de la molécule d’ADN (Forterre, 2006; Whitfield, 2006 ) et même du noyau cellulaire (Pennisi, 2004).
Les virus inventent à tout moment de nouveaux gènes, de nouvelles fonctions, dont nous n’avons pas la moindre idée, mais qui constituent une source d’innovation génétique extraordinaire. A l’image des rétrovirus endogènes qui représentent 10% de notre patrimoine génétique et qui sont impliqués dans la formation de notre placenta (de Parseval and Heidmann, 2005). Les gènes viraux pourraient constituer une réserve de gènes susceptibles d’enrichir les génomes des organismes des trois règnes du vivant, alimentant leur propre évolution.
Le monde viral est extrêmement complexe et se limiter à l’étude des seuls virus pathogènes ne serait pas judicieux. L’étude de la « virosphère » pourrait nous renseigner sur l’origine même de la vie et l’émergence de la biodiversité sur notre planète.
Les virus amis ou ennemis ?
1) Les virus amis ou ennemis ?
Les virus nous côtoient depuis des milliers d’années et nous nous sommes tellement bien adaptés à certains d’entre eux, et réciproquement, que de nombreux virus nous infectent sans que nous nous en rendions compte.
D’autres sont de redoutables machines de guerre comme le virus de la grippe Espagnole qui sévit entre 1918 et 1919 et qui tua plus de personnes que la Grande Guerre. N’oublions pas que le terme « virus » vient du mot latin qui signifiait « poison ».
Mais limiter notre connaissance du monde des virus aux seuls virus pathogènes serait une erreur. En effet, l’étude de la « virosphère » pourrait nous renseigner sur l’origine même de la vie et l’émergence de la biodiversité sur notre planète.
2) La virologie est une discipline récente
Bien avant la découverte de leur existence, Hippocrate (460-370 avant JC) baptisait herpès le fameux « bouton de fièvre », alors qu’Aristote décrivait précisément les symptômes de la rage (384-322 avant JC).
Les virus ont également joué un rôle direct dans l’Histoire. Comme le virus de la variole qui a participé à la perte des Aztèques face aux conquistadores au XIVème siècle. Les virus sont des parasites obligatoires, ils pénètrent dans une cellule vivante pour se multiplier et semblent dénués de vie lorsqu’ils sont à l’extérieur d’une cellule. Mais les avis sont partagés à ce sujet (Saib, 2006).
Dès la fin du XIXème siècle, la bactériologie prenait son essor avec la caractérisation des micro-organismes, rendue possible grâce à la microscopie et aux techniques de culture bactériennes.
Louis Pasteur, Robert Koch et leurs élèves découvraient une multitude de bactéries isolées par l’étude des maladies infectieuses. Mais certains scientifiques avaient néanmoins du mal à isoler ces micro-organismes dans certaines pathologies que l’on savait pourtant infectieuses. Certains osèrent alors évoquer l’existence d’entités plus petites que les bactéries, totalement différentes de ces micro-organismes.
Faire accepter leur existence était quasiment mission impossible face à la bactériologie triomphante. Invisibles à l’œil nu, impossible à multiplier sur un milieu nutritif artificiel, contrairement aux bactéries, les virus existaient-ils réellement ou étaient-ils le fruit de l’imagination trop fertile de ces quelques scientifiques ?
Dans les années 30, le microscope électronique allait lever toute ambiguïté : les virus existaient bel et bien. Un nouveau monde invisible s’offrait aux chercheurs.
3) Les virus, de redoutables machines à tuer
Depuis la découverte des premiers virus au début du XXème siècle, de nombreux virus ont été isolés, infectant les organismes des trois règnes du vivant, les bactéries, les archées et les eucaryotes.
Nous savons aujourd’hui que les virus sont retrouvés dans tous les biotopes, toutes les latitudes.
Entre les années 50 et 70, avec la mise au point de la vaccination et surtout l’éradication de la variole de la surface de notre planète annoncée en 1980 par l’OMS, nous pensions maîtriser le monde viral. C’était mal les connaître.
En 1983 était isolé le virus du SIDA qui continue à faire parler de lui avec plus de 40 millions de personnes infectées en 2006, dont plus de la moitié en Afrique. Depuis, de nouveaux virus pathogènes sont apparus ou réapparaissent régulièrement et font la une des journaux. On connaît aujourd’hui une multitude de virus pathogènes, certains peuvent même induire des cancers . Même si notre système immunitaire arrive souvent à avoir raison d’eux, certains virus arrivent à déjouer nos défenses, alors que la variabilité de leur patrimoine génétique leur permet d’échapper aux traitements disponibles. Le combat paraît sans fin. Même la mise au point des trithérapies pour lutter contre le VIH ou ce nouveau vaccin qui semble prometteur pour la lutte contre les papillomavirus responsables du cancer du col de l’utérus (Lire à ce sujet notre actualité) constituent des armes limitées face aux virus.
Aussi, le rapport que nous entretenons avec les virus a toujours été celui d’une proie face à son prédateur. Bien sûr, les virus associés à une maladie, chez l’homme, l’animal ou le végétal, sont mis en évidence aisément. Aussi, notre connaissance du monde viral se résume principalement aux virus « pathogènes ». Comment mettre en évidence un virus qui n’induit pas de maladies ? Evoquons cet autre aspect du monde viral.
4) De l’utilité du virus : de la thérapie génique à la lutte anti-tumoraleLes virus ont joué un rôle important dans le développement de la biologie. Dans les années 50, l’étude des virus de bactéries, les bactériophages, a permis la naissance d’une nouvelle discipline, la biologie moléculaire. Celle-ci vise à comprendre les mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire. Elle s’attache en particulier à étudier les molécules porteuses de l’information génétique (ADN et ARN), les protéines produites à partir des gènes, et la relation entre ces trois types de molécules.
De nombreux mécanismes moléculaires qui régissent la cellule ont été découverts grâce à l’étude des virus. Ces derniers détournent à leur profit de très nombreuses machineries cellulaires, mais subissent également divers processus cellulaires.
La mise au point des techniques de génie génétique dans les années 70 a conduit à utiliser les virus comme transporteur de gènes. Paul Berg (Prix Nobel de Chimie en 1980) souhaitait utiliser le virus de singe SV40 comme cheval de Troie, capable de transporter un gène « médicament » dans l’organisme d’un personne atteinte d’une maladie génétique. Depuis, de nombreuses tentatives furent entreprises avec différents types de virus, avec plus ou moins de réussite. Il a fallu 30 ans pour voir le premier réel succès de la thérapie génique. En utilisant un rétrovirus de souris, l’équipe du Professeur Alain Fischer à l’Hôpital Necker Enfants-Malades réussit à corriger un défaut génétique grave. Les enfants atteints par cette anomalie possèdent un système immunitaire déficient et sont par conséquent condamnés à vivre dans une enceinte stérile. Ce sont les fameux bébés-bulles. Introduisant la copie du gène non muté dans les cellules déficientes, le défaut du système immunitaire de ces dernières a été corrigé et les enfants ont pu goutter à la liberté.
cependant, certains enfants ont déclaré des leucémies suite à ce traitement, démontrant qu’il reste encore du travail pour que ces approches soient généralisées.
Outre la thérapie génique, les virus peuvent également être utiles pour lutter contre les infections bactériennes. Félix d’Hérelle à l’Institut Pasteur de Paris, découvrait des virus de bactéries, les bactériophages (littéralement mangeurs de bactéries) pendant la première guerre mondiale. Ces virus pénètrent dans les bactéries et les détruient. Il pense aussitôt à les utiliser pour combattre les infections bactériennes. Mais la découverte des antibiotiques dans les années 20 va couper court au développement de la phagothérapie. C’est l’apparition de souches bactériennes résistantes aux antibiotiques qui nous amène à repenser la place des phages dans notre panoplie thérapeutique (Clark and March, 2006 ; Skurnik and Strauch, 2006).
De manière encore plus surprenante, il existe des virus qui se multiplient spécifiquement dans les cellules tumorales, conduisant inexorable à leur destruction. Il s’agit des virus oncolytiques. Une dizaine de virus sont actuellement à l’étude (Liu et al., 2007; Szelechowski and Saib, 2005).
Ainsi, les virus peuvent constituer d’excellents outils thérapeutiques au service de l’homme. Mais comme pour toute approche thérapeutique, il convient de connaître parfaitement l’outil utilisé. Par conséquent, l’étude approfondie des virus et de leurs interactions avec les cellules qu’ils infectent est indispensable pour éviter tout effet adverse ou du moins les limiter.
5) Les virus comme moteurs de l’évolutionOn estime qu’il existe sur notre planète près de 1031 particules virales différentes, une diversité infiniment supérieure à celle cumulée des organismes des trois règnes du vivant (Hamilton, 2006). Aujourd’hui, nous en connaissons quelques 10000 différents, c’est dire notre ignorance à leur égard. Les milieux marins concentrent une grande majorité de ces virus, principalement des bactériophages, encore inconnus, qui semblent jouer un rôle crucial dans les équilibres marins (Angly et al., 2006).
Parce que considérés comme objets inertes, on pensait que les virus ne jouaient aucun rôle dans l’évolution. Aujourd’hui, nous savons que les virus ont leur propre histoire évolutive remontant à l’origine même de la vie. Certains scientifiques affirment que les virus pourraient être à l’origine de l’apparition de la molécule d’ADN (Forterre, 2006; Whitfield, 2006 ) et même du noyau cellulaire (Pennisi, 2004).
Les virus inventent à tout moment de nouveaux gènes, de nouvelles fonctions, dont nous n’avons pas la moindre idée, mais qui constituent une source d’innovation génétique extraordinaire. A l’image des rétrovirus endogènes qui représentent 10% de notre patrimoine génétique et qui sont impliqués dans la formation de notre placenta (de Parseval and Heidmann, 2005). Les gènes viraux pourraient constituer une réserve de gènes susceptibles d’enrichir les génomes des organismes des trois règnes du vivant, alimentant leur propre évolution.
Le monde viral est extrêmement complexe et se limiter à l’étude des seuls virus pathogènes ne serait pas judicieux. L’étude de la « virosphère » pourrait nous renseigner sur l’origine même de la vie et l’émergence de la biodiversité sur notre planète.
maman d'une louloute de 7 ans
ESI 2009/2012 à Sète
ESI 2009/2012 à Sète
Question sur nouveau mode de financement des hopitaux
Bonjour,
J'ai lu dans un post sur l'oral 2008, le T2A nveau mode de financement des hopitaux? J'avoue que je suis bien l'actualité mais là je ne sais pas de quoi il s'agit. Qui peut m'expliquer? J'ai parfois l'impression en vous lisant que je suis loin derrière........
Merci pour vos réponses
J'ai lu dans un post sur l'oral 2008, le T2A nveau mode de financement des hopitaux? J'avoue que je suis bien l'actualité mais là je ne sais pas de quoi il s'agit. Qui peut m'expliquer? J'ai parfois l'impression en vous lisant que je suis loin derrière........
Merci pour vos réponses
Maman d'un petit trublion de 5 ans
Re: Actualités 2009
Ces médecins qui mettent en cause les génériques...
[21 novembre 2008 - 12:04]
Le vieux débat sur l’inefficacité supposée des médicaments génériques est remis à l’ordre du jour ce matin, dans les colonnes de notre confrère La Croix.
Des cardiologues, neurologues et autres praticiens hospitaliers affirment en effet constater des « problèmes d’efficacité et de tolérance avec ces copies de médicaments de marque. » Pour l’heure cependant, aucune étude « indépendante et incontestable » ne vient confirmer leurs propos.
Alors que les ventes de génériques ne cessent de progresser en France -un médicament vendu sur cinq en 2006 était un générique contre un sur huit en 2005 - quelques médecins assurent en effet avoir « des soucis » avec ces médicaments.
Et le quotidien de citer notamment, le Pr Yves Cotti, cardiologue au CHU de Dijon. Il assure que plusieurs de ses patients « qui étaient bien stabilisés ont vu leur fréquence cardiaque augmenter avec des génériques avant que tout rentre dans l’ordre avec la reprise du médicament original ». Un exemple parmi d’autres témoignages.
De son côté Jean Marimbert, Directeur général de l’Agence française de Sécurité sanitaire des Produits de Santé (AFSSaPS), rappelle que les génériques ne sont pas des « médicaments au rabais ». Il ajoute également, qu’ « ils sont surveillés de la même manière que les produits de marque. (…) Dans le domaine du médicament, on ne peut s’en tenir à des on-dit ou aux impressions de tel ou tel praticien » ajoute-t-il sévèrement. D’autant comme le confirme le Pr Jean-Paul Giroud, membre de l’Académie de médecine et du Conseil scientifique de Destination Santé, qu’ « on ne recense rien de probant dans la littérature internationale contre les génériques ».
Un débat instrumentalisé par des lobbies ?
En revanche, le Pr Giroud -au même titre que le Pr Jean-François Bergmann, chef du service de médecine interne à l’hôpital Lariboisière à Paris- met en avant « un aspect psychologique bien connu des pharmacologues ». Il explique en effet que chez un patient, « le simple fait de penser qu’un médicament va peut-être moins bien marcher peut entraîner une moindre efficacité thérapeutique ».
Quant à Gilles Bonnefond, président délégué de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’officine (USPO), il est tout bonnement furieux. « II n’y a qu’en France qu’on entend ces critiques rétrogrades. (…) Il s’agit d’un combat d’arrière-garde derrière lequel on peut penser que se trouve l’industrie pharmaceutique. (…) ». Même si l’auteur de cette enquête souligne que « les médecins qui se posent des questions sur les génériques se défendent d’être instrumentalisés », il paraît évident qu’à ce stade le subjectif tient une place prépondérante dans ce débat...
Source : La Croix, 21 novembre 2008 - Agence française de Sécurité sanitaire des Produits de Santé
[21 novembre 2008 - 12:04]
Le vieux débat sur l’inefficacité supposée des médicaments génériques est remis à l’ordre du jour ce matin, dans les colonnes de notre confrère La Croix.
Des cardiologues, neurologues et autres praticiens hospitaliers affirment en effet constater des « problèmes d’efficacité et de tolérance avec ces copies de médicaments de marque. » Pour l’heure cependant, aucune étude « indépendante et incontestable » ne vient confirmer leurs propos.
Alors que les ventes de génériques ne cessent de progresser en France -un médicament vendu sur cinq en 2006 était un générique contre un sur huit en 2005 - quelques médecins assurent en effet avoir « des soucis » avec ces médicaments.
Et le quotidien de citer notamment, le Pr Yves Cotti, cardiologue au CHU de Dijon. Il assure que plusieurs de ses patients « qui étaient bien stabilisés ont vu leur fréquence cardiaque augmenter avec des génériques avant que tout rentre dans l’ordre avec la reprise du médicament original ». Un exemple parmi d’autres témoignages.
De son côté Jean Marimbert, Directeur général de l’Agence française de Sécurité sanitaire des Produits de Santé (AFSSaPS), rappelle que les génériques ne sont pas des « médicaments au rabais ». Il ajoute également, qu’ « ils sont surveillés de la même manière que les produits de marque. (…) Dans le domaine du médicament, on ne peut s’en tenir à des on-dit ou aux impressions de tel ou tel praticien » ajoute-t-il sévèrement. D’autant comme le confirme le Pr Jean-Paul Giroud, membre de l’Académie de médecine et du Conseil scientifique de Destination Santé, qu’ « on ne recense rien de probant dans la littérature internationale contre les génériques ».
Un débat instrumentalisé par des lobbies ?
En revanche, le Pr Giroud -au même titre que le Pr Jean-François Bergmann, chef du service de médecine interne à l’hôpital Lariboisière à Paris- met en avant « un aspect psychologique bien connu des pharmacologues ». Il explique en effet que chez un patient, « le simple fait de penser qu’un médicament va peut-être moins bien marcher peut entraîner une moindre efficacité thérapeutique ».
Quant à Gilles Bonnefond, président délégué de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’officine (USPO), il est tout bonnement furieux. « II n’y a qu’en France qu’on entend ces critiques rétrogrades. (…) Il s’agit d’un combat d’arrière-garde derrière lequel on peut penser que se trouve l’industrie pharmaceutique. (…) ». Même si l’auteur de cette enquête souligne que « les médecins qui se posent des questions sur les génériques se défendent d’être instrumentalisés », il paraît évident qu’à ce stade le subjectif tient une place prépondérante dans ce débat...
Source : La Croix, 21 novembre 2008 - Agence française de Sécurité sanitaire des Produits de Santé
Carpe Diem
•.¸.•*¨۰۪۪۫۫●۪۫۰¨*•.¸.•Envol pour 2009-2012 à Chambéry •.¸.•*¨۰۪۪۫۫●۪۫۰¨*•.¸.•
•.¸.•*¨۰۪۪۫۫●۪۫۰¨*•.¸.•Envol pour 2009-2012 à Chambéry •.¸.•*¨۰۪۪۫۫●۪۫۰¨*•.¸.•
Re: Actualités 2009
Merci Juju de cette prompte réponse! Tu es sur tous les fronts! J'admire! 
Maman d'un petit trublion de 5 ans
Re: Actualités 2009
Thémes : l'alcool
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.f ... olence.pdf" target="_blank
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/reserve/rpib-4.html#1" target="_blank
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.f ... olence.pdf" target="_blank
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/reserve/rpib-4.html#1" target="_blank
Carpe Diem
•.¸.•*¨۰۪۪۫۫●۪۫۰¨*•.¸.•Envol pour 2009-2012 à Chambéry •.¸.•*¨۰۪۪۫۫●۪۫۰¨*•.¸.•
•.¸.•*¨۰۪۪۫۫●۪۫۰¨*•.¸.•Envol pour 2009-2012 à Chambéry •.¸.•*¨۰۪۪۫۫●۪۫۰¨*•.¸.•
Re: Actualités 2009
Fauteuils allergènes: les victimes déçues après une rencontre avec ConforamaHier, 20h02
Les victimes des fauteuils Conforama ayant entraîné des réactions allergiques se sont déclarées déçues samedi après une rencontre avec la direction du groupe d'ameublement à Villeneuve d'Ascq, près de Lille, et ont une nouvelle fois brandi la menace de plaintes au pénal.
Un magasin Conforama, à proximité de la Samaritaine (au second plan), le 27 septembre …Plus Agrandir la photo "Nous sommes déçus. Les représentants de la direction de Conforama ont expliqué leur point de vue mais les victimes ne les ont pas crus", a indiqué à l'AFP Claudette Lemoine, responsable du collectif Rouannez-Anna, basé dans le Nord mais qui regroupe des victimes de toute la France.
66 malades souffrant de pathologies diverses - brûlures, eczéma, affections respiratoires, perte de cheveux, douleurs musculaires - ont participé samedi à la première assemblée générale du collectif. Claudette Lemoine fait état de 128 victimes connues au total, pour 47.000 fauteuils ou canapés "allergisants" vendus.
Un membre de la direction nationale de Conforama, Olivier Rigaudy, ainsi qu'un représentant local de la marque, ont rencontré les victimes. S'agissant de l'origine des pathologies, "ils sont restés dans le vague", a assuré la responsable tandis que les propositions financières du groupe ne satisfont pas les victimes.
"Ils ont dit qu'ils avaient pris conscience du problème et qu'ils faisaient tout leur possible pour être proches victimes mais on n'en croit pas un mot parce qu'ils l'auraient fait depuis longtemps", a-t-elle indiqué.
Conforama proposerait entre 300 et 2.000 euros par dossier, une somme jugée "dérisoire" par le collectif qui met en avant "les frais médicaux, le préjudice moral et financier, la douleur de la famille, les cicatrices qui resteront à vie".
L'avocat du collectif, Patrick Tillie, va transmettre au cas par cas les dossiers et les demandes d'indemnisation à Conforama. "En fonction des réponses, il y aura ou non dépôt de plaintes", a prévenu Mme Lemoine.
"Toutes les victimes ne sont pas prêtes à accepter la mendicité", a-t-elle ajouté.
Les fauteuils auraient entraîné la mort d'au moins une personne de 80 ans, décédée le 7 septembre, et dont le médecin pense que la mort a été causée par les brûlures provoquées par les fauteuils, selon Mme Lemoine.
Les lots de fauteuil incriminés ont été retirés de la vente fin juin, à la suite de l'alerte d'un dermatologue, dont un des patients souffrait d'eczéma après avoir acheté un fauteuil de relaxation chez Conforama, qui contenait des sachets anti-moisissure, à l'origine des allergies.
Les victimes des fauteuils Conforama ayant entraîné des réactions allergiques se sont déclarées déçues samedi après une rencontre avec la direction du groupe d'ameublement à Villeneuve d'Ascq, près de Lille, et ont une nouvelle fois brandi la menace de plaintes au pénal.
Un magasin Conforama, à proximité de la Samaritaine (au second plan), le 27 septembre …Plus Agrandir la photo "Nous sommes déçus. Les représentants de la direction de Conforama ont expliqué leur point de vue mais les victimes ne les ont pas crus", a indiqué à l'AFP Claudette Lemoine, responsable du collectif Rouannez-Anna, basé dans le Nord mais qui regroupe des victimes de toute la France.
66 malades souffrant de pathologies diverses - brûlures, eczéma, affections respiratoires, perte de cheveux, douleurs musculaires - ont participé samedi à la première assemblée générale du collectif. Claudette Lemoine fait état de 128 victimes connues au total, pour 47.000 fauteuils ou canapés "allergisants" vendus.
Un membre de la direction nationale de Conforama, Olivier Rigaudy, ainsi qu'un représentant local de la marque, ont rencontré les victimes. S'agissant de l'origine des pathologies, "ils sont restés dans le vague", a assuré la responsable tandis que les propositions financières du groupe ne satisfont pas les victimes.
"Ils ont dit qu'ils avaient pris conscience du problème et qu'ils faisaient tout leur possible pour être proches victimes mais on n'en croit pas un mot parce qu'ils l'auraient fait depuis longtemps", a-t-elle indiqué.
Conforama proposerait entre 300 et 2.000 euros par dossier, une somme jugée "dérisoire" par le collectif qui met en avant "les frais médicaux, le préjudice moral et financier, la douleur de la famille, les cicatrices qui resteront à vie".
L'avocat du collectif, Patrick Tillie, va transmettre au cas par cas les dossiers et les demandes d'indemnisation à Conforama. "En fonction des réponses, il y aura ou non dépôt de plaintes", a prévenu Mme Lemoine.
"Toutes les victimes ne sont pas prêtes à accepter la mendicité", a-t-elle ajouté.
Les fauteuils auraient entraîné la mort d'au moins une personne de 80 ans, décédée le 7 septembre, et dont le médecin pense que la mort a été causée par les brûlures provoquées par les fauteuils, selon Mme Lemoine.
Les lots de fauteuil incriminés ont été retirés de la vente fin juin, à la suite de l'alerte d'un dermatologue, dont un des patients souffrait d'eczéma après avoir acheté un fauteuil de relaxation chez Conforama, qui contenait des sachets anti-moisissure, à l'origine des allergies.
ESI 2009-2012
Re: Actualités 2009
Lutte anti-tabac de l'OMS: nouvelles directives contre l'industrie du tabac
Hier, 15h35
Les représentants des 160 pays ayant ratifié la convention anti-tabac de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont adopté samedi des directives pour empêcher l'industrie du tabac de bloquer l'application de cette convention.
Les pays signataires de la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac (CCLAT) ont noté, au cours de leur 3e conférence cette semaine en Afrique du Sud, que "les interférences de l'industrie du tabac avaient été l'obstacle numéro un à la mise en place du traité", écrivent dans un communiqué les organisateurs de la conférence.
"Les grandes compagnies comme Philip Morris International, British American Tobacco ou Japan Tobacco ont tenté d'écrire certaines lois anti-tabac, de bloquer les législations anti-fumeurs et de contourner les interdictions de publicité", poursuivent-ils.
En conséquence, les délégués à la conférence ont choisi d'adopter des recommandations fortes pour empêcher ces "abus" de se reproduire et assurer l'application de la CCLAT.
Ils conseillent d'interdire les "représentants de l'industrie du tabac dans les délégations de la CCLAT ou les entités domestiques de contrôle anti-tabac", les "partenariats ou collaborations gouvernementales avec l'industrie du tabac", "les contributions, paiements ou cadeaux de l'industrie du tabac aux personnalités ou institutions officielles".
Les directives prévoient également d'"établir des règles d'engagement strictes pour toute réunion jugée nécessaire" avec l'industrie du tabac, notamment en assurant la "transparence" des réunions.
Les gouvernements doivent, selon elles, "éviter les traitements de faveur pour les entreprises de tabac nationalisées" et "exiger une transparence complète des activités des entreprises de tabac, telles que le lobbying ou le financement de recherche".
La CCLAT, adopté en février 2005, vise à lutter contre les 5 millions de décès causés chaque année par le tabagisme qui, selon l'OMS, doublera d'ici 2020 si rien n'est fait d'ici là.
Hier, 15h35
Les représentants des 160 pays ayant ratifié la convention anti-tabac de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont adopté samedi des directives pour empêcher l'industrie du tabac de bloquer l'application de cette convention.
Les pays signataires de la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac (CCLAT) ont noté, au cours de leur 3e conférence cette semaine en Afrique du Sud, que "les interférences de l'industrie du tabac avaient été l'obstacle numéro un à la mise en place du traité", écrivent dans un communiqué les organisateurs de la conférence.
"Les grandes compagnies comme Philip Morris International, British American Tobacco ou Japan Tobacco ont tenté d'écrire certaines lois anti-tabac, de bloquer les législations anti-fumeurs et de contourner les interdictions de publicité", poursuivent-ils.
En conséquence, les délégués à la conférence ont choisi d'adopter des recommandations fortes pour empêcher ces "abus" de se reproduire et assurer l'application de la CCLAT.
Ils conseillent d'interdire les "représentants de l'industrie du tabac dans les délégations de la CCLAT ou les entités domestiques de contrôle anti-tabac", les "partenariats ou collaborations gouvernementales avec l'industrie du tabac", "les contributions, paiements ou cadeaux de l'industrie du tabac aux personnalités ou institutions officielles".
Les directives prévoient également d'"établir des règles d'engagement strictes pour toute réunion jugée nécessaire" avec l'industrie du tabac, notamment en assurant la "transparence" des réunions.
Les gouvernements doivent, selon elles, "éviter les traitements de faveur pour les entreprises de tabac nationalisées" et "exiger une transparence complète des activités des entreprises de tabac, telles que le lobbying ou le financement de recherche".
La CCLAT, adopté en février 2005, vise à lutter contre les 5 millions de décès causés chaque année par le tabagisme qui, selon l'OMS, doublera d'ici 2020 si rien n'est fait d'ici là.
ESI 2009-2012
Re: Actualités 2009
Attention au grand froid
Vendredi 21 novembre, 19h49
La Direction générale de la santé rappelle vendredi, à la veille des premiers froids de l'hiver, les mesures à prendre en cas de grand froid et les actions qui ont dû être mises en place par les préfets.
Un secouriste de la Croix-Rouge dans un gymnase à Avallon, le 23 janvier 2007 Agrandir la photo Le froid, rappelle la DGS dans un communiqué, favorise bien sûr les gelures et hypothermies, mais aussi les crises d'asthme ou d'insuffisance coronarienne aiguë (angine de poitrine), ainsi que le développement d'infections broncho-pulmonaires. En outre, "une des conséquences indirectes du froid est l'intoxication par le monoxyde de carbone".
La DGS note aussi que les sans-abris ou les personnes vivant dans des logements mal chauffés sont plus vulnérables, ainsi que certaines personnes présentent "une défense physiologique vis-à-vis du froid moins efficace" : "les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes présentant certaines pathologies chroniques cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes".
La DGS rappelle que les préfets ont été informés sur les grandes orientations à mettre en oeuvre au niveau local, dans le cadre d'un dispositif de prévention : permanence des soins, prise en charge médico-sociale et sociale des plus démunis, vaccination des personnels de santé, promotion des mesures de protection et d'hygiène, recommandations pour adapter au mieux les traitements médicamenteux en période de froid...
La météo prévoit pour samedi une baisse des températures, avec des vents forts dans plusieurs régions et des températures voisines de zéro degré de la Champagne-Ardenne et de la Bourgogne jusqu'aux frontières allemandes et le Jura. Des giboulées neigeuses sont possibles dans l'est de la France.
Vendredi 21 novembre, 19h49
La Direction générale de la santé rappelle vendredi, à la veille des premiers froids de l'hiver, les mesures à prendre en cas de grand froid et les actions qui ont dû être mises en place par les préfets.
Un secouriste de la Croix-Rouge dans un gymnase à Avallon, le 23 janvier 2007 Agrandir la photo Le froid, rappelle la DGS dans un communiqué, favorise bien sûr les gelures et hypothermies, mais aussi les crises d'asthme ou d'insuffisance coronarienne aiguë (angine de poitrine), ainsi que le développement d'infections broncho-pulmonaires. En outre, "une des conséquences indirectes du froid est l'intoxication par le monoxyde de carbone".
La DGS note aussi que les sans-abris ou les personnes vivant dans des logements mal chauffés sont plus vulnérables, ainsi que certaines personnes présentent "une défense physiologique vis-à-vis du froid moins efficace" : "les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes présentant certaines pathologies chroniques cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes".
La DGS rappelle que les préfets ont été informés sur les grandes orientations à mettre en oeuvre au niveau local, dans le cadre d'un dispositif de prévention : permanence des soins, prise en charge médico-sociale et sociale des plus démunis, vaccination des personnels de santé, promotion des mesures de protection et d'hygiène, recommandations pour adapter au mieux les traitements médicamenteux en période de froid...
La météo prévoit pour samedi une baisse des températures, avec des vents forts dans plusieurs régions et des températures voisines de zéro degré de la Champagne-Ardenne et de la Bourgogne jusqu'aux frontières allemandes et le Jura. Des giboulées neigeuses sont possibles dans l'est de la France.
ESI 2009-2012
Re: Actualités 2009
Zimbabwe: le choléra progresse, déjà près de 300 morts
Vendredi 21 novembre, 19h20
Godfrey MARAWANYIKA
Les associations médicales du Zimbabwe ont tiré la sonnette d'alarme vendredi face à une propagation rapide du choléra, qui a déjà fait près de 300 morts, selon les Nations unies, et risque de prendre encore de l'ampleur, compte-tenu du délabrement du système de santé.
Le ministre de la Santé, David Parirenyatwa, a reconnu que la situation était "sans précédent" et que neuf des dix provinces du pays étaient affectées par l'épidémie.
Le régime du président Robert Mugabe se refuse toutefois à publier un bilan global des victimes et se contente de chiffres locaux communiqués au compte-gouttes, avec un total inférieur à 100 cas mortels.
Le bilan provisoire, arrêté au 18 novembre, est de 6.072 cas de choléra et 294 décès dus à l'infection, a toutefois déclaré vendredi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), confirmant des chiffres communiqués la veille par l'ambassadeur américain à Harare James McGee.
Les établissements de santé "font état d'un taux d'admission de 200 patients par jour", a précisé OCHA, pour qui "l'épidémie semble devoir continuer à s'étendre aussi bien territorialement qu'en nombre de personnes infectées, car la situation en ce qui concerne l'eau et l'assainissement s'aggrave."
Dans ce contexte, l'Association des médecins zimbabwéens pour les droits de l'Homme et l'Association médicale du Zimbabwe ont appelé le régime du président Robert Mugabe à déclarer "l'état d'urgence".
"Notre système de santé qui était envié par de nombreux pays développés est désormais au bord de l'effondrement total", a déclaré la première, en déplorant le manque de médicaments, de place et de personnel dans les établissements de santé.
"Les malades qui ont besoin d'une assistance médicale sont refoulés à l'entrée des hôpitaux et des cliniques du Zimbabwe", a-t-elle déploré.
L'épidémie était "prévisible et par conséquent évitable", a renchérit l'Association médicale du Zimbabwe, en demandant au gouvernement de débloquer en priorité des fonds pour la Santé.
Le Zimbabwe s'enfonce depuis le début des années 200O dans un marasme économique d'une ampleur inouïe, qui se caractérise par une hyperinflation délirante à près de 231 millions %, 80% de chômage et une production au point-mort.
Les réseaux d'égouts, de collecte des ordures et d'eau n'ont pas été épargnés par cette crise. La plupart des habitants de Harare ont aussi creusé des puits dans leur jardin, favorisant le risque de maladies liées à l'eau comme le choléra.
Quant au secteur sanitaire, autrefois un modèle pour les pays en développement, il n'est plus que l'ombre de lui-même: les personnels médicaux ont fui à l'étranger, la pénurie de devises empêche le paiement des salaires de ceux qui sont restés et l'achat des médicaments.
L'espérance de vie a chuté à 36 ans.
Le quotidien d'Etat The Herald a rapporté vendredi qu'un hôpital de Mutoko au nord-est de Harare, où trois personnes sont mortes du choléra, allait peut-être devoir fermer faute de nourriture.
"La situation dans les hôpitaux publics est mauvaise", a admis le ministre de la Santé, qui s'est toutefois dit confiant sur une baisse prochaine des pénuries alimentaires.
Malgré l'optimisme affiché des autorités, qui assurent "se battre pour contrôler l'épidémie", OCHA craint "le début de la saison des pluies", qui risque d'aggraver la situation.
Quant aux voisins du Zimbabwe, ils s'inquiètent d'un possible afflux de malades sur leur territoire. Cent cas ont déjà été rapportés en Afrique du Sud, dont trois mortels, selon les autorités locales.
Le choléra, qui prolifère dans l'eau salie par les excréments humains, se manifeste par des diarrhées et des vomissements pouvant mener à un état de déshydratation fatal, mais peut facilement se soigner s'il est traité à temps.
Vendredi 21 novembre, 19h20
Godfrey MARAWANYIKA
Les associations médicales du Zimbabwe ont tiré la sonnette d'alarme vendredi face à une propagation rapide du choléra, qui a déjà fait près de 300 morts, selon les Nations unies, et risque de prendre encore de l'ampleur, compte-tenu du délabrement du système de santé.
Le ministre de la Santé, David Parirenyatwa, a reconnu que la situation était "sans précédent" et que neuf des dix provinces du pays étaient affectées par l'épidémie.
Le régime du président Robert Mugabe se refuse toutefois à publier un bilan global des victimes et se contente de chiffres locaux communiqués au compte-gouttes, avec un total inférieur à 100 cas mortels.
Le bilan provisoire, arrêté au 18 novembre, est de 6.072 cas de choléra et 294 décès dus à l'infection, a toutefois déclaré vendredi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), confirmant des chiffres communiqués la veille par l'ambassadeur américain à Harare James McGee.
Les établissements de santé "font état d'un taux d'admission de 200 patients par jour", a précisé OCHA, pour qui "l'épidémie semble devoir continuer à s'étendre aussi bien territorialement qu'en nombre de personnes infectées, car la situation en ce qui concerne l'eau et l'assainissement s'aggrave."
Dans ce contexte, l'Association des médecins zimbabwéens pour les droits de l'Homme et l'Association médicale du Zimbabwe ont appelé le régime du président Robert Mugabe à déclarer "l'état d'urgence".
"Notre système de santé qui était envié par de nombreux pays développés est désormais au bord de l'effondrement total", a déclaré la première, en déplorant le manque de médicaments, de place et de personnel dans les établissements de santé.
"Les malades qui ont besoin d'une assistance médicale sont refoulés à l'entrée des hôpitaux et des cliniques du Zimbabwe", a-t-elle déploré.
L'épidémie était "prévisible et par conséquent évitable", a renchérit l'Association médicale du Zimbabwe, en demandant au gouvernement de débloquer en priorité des fonds pour la Santé.
Le Zimbabwe s'enfonce depuis le début des années 200O dans un marasme économique d'une ampleur inouïe, qui se caractérise par une hyperinflation délirante à près de 231 millions %, 80% de chômage et une production au point-mort.
Les réseaux d'égouts, de collecte des ordures et d'eau n'ont pas été épargnés par cette crise. La plupart des habitants de Harare ont aussi creusé des puits dans leur jardin, favorisant le risque de maladies liées à l'eau comme le choléra.
Quant au secteur sanitaire, autrefois un modèle pour les pays en développement, il n'est plus que l'ombre de lui-même: les personnels médicaux ont fui à l'étranger, la pénurie de devises empêche le paiement des salaires de ceux qui sont restés et l'achat des médicaments.
L'espérance de vie a chuté à 36 ans.
Le quotidien d'Etat The Herald a rapporté vendredi qu'un hôpital de Mutoko au nord-est de Harare, où trois personnes sont mortes du choléra, allait peut-être devoir fermer faute de nourriture.
"La situation dans les hôpitaux publics est mauvaise", a admis le ministre de la Santé, qui s'est toutefois dit confiant sur une baisse prochaine des pénuries alimentaires.
Malgré l'optimisme affiché des autorités, qui assurent "se battre pour contrôler l'épidémie", OCHA craint "le début de la saison des pluies", qui risque d'aggraver la situation.
Quant aux voisins du Zimbabwe, ils s'inquiètent d'un possible afflux de malades sur leur territoire. Cent cas ont déjà été rapportés en Afrique du Sud, dont trois mortels, selon les autorités locales.
Le choléra, qui prolifère dans l'eau salie par les excréments humains, se manifeste par des diarrhées et des vomissements pouvant mener à un état de déshydratation fatal, mais peut facilement se soigner s'il est traité à temps.
ESI 2009-2012
Re: Actualités 2009
Obésité: les publicités sur la restauration rapide en cause
Vendredi 21 novembre, 16h58
Mike Stobbe Imprimer
Y aurait-il un remède à l'augmentation spectaculaire du nombre d'enfants obèses aux Etats-Unis? Selon les résultats d'une étude américaine récente, diminuer le nombre d'annonces publicitaires pour la restauration rapide pourrait y contribuer. Lire la suite l'article
L'interdiction de ces publicités réduirait de 18% du nombre de jeunes enfants obèses et de 14% chez les enfants plus âgés, selon cette étude. Les auteurs laissent aussi entendre que la suppression de la déduction fiscale sur les dépenses publicitaires des fast-food pourrait entraîner une légère diminution de l'obésité infantile.
Pour certains experts, il s'agit de la première étude nationale qui démontre une influence aussi grande de la publicité sur l'obésité des enfants. "Notre étude établit la preuve de ce lien", a déclaré le coauteur de l'étude, David Grossman, professeur d'économie, Université de New York.
L'étude aura des implications importantes dans la régulation de la publicité à la télévision, a averti Lisa Powell, chercheur à l'Université de l'Illinois, Institut de recherche en santé de Chicago, Illinois.
Le pourcentage d'enfants américains en surpoids ou obèses a augmenté régulièrement depuis les années 80 jusqu'à récemment, avant de se stabiliser. Environ un tiers des enfants américains sont en surpoids ou obèses, selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDCP).
Les causes de l'obésité infantile sont complexes, mais les chercheurs s'interrogent depuis des années sur les effets des spots publicitaires. Lisa Powell, par exemple, a découvert que 23% des publicités alimentaires que les enfants voient à la télévision concernent les fast-food. Des publicités que les enfants voient des dizaines de milliers de fois par an.
La nouvelle étude se base en partie sur plusieurs années d'études publiques datant des années 90 qui incluent des entretiens menés avec des milliers de familles américaines.
Les chercheurs ont utilisé un test statistique qui suppose que les spots mènent à l'obésité, tout en s'intéressant à d'autres facteurs de risque, notamment au revenu et à la quantité de centres de restauration rapide situés à proximité du domicile. Ils ont aussi pris en compte la possibilité que certains enfants aient été obèses et sédentaires, indépendamment de leurs habitudes télévisuelles.
L'étude est publiée ce mois-ci dans le "Journal of Law & Economics".
Les auteurs, financés par un fond fédéral, comptent parmi eux Grossman, des chercheurs de l'Université Lehig et de l'Université publique de Géorgie.
Les auteurs se sont abstenus de recommander l'interdiction des publicités ou la suppression de la déduction fiscale sur les spots. "Beaucoup de gens vont au fast-food de façon raisonnable, ce qui ne menace pas leur santé", ajoute-t-il M. Grossmann. AP
Vendredi 21 novembre, 16h58
Mike Stobbe Imprimer
Y aurait-il un remède à l'augmentation spectaculaire du nombre d'enfants obèses aux Etats-Unis? Selon les résultats d'une étude américaine récente, diminuer le nombre d'annonces publicitaires pour la restauration rapide pourrait y contribuer. Lire la suite l'article
L'interdiction de ces publicités réduirait de 18% du nombre de jeunes enfants obèses et de 14% chez les enfants plus âgés, selon cette étude. Les auteurs laissent aussi entendre que la suppression de la déduction fiscale sur les dépenses publicitaires des fast-food pourrait entraîner une légère diminution de l'obésité infantile.
Pour certains experts, il s'agit de la première étude nationale qui démontre une influence aussi grande de la publicité sur l'obésité des enfants. "Notre étude établit la preuve de ce lien", a déclaré le coauteur de l'étude, David Grossman, professeur d'économie, Université de New York.
L'étude aura des implications importantes dans la régulation de la publicité à la télévision, a averti Lisa Powell, chercheur à l'Université de l'Illinois, Institut de recherche en santé de Chicago, Illinois.
Le pourcentage d'enfants américains en surpoids ou obèses a augmenté régulièrement depuis les années 80 jusqu'à récemment, avant de se stabiliser. Environ un tiers des enfants américains sont en surpoids ou obèses, selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDCP).
Les causes de l'obésité infantile sont complexes, mais les chercheurs s'interrogent depuis des années sur les effets des spots publicitaires. Lisa Powell, par exemple, a découvert que 23% des publicités alimentaires que les enfants voient à la télévision concernent les fast-food. Des publicités que les enfants voient des dizaines de milliers de fois par an.
La nouvelle étude se base en partie sur plusieurs années d'études publiques datant des années 90 qui incluent des entretiens menés avec des milliers de familles américaines.
Les chercheurs ont utilisé un test statistique qui suppose que les spots mènent à l'obésité, tout en s'intéressant à d'autres facteurs de risque, notamment au revenu et à la quantité de centres de restauration rapide situés à proximité du domicile. Ils ont aussi pris en compte la possibilité que certains enfants aient été obèses et sédentaires, indépendamment de leurs habitudes télévisuelles.
L'étude est publiée ce mois-ci dans le "Journal of Law & Economics".
Les auteurs, financés par un fond fédéral, comptent parmi eux Grossman, des chercheurs de l'Université Lehig et de l'Université publique de Géorgie.
Les auteurs se sont abstenus de recommander l'interdiction des publicités ou la suppression de la déduction fiscale sur les spots. "Beaucoup de gens vont au fast-food de façon raisonnable, ce qui ne menace pas leur santé", ajoute-t-il M. Grossmann. AP
ESI 2009-2012