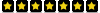Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et après?
Modérateurs : Modérateurs, ESI
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
Soins Gérontologie
Vol 13, N° 72 - août 2008
– L’auxiliaire de vie sociale
Sarah Trotet (extrait)
L’auxiliaire de vie sociale intervient auprès de toute personne qui ne peut assumer seule les tâches de la vie quotidienne (personnes âgées, familles, personnes handicapées, malades…). Il les aide et les assiste pour permettre leur maintien à domicile, contribuer à la préservation, à la restauration et à la stimulation de leur autonomie, favoriser leur insertion sociale et ainsi concourir à la lutte contre l’exclusion. Outre de grandes qualités relationnelles (écoute, amabilité, discrétion…), ce métier nécessite des capacités d’analyse et d’initiative face à des situations à risque. Ordre, propreté, expérience des tâches ménagères et bonne condition physique sont également requis pour exercer au mieux ce métier aux multiples facettes.
L
Cadre réglementaire
Le Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) est régi par le décret n° 2007-348 du 14 mars 2007 (Journal officiel du 17 mars 2007), l’arrêté du 4 juin 2007 et ses annexes (Bulletin officiel n° 07/07 du 15 août 2007) et par la circulaire n°DGAS/SD4A/2007/297 du 25 juillet 2007.
Les textes de référence sont :
le décret 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ;
l’accord de branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations, modifié par l’avenant n° 1 du 4 décembre 2002 ;
le décret n° 92-849 du 28 avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux.
Missions
Cadre général. L’auxiliaire de vie sociale intervient au domicile des personnes aidées pour répondre à un état de fragilité, de dépendance ou de difficultés passagères dues à l’âge, à la maladie, au handicap ou à des difficultés sociales.
Il intervient auprès de toutes personnes, notamment âgées, pour le maintien à domicile, la préservation et la restauration de leur autonomie, leur insertion sociale et la lutte contre les exclusions.
Il concourt au maintien à domicile d’une personne en situation de besoin d’aide dans le respect de ses choix de vie, dans l’objectif de maintenir et/ou restaurer et/ou stimuler son autonomie.
L’intervention au domicile consiste en un accompagnement et un soutien des personnes dans leur vie quotidienne. En fonction des potentialités et des incapacités constatées de la personne en situation d’aide, l’auxiliaire de vie sociale décline ses fonctions selon deux logiques d’intervention :
aider à faire (stimuler, accompagner, soulager, apprendre à faire) ;
faire à la place de la personne qui est dans l’incapacité de faire seul.
L’auxiliaire de vie sociale développe des compétences techniques et relationnelles pour :
un accompagnement et une aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (entretien du logement et du linge, courses, préparation des repas…) ;
un accompagnement et une aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, à l’habillage, à la toilette, au lever, surveillance de la prise de médicaments…) ;
un accompagnement et une aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et les activités relationnelles (stimulation, conversation, soutien moral, aide dans les démarches administratives, aide dans la lutte contre l’isolement).
Tout au long de sa mission, l’auxiliaire de vie sociale doit donc être capable de repérer un état de souffrance, de transmettre des informations aux différents professionnels intervenant auprès de la personne aidée, tout en faisant preuve de discrétion, dans le but de permettre un maintien à domicile dans les meilleures conditions. Outre son rôle de veille, de prévention et de communication, il a une fonction relais entre le domicile et l’extérieur.*
Formation
Créé en 2002, le Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) remplace le Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile (Cafad)1.
Ce diplôme de niveau V est à l’issue de la formation qui est ouverte aux personnes de 18 ans au moins, sans condition de diplôme. Néanmoins, le candidat devra satisfaire un examen permettant d’évaluer des prérequis.
Durée et contenu de la formation. Modifiée en 20072, la formation est structurée en domaines de compétences (6 modules) et s’étale sur une période de 9 à 36 mois. Elle alterne une partie théorique (504 heures) et des stages pratiques (560 heures). La formation se déroule dans des centres de formation agréés par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass).
Le DEAVS est également accessible via la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Lieux d’exercice
Environ 177 000 auxiliaires de vie sociale apportent leur soutien aux personnes fragiles que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Ces emplois sont souvent compris entre le mi-temps et le temps complet. Plus de 80 % des auxiliaires de vie sociale travaillent dans le secteur privé, néanmoins quelques-uns exercent dans le cadre de la fonction publique territoriale3.
L’auxiliaire de vie sociale peut ainsi travailler pour :
des collectivités territoriales (centres communaux d’action sociale – CCAS, services municipaux…) ;
des associations d’aide à domicile ;
des particuliers employeurs ;
des services privés à but lucratif ;
des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).
Particularités de l’exercice
L’exercice de la profession d’auxiliaire de vie sociale exige des compétences et des qualités spécifiques. Comme tous les métiers de l’aide, « on n’y va pas par hasard et on n’y reste pas par hasard non plus ». C’est un métier passionnant certes, mais éprouvant car le travail s’effectue avec des personnes malades, handicapées, en fin de vie pour certaines, angoissées, toutes, en tout cas, dans une attente plus ou moins voulue et consciente d’aide.
La particularité du métier tient aussi au fait qu’il ne se déroule pas dans un espace public mais au domicile de la personne aidée. Cela est partie intégrante de la relation entre la personne aidée et l’auxiliaire de vie sociale. Qui dit domicile, dit privé, intimité, histoire de toute une vie, de souvenirs, en tout cas histoire particulière et unique qui appartient à la personne aidée. De fait, la frontière entre la sphère professionnelle et la sphère privée est opaque. En effet, où se situe cette limite lorsque l’auxiliaire de vie sociale partage le quotidien d’une personne aidée, lorsqu’il est sa seule visite hebdomadaire, lorsqu’il est son seul lien avec le monde extérieur ?
Paroles d’auxiliaires de vie
L’exercice du métier exige certaines qualités. « Il faut être patient et à l’écoute, s’adapter vite, être organisé, rigoureux, dynamique. Il faut aussi être en bonne condition physique, être ferme, courageux et motivé, aimer aider, savoir être discret, aimer le contact avec les autres, avoir le sens du relationnel… ».
La réussite de l’intervention tient dans cette subtile alchimie entre la personnalité de la personne aidée, celle du professionnel, la nature et le moment de l’intervention, et les compétences. « On aide les gens ». « Les personnes âgées nous apportent leur expérience de la vie ». « On peut discuter avec les personnes ». « Je sers à quelque chose ». « Je sais que je suis la seule personne que Mme D. voit dans la semaine ». « Il y a beaucoup de contacts ». « Il y a un vrai échange ». « Je suis contente quand j’aide une personne qui ne voulait plus rien faire et qui fait maintenant des choses ». « Quand je vais chez Mme A. et qu’elle s’est habillée et maquillée parce que je venais, alors que les autres jours elle reste en pyjama, je me dis que j’ai réussi ». « Je peux avoir une vraie relation avec la personne ».
Décret n°2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale ; arrêté du 26 mars 2002 modifié relatif au diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (modifié).
Décret n° 2007-348 du 14 mars 2007 relatif au diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
autre texte
oins Aides-Soignantes
Vol 2, N° 5 - août 2005
pp. 24-25
Les intervenants à domicile (extraits)
Frédérique Lacour, Margot Estate
[1] Cadre infirmier
[2] Psychologue Réseau Quiétude, Paris (75)
L’aide-soignant peut exercer sa profession au domicile des patients. Il est alors rattaché soit à un Ssiad, soit à un service d’HAD. D’autres intervenants, médicaux ou paramédicaux ou sociaux, interviennent eux aussi à domicile.
Plan
Les professionnels prescripteurs
Les auxiliaires médicaux
Les structures de soins
Les aides à domicile
Le transport des malades
La nécessité de recevoir des soins lorsque l’on est à son domicile, que l’on soit atteint d’une pathologie chronique ou non, âgé ou non, handicapé ou non, concerne chacun d’entre nous, un jour ou l’autre. Mais qui a le droit de prescrire des soins à domicile ? De quelles aides humaines ou matérielles peut-on bénéficier ?
Les professionnels prescripteurs
Les auxiliaires médicaux
Les auxiliaires médicaux regroupent les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes. Ils interviennent dès lors qu’il y a prescription médicale.
Les autres professionnels sont, par exemple, la diététicienne, le psychologue, l’ergothérapeute et le psychomotricien. Ces deux derniers interviennent sur prescription médicale.
Les structures de soins
Les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad). Ils s’adressent en principe aux personnes de plus de 60 ans nécessitant des soins, et aux personnes handicapées. L’équipe soignante comporte des infirmiers et des aides-soignantes. Les soins dispensés sont moins “intensifs” que ceux dispensés en hospitalisation à domicile (cela explique que le prix de journée soit moins élevé que celui pratiqué en hospitalisation à domicile). Ils regroupent principalement les actes de la vie quotidienne, les pansements, l’administration d’un traitement pharmaceutique, notamment les injections
L’hospitalisation à domicile (HAD). Elle se définit comme un ensemble de soins médicaux et paramédicaux délivrés à domicile à des malades dont l’état de santé ne justifie pas le maintien au sein d’une structure hospitalière mais demande des soins complexes. L’HAD s’adresse aux enfants et aux adultes.
L’équipe soignante comporte des infirmiers, des aides-soignants, des kinésithérapeutes, des diététiciennes, des psychologues…
Le médecin traitant assure le suivi, le traitement et la surveillance des soins
Les aides à domicile
Après signature d’un accord de branche en 2002, le secteur prestataire associatif des aides à domicile répartit les agents en trois classes :
branche A : agent à domicile,
branche B : employé à domicile,
branche C : auxiliaire de vie sociale.
Les aides à domicile peuvent intervenir à la demande du patient ou de son entourage, du médecin généraliste, de l’assistante sociale, d’un réseau de soins palliatifs…
L’agent à domicile.
Son rôle est de réaliser et d’aider à l’accomplissement des activités domestiques et administratives simples, essentiellement auprès des personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi de celles-ci.
Ses principales activités sont la réalisation des travaux courants d’entretien de la maison (ménage, linge, courses) et l’assistance de la personne dans des démarches administratives simples.
Ce professionnel ne nécessite pas de diplôme particulier.
L'employée à domicile.
Son rôle est de réaliser et aider à l’accomplissement des activités domestiques et administratives auprès des personnes ne pouvant plus les faire en totale autonomie et/ou rencontrant des difficultés passagères. L’employée à domicile assiste et soulage les personnes qui ne peuvent faire seules les actes ordinaires de la vie courante (les courses, le ménage, la préparation des repas et leur prise, la surveillance dans la prise des médicaments, l’entretien du linge, les achats…).
Ses principales activités sont l’aide auprès des personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (les soins d’hygiène, d’habillage, les soins d’élimination, les déplacements…), et l’aide dans les activités de la vie quotidienne (stimulation des capacités intellectuelles et physiques).
Ces professionnels peuvent être détenteurs d’un BEP sanitaire et social.
L’auxiliaire de vie sociale.
•Ce professionnel est titulaire du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) créé en 2002, diplôme qui remplace le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile (Cafad) créé en 1987. Les personnes titulaires du Cafad ont une équivalence du DEAVS et peuvent exercer les mêmes fonctions.
Peuvent également exercer cette profession, au même niveau d’emploi et de qualification, les titulaires du BEP carrières sanitaires et sociales qui ont validé, après un an d’études supplémentaires, la mention complémentaire “Aide à domicile”.
•Son rôle est d’effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles, dans leur vie quotidienne. L’auxiliaire de vie sociale aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ou fait à la place d’une personne qui est dans l’incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante.
•Ses activités sont l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, et l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers). Comme son nom l’indique, l’auxiliaire de vie sociale accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs…). Enfin, elle participe à l’évaluation de la situation et adapte son intervention en conséquence.
Ce professionnel assure également la coordination de son action avec l’ensemble des acteurs.
•Attention, il ne faut pas confondre les auxiliaires de vis sociale avec les auxiliaires de vie aux handicapés qui ne bénéficient pas de certification professionnelle, mais de formations professionnelles dispensées par leur employeur, comme l’Association des paralysés de France, par exemple.
La travailleuse familiale.
Elle est salariée d’une association ou d’un organisme, la Caisse d’allocations familiales par exemple. Elle est titulaire d’un DEAVS. Elle seconde les familles en difficulté dans les tâches ménagères et les activités avec les enfants (soins d’hygiène, alimentation, éveil des enfants). Elle est appelée à intervenir de plus en plus souvent pour des cas de familles en grande difficulté sociale, psychologique ou psychiatrique.
rien à voir avec l assistante de vie scolaire
http://www.cidj.com/article-metier/auxi ... e-scolaire
pour le glissement des tâches
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ensp/Memo ... ichaud.pdf
et
Le glissement de tâche, un risque juridique majeur .....Le risque pénal ...
Vol 13, N° 72 - août 2008
– L’auxiliaire de vie sociale
Sarah Trotet (extrait)
L’auxiliaire de vie sociale intervient auprès de toute personne qui ne peut assumer seule les tâches de la vie quotidienne (personnes âgées, familles, personnes handicapées, malades…). Il les aide et les assiste pour permettre leur maintien à domicile, contribuer à la préservation, à la restauration et à la stimulation de leur autonomie, favoriser leur insertion sociale et ainsi concourir à la lutte contre l’exclusion. Outre de grandes qualités relationnelles (écoute, amabilité, discrétion…), ce métier nécessite des capacités d’analyse et d’initiative face à des situations à risque. Ordre, propreté, expérience des tâches ménagères et bonne condition physique sont également requis pour exercer au mieux ce métier aux multiples facettes.
L
Cadre réglementaire
Le Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) est régi par le décret n° 2007-348 du 14 mars 2007 (Journal officiel du 17 mars 2007), l’arrêté du 4 juin 2007 et ses annexes (Bulletin officiel n° 07/07 du 15 août 2007) et par la circulaire n°DGAS/SD4A/2007/297 du 25 juillet 2007.
Les textes de référence sont :
le décret 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ;
l’accord de branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations, modifié par l’avenant n° 1 du 4 décembre 2002 ;
le décret n° 92-849 du 28 avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux.
Missions
Cadre général. L’auxiliaire de vie sociale intervient au domicile des personnes aidées pour répondre à un état de fragilité, de dépendance ou de difficultés passagères dues à l’âge, à la maladie, au handicap ou à des difficultés sociales.
Il intervient auprès de toutes personnes, notamment âgées, pour le maintien à domicile, la préservation et la restauration de leur autonomie, leur insertion sociale et la lutte contre les exclusions.
Il concourt au maintien à domicile d’une personne en situation de besoin d’aide dans le respect de ses choix de vie, dans l’objectif de maintenir et/ou restaurer et/ou stimuler son autonomie.
L’intervention au domicile consiste en un accompagnement et un soutien des personnes dans leur vie quotidienne. En fonction des potentialités et des incapacités constatées de la personne en situation d’aide, l’auxiliaire de vie sociale décline ses fonctions selon deux logiques d’intervention :
aider à faire (stimuler, accompagner, soulager, apprendre à faire) ;
faire à la place de la personne qui est dans l’incapacité de faire seul.
L’auxiliaire de vie sociale développe des compétences techniques et relationnelles pour :
un accompagnement et une aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (entretien du logement et du linge, courses, préparation des repas…) ;
un accompagnement et une aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, à l’habillage, à la toilette, au lever, surveillance de la prise de médicaments…) ;
un accompagnement et une aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et les activités relationnelles (stimulation, conversation, soutien moral, aide dans les démarches administratives, aide dans la lutte contre l’isolement).
Tout au long de sa mission, l’auxiliaire de vie sociale doit donc être capable de repérer un état de souffrance, de transmettre des informations aux différents professionnels intervenant auprès de la personne aidée, tout en faisant preuve de discrétion, dans le but de permettre un maintien à domicile dans les meilleures conditions. Outre son rôle de veille, de prévention et de communication, il a une fonction relais entre le domicile et l’extérieur.*
Formation
Créé en 2002, le Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) remplace le Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile (Cafad)1.
Ce diplôme de niveau V est à l’issue de la formation qui est ouverte aux personnes de 18 ans au moins, sans condition de diplôme. Néanmoins, le candidat devra satisfaire un examen permettant d’évaluer des prérequis.
Durée et contenu de la formation. Modifiée en 20072, la formation est structurée en domaines de compétences (6 modules) et s’étale sur une période de 9 à 36 mois. Elle alterne une partie théorique (504 heures) et des stages pratiques (560 heures). La formation se déroule dans des centres de formation agréés par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass).
Le DEAVS est également accessible via la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Lieux d’exercice
Environ 177 000 auxiliaires de vie sociale apportent leur soutien aux personnes fragiles que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Ces emplois sont souvent compris entre le mi-temps et le temps complet. Plus de 80 % des auxiliaires de vie sociale travaillent dans le secteur privé, néanmoins quelques-uns exercent dans le cadre de la fonction publique territoriale3.
L’auxiliaire de vie sociale peut ainsi travailler pour :
des collectivités territoriales (centres communaux d’action sociale – CCAS, services municipaux…) ;
des associations d’aide à domicile ;
des particuliers employeurs ;
des services privés à but lucratif ;
des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).
Particularités de l’exercice
L’exercice de la profession d’auxiliaire de vie sociale exige des compétences et des qualités spécifiques. Comme tous les métiers de l’aide, « on n’y va pas par hasard et on n’y reste pas par hasard non plus ». C’est un métier passionnant certes, mais éprouvant car le travail s’effectue avec des personnes malades, handicapées, en fin de vie pour certaines, angoissées, toutes, en tout cas, dans une attente plus ou moins voulue et consciente d’aide.
La particularité du métier tient aussi au fait qu’il ne se déroule pas dans un espace public mais au domicile de la personne aidée. Cela est partie intégrante de la relation entre la personne aidée et l’auxiliaire de vie sociale. Qui dit domicile, dit privé, intimité, histoire de toute une vie, de souvenirs, en tout cas histoire particulière et unique qui appartient à la personne aidée. De fait, la frontière entre la sphère professionnelle et la sphère privée est opaque. En effet, où se situe cette limite lorsque l’auxiliaire de vie sociale partage le quotidien d’une personne aidée, lorsqu’il est sa seule visite hebdomadaire, lorsqu’il est son seul lien avec le monde extérieur ?
Paroles d’auxiliaires de vie
L’exercice du métier exige certaines qualités. « Il faut être patient et à l’écoute, s’adapter vite, être organisé, rigoureux, dynamique. Il faut aussi être en bonne condition physique, être ferme, courageux et motivé, aimer aider, savoir être discret, aimer le contact avec les autres, avoir le sens du relationnel… ».
La réussite de l’intervention tient dans cette subtile alchimie entre la personnalité de la personne aidée, celle du professionnel, la nature et le moment de l’intervention, et les compétences. « On aide les gens ». « Les personnes âgées nous apportent leur expérience de la vie ». « On peut discuter avec les personnes ». « Je sers à quelque chose ». « Je sais que je suis la seule personne que Mme D. voit dans la semaine ». « Il y a beaucoup de contacts ». « Il y a un vrai échange ». « Je suis contente quand j’aide une personne qui ne voulait plus rien faire et qui fait maintenant des choses ». « Quand je vais chez Mme A. et qu’elle s’est habillée et maquillée parce que je venais, alors que les autres jours elle reste en pyjama, je me dis que j’ai réussi ». « Je peux avoir une vraie relation avec la personne ».
Décret n°2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale ; arrêté du 26 mars 2002 modifié relatif au diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (modifié).
Décret n° 2007-348 du 14 mars 2007 relatif au diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
autre texte
oins Aides-Soignantes
Vol 2, N° 5 - août 2005
pp. 24-25
Les intervenants à domicile (extraits)
Frédérique Lacour, Margot Estate
[1] Cadre infirmier
[2] Psychologue Réseau Quiétude, Paris (75)
L’aide-soignant peut exercer sa profession au domicile des patients. Il est alors rattaché soit à un Ssiad, soit à un service d’HAD. D’autres intervenants, médicaux ou paramédicaux ou sociaux, interviennent eux aussi à domicile.
Plan
Les professionnels prescripteurs
Les auxiliaires médicaux
Les structures de soins
Les aides à domicile
Le transport des malades
La nécessité de recevoir des soins lorsque l’on est à son domicile, que l’on soit atteint d’une pathologie chronique ou non, âgé ou non, handicapé ou non, concerne chacun d’entre nous, un jour ou l’autre. Mais qui a le droit de prescrire des soins à domicile ? De quelles aides humaines ou matérielles peut-on bénéficier ?
Les professionnels prescripteurs
Les auxiliaires médicaux
Les auxiliaires médicaux regroupent les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes. Ils interviennent dès lors qu’il y a prescription médicale.
Les autres professionnels sont, par exemple, la diététicienne, le psychologue, l’ergothérapeute et le psychomotricien. Ces deux derniers interviennent sur prescription médicale.
Les structures de soins
Les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad). Ils s’adressent en principe aux personnes de plus de 60 ans nécessitant des soins, et aux personnes handicapées. L’équipe soignante comporte des infirmiers et des aides-soignantes. Les soins dispensés sont moins “intensifs” que ceux dispensés en hospitalisation à domicile (cela explique que le prix de journée soit moins élevé que celui pratiqué en hospitalisation à domicile). Ils regroupent principalement les actes de la vie quotidienne, les pansements, l’administration d’un traitement pharmaceutique, notamment les injections
L’hospitalisation à domicile (HAD). Elle se définit comme un ensemble de soins médicaux et paramédicaux délivrés à domicile à des malades dont l’état de santé ne justifie pas le maintien au sein d’une structure hospitalière mais demande des soins complexes. L’HAD s’adresse aux enfants et aux adultes.
L’équipe soignante comporte des infirmiers, des aides-soignants, des kinésithérapeutes, des diététiciennes, des psychologues…
Le médecin traitant assure le suivi, le traitement et la surveillance des soins
Les aides à domicile
Après signature d’un accord de branche en 2002, le secteur prestataire associatif des aides à domicile répartit les agents en trois classes :
branche A : agent à domicile,
branche B : employé à domicile,
branche C : auxiliaire de vie sociale.
Les aides à domicile peuvent intervenir à la demande du patient ou de son entourage, du médecin généraliste, de l’assistante sociale, d’un réseau de soins palliatifs…
L’agent à domicile.
Son rôle est de réaliser et d’aider à l’accomplissement des activités domestiques et administratives simples, essentiellement auprès des personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi de celles-ci.
Ses principales activités sont la réalisation des travaux courants d’entretien de la maison (ménage, linge, courses) et l’assistance de la personne dans des démarches administratives simples.
Ce professionnel ne nécessite pas de diplôme particulier.
L'employée à domicile.
Son rôle est de réaliser et aider à l’accomplissement des activités domestiques et administratives auprès des personnes ne pouvant plus les faire en totale autonomie et/ou rencontrant des difficultés passagères. L’employée à domicile assiste et soulage les personnes qui ne peuvent faire seules les actes ordinaires de la vie courante (les courses, le ménage, la préparation des repas et leur prise, la surveillance dans la prise des médicaments, l’entretien du linge, les achats…).
Ses principales activités sont l’aide auprès des personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (les soins d’hygiène, d’habillage, les soins d’élimination, les déplacements…), et l’aide dans les activités de la vie quotidienne (stimulation des capacités intellectuelles et physiques).
Ces professionnels peuvent être détenteurs d’un BEP sanitaire et social.
L’auxiliaire de vie sociale.
•Ce professionnel est titulaire du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) créé en 2002, diplôme qui remplace le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile (Cafad) créé en 1987. Les personnes titulaires du Cafad ont une équivalence du DEAVS et peuvent exercer les mêmes fonctions.
Peuvent également exercer cette profession, au même niveau d’emploi et de qualification, les titulaires du BEP carrières sanitaires et sociales qui ont validé, après un an d’études supplémentaires, la mention complémentaire “Aide à domicile”.
•Son rôle est d’effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles, dans leur vie quotidienne. L’auxiliaire de vie sociale aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ou fait à la place d’une personne qui est dans l’incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante.
•Ses activités sont l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, et l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers). Comme son nom l’indique, l’auxiliaire de vie sociale accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs…). Enfin, elle participe à l’évaluation de la situation et adapte son intervention en conséquence.
Ce professionnel assure également la coordination de son action avec l’ensemble des acteurs.
•Attention, il ne faut pas confondre les auxiliaires de vis sociale avec les auxiliaires de vie aux handicapés qui ne bénéficient pas de certification professionnelle, mais de formations professionnelles dispensées par leur employeur, comme l’Association des paralysés de France, par exemple.
La travailleuse familiale.
Elle est salariée d’une association ou d’un organisme, la Caisse d’allocations familiales par exemple. Elle est titulaire d’un DEAVS. Elle seconde les familles en difficulté dans les tâches ménagères et les activités avec les enfants (soins d’hygiène, alimentation, éveil des enfants). Elle est appelée à intervenir de plus en plus souvent pour des cas de familles en grande difficulté sociale, psychologique ou psychiatrique.
rien à voir avec l assistante de vie scolaire
http://www.cidj.com/article-metier/auxi ... e-scolaire
pour le glissement des tâches
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ensp/Memo ... ichaud.pdf
et
Le glissement de tâche, un risque juridique majeur .....Le risque pénal ...
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
Coccidu29 a écrit :
je dirai que j'étais ASH et que justement je travaillais parfois en collaboration avec les AS .
La collaboration interprofessionnelle, un travail d’équipe .
.
.Collaborer, c’est « travailler en commun à une œuvre commune ».
mais l ash ne collabore pas dans des actions de soins ... elle n a pas acces au dossier medical et infirmier
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0000449527
pour les esi voulant le diplome d as, pour les avs voulant devenir as, pour les ash voulant devenir as
et pour les as voulant devenir ide, pour les ash voulant devenir ide
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
J'ai bien lu tous les articles de loi que vous m'avez envoyé toutes les deux, et il est expliqué que l'auxiliaire de vie est à domicile et non pas en ehpad.
De toute façon je dirai le moins possible aux directeurs d'ifsi, je leur dirai que j'ai travaillé en ehpad et que j'ai eu plusieurs expériences. Que j'étais parfois en binome avec une aide soignante, mais je vais surtout en dire le moins possible.
Merci de votre aide en tout cas, vos conseils sont précieux.
De toute façon je dirai le moins possible aux directeurs d'ifsi, je leur dirai que j'ai travaillé en ehpad et que j'ai eu plusieurs expériences. Que j'étais parfois en binome avec une aide soignante, mais je vais surtout en dire le moins possible.
Merci de votre aide en tout cas, vos conseils sont précieux.
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
Je ne fais pas l'autruche concernant le glissement de tâche et c'est bien ça qui me met mal à l'aise. Car dire que j'étais ASH dans le ménage et les repas, etc serait mentir mais c'est quelque chose que je vais devoir dire justement si je ne veux pas avoir des problèmes. Cependant je n'allais pas refuser les postes où j'ai travaillé sous prétexte que je ne suis pas censée faire des soins même si je suis en binôme avec une aide soignante et donc sous sa responsabilité. Là est le soucis aussi, du travail on ne va pas en refuser.myloma a écrit :je pense qu'il vaut mieux que tu consultes ce qui concerne AVS
ainsi, tu verras le rôle d'un point de vue législatif
la coordinatrice n'a peut être pas connaissance des attributions réelles mais celles "toléréesé par l'établissement
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 0839,d.d2s
je vois que je ne suis pas la seule à te mettre en garde contre les glissements de tâche
Mais je suis tout à fait conscience qu'il s'agit de glissements de tâche sous couvert de la responsabilité de l'aide soignante avec qui je travaillais.
Lors des entretiens je dirai simplement que j'ai travaillé en maison de retraite ce qui m'a permis d'avoir de l'expérience professionnelle et de continuer à travailler dans le milieu de la santé malgré ce qui m'est arrivé. J'en dirai le moins possible sauf si les directeurs cherchent évidemment la petite bête
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
J'ai une dernière question.
Aujourd'hui j'ai appelé la FNESI et en discutant avec la personne au téléphone, quand je lui ai dit qu'avant le conseil pédagogique j'avais écrit ma lettre de demande de suspension de formation en date du 31/10/2014 alors que je passée en conseil pédagogique le 07/11/2014. Le directeur a accepté ma lettre en disant qu'il ne savait pas ce que ça pourrait faire en vue de la décision. Mais la personne de la FNESI m'a dit que normalement en date de la lettre de demande de suspension de formation je n'aurai pas dû être considérée étudiante infirmière après même en cas d'une procédure pédagogique engagée car c'est un droit de l'étudiant d'arrêter sa formation.
Qu'en est il d'une demande de suspension de formation lorsqu'une procédure pédagogique est en cours ? Je sais que c'est un peu facile de dire j'arrête mes études pour sauver son diplôme aide soignant par exemple mais je devais le tenter au moins.
Merci encore à tous pour votre aide et désolé du fil que je vous ai donné à retordre.
Bonne fin d'après midi
Aujourd'hui j'ai appelé la FNESI et en discutant avec la personne au téléphone, quand je lui ai dit qu'avant le conseil pédagogique j'avais écrit ma lettre de demande de suspension de formation en date du 31/10/2014 alors que je passée en conseil pédagogique le 07/11/2014. Le directeur a accepté ma lettre en disant qu'il ne savait pas ce que ça pourrait faire en vue de la décision. Mais la personne de la FNESI m'a dit que normalement en date de la lettre de demande de suspension de formation je n'aurai pas dû être considérée étudiante infirmière après même en cas d'une procédure pédagogique engagée car c'est un droit de l'étudiant d'arrêter sa formation.
Qu'en est il d'une demande de suspension de formation lorsqu'une procédure pédagogique est en cours ? Je sais que c'est un peu facile de dire j'arrête mes études pour sauver son diplôme aide soignant par exemple mais je devais le tenter au moins.
Merci encore à tous pour votre aide et désolé du fil que je vous ai donné à retordre.
Bonne fin d'après midi
Dernière modification par Coccidu29 le 28 oct. 2015 16:05, modifié 1 fois.
-
myloma
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
je ne suis pas au fait de ce qui est légal ou non, mon diplôme étant ancien et des modifications de formation nombreuses depuis 
d'autres que moi auront peut être des réponses
d'autres que moi auront peut être des réponses
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
Pas de soucis myloma, vous m'avez déjà bien aidée  mais à ce qu'on m'à dit à la fnesi, lorsque la directeur à accepté ma lettre de demande d'arrêt j'aurai du quitter l'ifsi avec mon diplome d'as. C'est un peu facile certes, c'est pour ça que je voulais votre avis. Dans tous les cas va sera un argument de poids le fait que j'avais demandé min arrêt et donc que j'assume mes erreurs..
mais à ce qu'on m'à dit à la fnesi, lorsque la directeur à accepté ma lettre de demande d'arrêt j'aurai du quitter l'ifsi avec mon diplome d'as. C'est un peu facile certes, c'est pour ça que je voulais votre avis. Dans tous les cas va sera un argument de poids le fait que j'avais demandé min arrêt et donc que j'assume mes erreurs..
Pour clore le sujet de mon expérience professionnelle depuis un an,j'en dirai le moins possible. Je dirai juste que j'étais ash et si ils me demandent si j'étais dans les soins que dirai que parfois ça m'arrivait d'aider les aide soignantes en binome mais c'est tout. Pas que j'étais toujours dans les soins. De toute façon je trouverai une formulation pour en dire le moins possible comme vous m'avez conseillé
Merci à toutes pour vos conseils depuis quelques jours ! J'ai pu bien améliorer ma lettre grâce à vous, on verra ce que ça va donner ! Au moins je n'aurai pas de regrets
Pour clore le sujet de mon expérience professionnelle depuis un an,j'en dirai le moins possible. Je dirai juste que j'étais ash et si ils me demandent si j'étais dans les soins que dirai que parfois ça m'arrivait d'aider les aide soignantes en binome mais c'est tout. Pas que j'étais toujours dans les soins. De toute façon je trouverai une formulation pour en dire le moins possible comme vous m'avez conseillé
Merci à toutes pour vos conseils depuis quelques jours ! J'ai pu bien améliorer ma lettre grâce à vous, on verra ce que ça va donner ! Au moins je n'aurai pas de regrets
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
Tout dépend à quel moment il a été décidé la réunion du conseil pedagogique
Pour statuer votre cas
Sinon interprétez en votre faveur les art 38 et39 de
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0000277377
Si la FNSI A DIT C est que C est vrai
E qui est important dans le rapport à la législation (et les contrats. Contrat entre esi et direction par exemple) est d être de bonne foi... C est dans le code civil....
Pour statuer votre cas
Sinon interprétez en votre faveur les art 38 et39 de
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0000277377
Si la FNSI A DIT C est que C est vrai
E qui est important dans le rapport à la législation (et les contrats. Contrat entre esi et direction par exemple) est d être de bonne foi... C est dans le code civil....
Dernière modification par wyllette le 27 oct. 2015 18:45, modifié 1 fois.
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
Santé gouv.;exclusion d'un ifsi et diplôme aide soignante......je ne sais plus,tu es exclue après un conseil pédagogique ou disciplinaire?
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
oups!modifié par arrêté du 28 sep 2011 qui ajoute conseil pédagogique
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
La réponse sur ce que tu cherches sont la
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0000277377
Fonctionnement des ifsi dont conseil de discipline et pédagogique. Ici nous sommes dasns le conseil pedagogique il n y a pas eu faute disciplinaire je pense
L esi à demande une suspension la réponse à été donné selon les modalités du conseil pedagogique qui a statué....conformément à la legislation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0000277377
Fonctionnement des ifsi dont conseil de discipline et pédagogique. Ici nous sommes dasns le conseil pedagogique il n y a pas eu faute disciplinaire je pense
L esi à demande une suspension la réponse à été donné selon les modalités du conseil pedagogique qui a statué....conformément à la legislation
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
De toute façon je serai toujours de bonne foi, j'aurai du mal à cacher l'expérience que j'ai eu depuis un an. Je trouverai une façon de tourner à mon avantage mon expérience professionnelle
Je n envoie mes lettres que en janvier environ, le temps de me préparer aux entretiens avec les directeurs en espérant avoir des réponses positives.
Merci encore à tous pour vos conseils ! Bonne journée
Je n envoie mes lettres que en janvier environ, le temps de me préparer aux entretiens avec les directeurs en espérant avoir des réponses positives.
Merci encore à tous pour vos conseils ! Bonne journée
Re: Je passe en Conseil pédago,disciplinaire,exclusion et ap
Une home qui me gêne :demande de suspension= légal et mais une demande attend une réponse.... Et la réponse à été donnée mais non conforme à ce que tu attendais
La bonne foi C estapplicable aux deux parties
Il e doit pas avoir de dol C est à dire de volonté de tromper l autre à tout moment
La bonne foi C estapplicable aux deux parties
Il e doit pas avoir de dol C est à dire de volonté de tromper l autre à tout moment