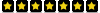racontez vos oraux
Modérateurs : Modérateurs, Concours IFSI
- Kryss
- Fidèle

- Messages : 187
- Inscription : 13 avr. 2006 10:23
- Localisation : J'vais faire comme tout le monde: j'vous le dirais pas!
- Contact :
Re: oral 2006 charles perrens
kelly04 a écrit :fabienne64 a écrit :bonjour. je viens de passer aujourd'hui l'oral à Charles Perrens à Bordeaux. Le sujet que j'ai eu était : " Devons-nous avoir peur de la science?"
Je vous avoue de suite que , sur le coup, le sujet ne m'a pas branché....mais alors pas du tout !!
Quand je l'ai lu je me suis dit
Ma discussion sur le sujet n'était donc pas super élaborée........mais je crois avoir bien réussi à parler de mes motivations. J'espère que cela a amélioré ma triste prestation d'avec le sujet mais je ne sais pas. maintenant j'attends.
Quelqu'un peut il me dire QUAND sont les résultats définitifs pour cet IFSI ? merci. a bientot.
qu'est ce que tu as dit en gros pour un sujet comme ça? C'est plutot vaste non? Mais je pense que moi j'aurais parlé de bioéthique, de clonage, de diagnostic préimplantatoire, enfin de choses comme ça, mais toi t'a parlé de quoi?
Oui, comme kelly j'aurais parler des pbs éthiques, des déviances, de la pollution et tout cela dans une partie antithése...J'aurais aussi fait une partie thése avec tous les avantages donnés par les progrés scientifiques: l'allongement de l'espérance de vie, les soins palliatifs...
Alors, et toi??
Maman étudiante!... rêve de devenir puér...(qui sait?) 
Nouveau cru 2006/2009 à la CRF de Nîmes
Nouveau cru 2006/2009 à la CRF de Nîmes
- barbe noire
- Messages : 7
- Inscription : 01 juin 2006 18:05
- Localisation : hérault
moi aussi ce sont mes parents qui financeront mes études mais je fait des petits boulo pendant les vacances pour ne pas être trop dépendante : travail agricole (en équipe), baby-sitting, centre aéré....
il ne faut pas avoir honte parce que se sont tes parents qui payent, mais il aut avoir conscience de ta chance.
de + c'est très difficile d'obtenir une bouse
il ne faut pas avoir honte parce que se sont tes parents qui payent, mais il aut avoir conscience de ta chance.
de + c'est très difficile d'obtenir une bouse
Pour ma part j'ai déjà négocié mon licenciement pour le 30 juin, on cherche actuellement un "motif réel et sérieux" avec mon patron et la comptable (espérons que ça ne pose pas de problème). Mon patron, fan de foot, estime que "quand un joueur veut partir, ça sert à rien de le garder, pour qui fasse un boulot de merde" ( bon point de vue). La difficulté est de trouver rapidement quelqu'un pour me remplacer.
Si jamais je n'ai pas mon concours, je touche les ASSEDIC et je cherche un boulot dans l'hospitalier (ASH ou autre).
Aux oraux j'annonce mon départ comme une fin de contrat CDD, ils ont pas besoin de connaitre les détails. Tu t'es démerdé pour trouver un financement, la manière ne les concerne pas (de mon point de vue).
dadoo, (passé Annecy à l'oral, Oral à Thonon le 8 juin)
Si jamais je n'ai pas mon concours, je touche les ASSEDIC et je cherche un boulot dans l'hospitalier (ASH ou autre).
Aux oraux j'annonce mon départ comme une fin de contrat CDD, ils ont pas besoin de connaitre les détails. Tu t'es démerdé pour trouver un financement, la manière ne les concerne pas (de mon point de vue).
dadoo, (passé Annecy à l'oral, Oral à Thonon le 8 juin)
genecpa a écrit :de + c'est très difficile d'obtenir une bouse
Déjà qu'une bourse c'est pas évident à avoir alors une bouse...


Un peu plus sérieusement, pour les bourses c'est très sélectif. Pour plus de renseignements, vous pouvez regarder dans ce document.
Bonjour,
Comme le lien ne marche pas pour tout le monde, je copie colle l'article.
Comme le lien ne marche pas pour tout le monde, je copie colle l'article.
Issu de ce lien a écrit :INFIRMIERES, MEDECINS, POURQUOI SOIGNER ? Fin de la vocation et saintes laïques
Posted on Vendredi, septembre 17 @ 09:59:13 CEST by
- Pourquoi soigner ? Chacun sa route
- On ne naît pas soignant, on le devient ; une assertion qui semble enfoncer les portes ouvertes mais qui véhicule bon nombre de rites, d'espoirs, de frustrations parfois et de bonheurs aussi. Chronique d'un chemin semé d'embûches...
- Les motivations des candidats aux métiers de soin sont rarement exprimées avec lucidité. Certes, on entend souvent cette "envie de s'occuper des autres" qui semble, au fil des interviews, de plus en plus opaque ; les arguments s'arrêtant à ce stade la plupart du temps. C'est peut-être lorsque qu'ils admettent qu'ils ressentent le besoin de "se sentir utiles" que les soignants s'approchent au plus près de d'un embryon de vérité, si tant est que cette vérité existe... "Chacun sa route ; chacun son chemin", chantait Tonton David. Ainsi, ils sont nombreux à être "tombés dedans" presque par hasard. Une situation, peut-être, de plus en plus fréquente. Parmi ceux-ci, Christine Kasperczak, entrée en Ifsi en 1981, n'hésite pas à confier : "Au départ, un petit Bac en poche et besoin de gagner ma vie : concours infirmier psy car, à l'époque, les études étaient rémunérées. Puis, au fur et à mesure, j'ai découvert les diverses possibilités de ce métier, un contact très enrichissant, aussi bien avec les patients qu'avec les collègues. Chaque jour, j'apprends…"
- Philosophiquement vôtre…
Il faudra donc admettre qui le monde professionnel a changé, désormais à des années lumières de l'époque où certains faisaient toute leur carrière en ligne droite. "Cette notion s'est modifiée au profit de celle de trajectoire." Explique Hervé-Pierre Parpaillon, professeur de philosophe à l'université Bordeaux III. "Par ailleurs, les milieux soignants sont en train d'intégrer le principe d'évaluation de la qualité de leur travail, qui est plus ou moins bien comprise dans les établissements hospitaliers. A travers cette intégration, on rejoint une façon de travailler qui va entraîner beaucoup de bouleversements. Le soignant va devenir, de plus en plus, gestionnaire de son poste de travail. Des concepts serinés dans les réunions qualité mais à la sortie, les infirmières ont toujours quarante patients en charge… Pour moi, cela donne naissance aux conditions optimales du 'burn-out'." Pas très optimiste le philosophe ! Cela dit, son rôle n'est pas de caresser dans le sens du poil mais de constater l'évolution de la société, de pointer le doute et de contraindre à la réflexion.
Heureusement, dans le soin, il y a aussi du plaisir donné et du plaisir reçu. C'est cela qui en fait avancer plus d'un. La preuve, il arrive également que le métier de soin s'impose au hasard d'une expérience personnelle. Patricia a 40 ans. Elle a quitté l'école en seconde pour suivre un cursus d'esthéticienne, un métier qui la décevra très vite. C'est au décours d'une conversation avec une amie qui travaille à la mairie de son agglomération, qu'elle se retrouve à faire des remplacements d'aide à domicile pendant 6 mois. Une révélation ! "Mon plus grand plaisir, c'est de discuter avec les gens. Il faut prendre le temps d'écouter les personnes âgées. Elles ont plein de choses à nous dire ; encore plus à nous apprendre !" s'enthousiasme-t-elle. Résultat : Patricia a décidé de préparer le concours d'entrée à la formation d'aide soignante. Un projet bâti sur de solides motivations, déjà passées à l'épreuve des aléas de la pratique.
Dans d'autre cas, c'est la survenue d'une pathologie chez un proche qui change tout. Exactement le cas de Jean-Jacques Schwer, dont le père est atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est à 44 ans, lorsqu'il s'est rendu compte que la "garde malade" de son père avait "tendance à l'infantiliser" que cet homme spécialisé en informatique, robotique et mécanique, a laissé tomber la société qu'il avait créée pour "prendre le taureau par les cornes". "J'ai cherché une personne pour l'aider, mais je n'ai malheureusement pas trouvé des gens qui soient qualifiés, notamment pour l'accompagnement psychologique des personnes âgées." Explique-t-il. Une fois installé avec son père, Jean-Jacques Schwer accumule donc les stages et les formations : gestion de la douleur, psychologie, gestion pratique de la toilette, etc. Un an après, il se dit "passionné par cette reconversion presque forcée" et continue à se former à haut niveau. Il accompagne également d'autres personnes atteintes de démences et constate une amélioration de l'état de son père.
- Les "saintes laïques"
Anthropologue et directeur de recherche au CNRS, de Marie-Christine Pouchelle ("L'hôpital corps et âme" édité chez Seli Arslan), a passé cinq ans au sein d'un important hôpital chirurgical d'Ile de France afin d'y mener une étude approfondie de l'anthropologie hospitalière. Elle écrit : "Bien que les choses aient notablement changé dans les réalités et les images de la profession, les surveillantes qui furent jeunes infirmières il y a vingt ou trente ans ont parfois conservé cet état d'esprit (ne pas compter son temps NDLR) : j'entends encore l'une d'entre elles m'expliquer qu'il n'était pas question de 'mercredis' dans ses équipes (1993). Tout cela nous renvoie aux 'saintes laïques', issues des origines de la profession, origines encore très présentes puisque les dernières religieuses n'ont quitté l'hôpital publique qu'au début des années 1970."
Une histoire qui semble, en effet, peser un sacré poids dans les mentalités. Pourtant, pas toujours si saintes, les laïques ! Françoise, une jeune étudiante en dernière année d'études témoignait anonymement en 2002, sur un site Internet : "Côtoyer certains 'soignants' qui s'arrogent le droit de maltraiter et de mépriser leurs patients parce qu'ils ne sont pas 'gentils' est une épreuve parfois insoutenable. Surtout si on est étudiante infirmière et qu'on ne peut rien dire puisque le stage sera sanctionné par des points. (…) En début de première année, nous étions quatre fois plus nombreuses. Il y a certainement beaucoup de raisons pour que des étudiants arrêtent leurs études, qu'elles soient trop dures ou ne correspondent pas à l'image attendue. Mais je reste persuadée que la perte de l'idéal de départ est encore une raison majoritaire à cette hécatombe." Un idéal durement mis à l'épreuve dans des cas comme ceux qui sont décrits plus haut, mais pas seulement.
Dans l'ouvrage "Formateurs et formations"*, les auteurs s'efforcent d'analyser les étapes de cette épreuve du feu constitué par les temps de stage. Dans un court chapitre intitulé "L'irruption des stagiaires dans un milieu (in)hospitalier", ils décrivent les efforts considérables que doivent produire les étudiants pour s'intégrer et l'impossibilité où ils sont souvent d'émettre quelque avis que ce soit sur les soins. L'exemple y est donné des arguments d'une stagiaire qui recherche le consensus, seul moyen pour elle de suivre son stage tranquillement : "C'est à moi de m'adapter, je ne veux pas les gêner. On n'a pas envie de bousculer leurs habitudes d'organisation." "L'étudiante découvre, lors de son immersion dans ce milieu, que, si tous les professionnels ont un accès direct aux patients, cet accès est strictement délimité et inégalement valorisé. (…) Les stagiaires apprennent cette hiérarchie (la hiérarchie des tâches selon leur degré de prestige NDLR) et ce principe de délégation du sale travail, ou plutôt elles sauront cela sans jamais l'avoir appris à l'école." Cependant, parmi les subtilités auxquelles les stagiaires doivent également faire face se trouve également l'antagonisme encore trop souvent observé entre les formateurs et les professionnels du terrain : "Les formateurs, dans les écoles, qui enseignent un métier qu'ils ne pratiquent plus ont une position ambiguë et souffrent eux aussi d'une carence de légitimité. (…) Souvent, leur position est précaire : dès que la situation d'un malade devient critique, leur compétence est dépassée, moins parce qu'ils ne savent plus réaliser les soins qui parce qu'ils n'ont pas toutes les données, que la validité du savoir professé à l'école est relativisé ou qu'il doive affronter la désapprobation des soignants."
- Perte de repères
François Dubet est professeur de sociologie à Bordeaux III et directeur de l'Ecole des hautes études en sciences sociales à Paris. Il s'est penché sur la profession de soignant, sujet d'une conférence qu'il a donnée aux dernières rencontres annuelles du Cefiec. Pour lui, c'est un travail qui s'est déroulé très longtemps au sein d'institutions à très forte légitimité, aux confluents des notions de compassion et de science. Mais également des "sanctuaires protégés des passions du monde" ; un mélange forcément "porteur" pour les soignants qui y travaillaient.
C'est l'évolution de notre société qui engendre des hiatus : "On peut se demander pourquoi, leur métier devenant moins lourd grâce à l'amélioration des médicaments et l'évolution des techniques, le métier d'infirmière est vécu de manière de plus en plus stressante et démotivant ? Une des réponses est à trouver dans l'accroissement du cadre institutionnel qui impose aux soignants de passer de plus en plus de temps à gérer du fonctionnement plutôt qu'à s'occuper des malades, signe que la société est entrée dans l'hôpital." Egalement, il évoque cet épineuse question de la vocation : "Elle a changé de nature. C'est un mot refusé. On ne fait plus ce métier pour sauver son âme. Il y a une perte de l'étayage symbolique ; du coup, le choc de la souffrance, de la maladie, de la saleté, on le prend en pleine figure." François Dubet présente néanmoins l'univers hospitalier comme "un monde qui a perdu ses équilibres mais qui n'est pas nostalgique pour autant." Il serait inimaginable, en effet, d'entendre une jeune recrue regretter l'âge des cornettes…
Et, puisque, contrairement à ce que professe le Petit Larousse (voir encadré), nous nous obstinerons ici à considérer les médecins comme des soignants, ils trouveront également leur place dans ces colonnes. Ainsi, Sylvie Salaün, généraliste à Fontainebleau, semble avoir perçu de manière précise le lien entre le soin qu'elle apporte à ses patients et le bonheur qu'elle en retire : "Au départ, je voulais simplement comprendre le corps. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des études de médecines après avoir eu un professeur de sciences extraordinaire en Terminale. Ce n'est qu'en quatrième année de médecine que j'ai véritablement découvert à quel point j'aime écouter et insuffler mon énergie à mes patients. D'un côté, je considère que je n'ai jamais sauvé personne ; de l'autre, je me rends compte qu'on peut sauver les gens de bien des manières" lance-t-elle, joviale. "Il ne faut pas soigner pour être reconnu, sinon on est forcément frustré" ajoute-t-elle, avant de terminer : "De toutes manières, je suis moi-même, au cabinet ou ailleurs." Sylvie évoque ainsi un des éléments moteurs du plaisir de prendre soin : s'il suffisait d'enseigner la technique de soin, la formation des soignants serait indéniablement simplifiée. Il reste cependant une large composante humaine et humaniste à intégrer pour "bien soigner". Chantal Cateau est directrice d'Ifsi à Chartres et vice-présidente en charge de la formation des infirmières au Cefiec. Selon elle, la transmission de ses valeurs ne peut se faire correctement qu'en transmettant "par ce que l'on est", dans une sorte d'exemplarité. Sinon, elle n'en reste qu'au stade des mots ; presque du baratin. A l'époque où elle a fait ses études, " Il fallait seconder le médecin de manière assidue et docile, et courber l'échine. Actuellement, les jeunes n'ont plus la même représentation. Ils sont toujours prêts à donner, mais plus dans les mêmes conditions. On n'est plus corvéable à merci." Commente-t-elle en ajoutant que cette évolution est tout à fait favorable à "l'amélioration de la valeur de la profession". "Le plus dur pour les stagiaires est de se trouver confrontés à des professionnels usés, aigris". Commente-t-elle encore. "Nous devons tout mettre en œuvre pour préserver et nourrir leur envie du début. Lors du passage de la représentation idéale à la réalité, leur envie est souvent déconstruite. C'est important de les suivre pour les aider à reconstituer leur idéal, à rebondir sur du positif, à élaborer leur propre projet de carrière."
- L'exemple d'abord
Pour le sociologue François Dubet, c'est en effet la dynamique des services rencontrés qui garantit la motivation des étudiants ou des professionnels. Une motivation qui doit se réactiver régulièrement : "Le service est l'unité fondamentale. L'hôpital dans sa globalité n'a pas tellement de réalité pour l'infirmière." Cependant, c'est là aussi que l'érosion de la motivation du soignant s'opère parfois de la manière la plus criante. Un de ces exemples de silence douloureux et coupable est transcrit dans le livre de l'anthropologue Marie-Christine Pouchelle : "Tais-toi, tu n'as pas mal ! Le médecin est en colère. L'enfant ayant 'fait' (sic) un pneumothorax spontané (trois jours après une intervention cardiaque NDLR), il s'agit d'essayer de lui éviter une deuxième opération en glissant un petit cathéter dans la cavité pleurale (…). A vif, on le sait, c'est extrêmement douloureux, et par surcroît anxiogène non seulement pour l'enfant, mais aussi pour le praticien. (…) L'enfant est attaché, poignets et chevilles rivés au cadre du lit. Deux infirmières, en face du médecin, de l'autre coté du lit, une titulaire et une stagiaire. L'infirmière en poste, très doucement mais de façon très neutre, en pleine maîtrise professionnelle puisqu'elle donne l'exemple, caresse la tête de l'enfant. L'apprentie bloque les genoux qui ont tendance à remonter dans un réflexe de protection. Personne ne tient la main attachée, convulsée." Confirmant cette idée de la déconstruction, parfois délétère, des idéaux, l'anthropologue écrit : "Mais quelle place pour les infirmières et leurs cadres dans cet univers ? (…) La question revient à se demander avec qui et quoi les infirmières sont susceptibles de faire véritablement corps. Si certaines infirmières libérales sont relativement proches de leurs patients, parce qu'elles sont moins directement contrôlées par le pouvoir médico-hospitalier, les infirmières hospitalières quant à elles, sont jugées, dès leurs premiers stages, sur leur capacité de faire corps, non avec le patient, mais avec l'équipe soignante en place, et par là avec l'institution (…). C'est pour certaines débutantes une découverte parfois traumatisante, surtout lorsqu'elles sont témoins de comportements qui sont à l'opposé de ce qu'elles imaginaient. (…) Faire corps avec le malade dans ce genre de situation, c'est s'exclure du milieu professionnel. La néophyte a-t-elle vraiment le choix ? Il ne lui reste plus, bien souvent, qu'à se blinder le plus vite possible en développant un clivage intérieur suffisamment étanche. Quitte à rêver de transformer un jour le système, si elle se retrouve aux commandes."
Claudie est infirmière en Seine et Marne. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a choisi ce métier, elle n'hésite pas une seconde : "Je voulais prendre soin des enfants." Pendant 9 ans, elle a exercé avec bonheur en réanimation pédiatrique à Necker, jusqu'à la naissance de son premier enfant et un déménagement en Seine et Marne. Elle décide de reprendre son métier et accepte un poste en pédiatrie à proximité de son domicile. Une expérience qui atteint durement ses motivations les plus fortes : "C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Lorsque je rentre le soir, je me sens mal. Je me demande si j'ai pris des 'mauvaises habitudes' à Necker où nous faisions preuve d'une très grande rigueur dans tous les domaines, spécialement dans l'évaluation de la douleur des petits. Ici, c'est l'âge de pierre : je vois des enfants se recroqueviller dans leur souffrance sans que personne ne s'en aperçoive au sein de l'équipe infirmière. Pour la première fois de ma vie, je me pose des questions sur mon métier, ce qui n'était jamais arrivé, même quand j'ai fait de l'intérim." Déplore-t-elle.
- Me reconnais-tu ?
Pour échapper à cette ambiance usante, Claudie envisage une formation complémentaire. Peut-être deviendra-t-elle cadre à son tour, espérant faire changer les choses ? Un choix qui, selon Marie-Christine Pouchelle, ne règle pourtant aucune des frustrations citées précédemment : "Il apparaît que dans les motivations pour devenir cadre, il y a finalement le désir de s'éloigner enfin des espaces de souffrance et donc des soins. D'échapper au quotidien. (…) Enfin reconnues comme bien 'cortiquées', capables de penser et non panser, philosopher bien loin du corps, de ses malheurs et de ses ordures. C'est oublier que pour nombre de nos grands philosophes, à commencer par Montaigne, l'incarnation humaine est au contraire, jusque dans ses réalités les plus dégoûtantes, le terreau nourricier et la finalité de toute philosophie. Il semble que les cadres, une fois sorties de leur école et redescendues sur Terre, dans un service hospitalier, se retrouvent fréquemment avec un corps, le leur, qui de toute manière souffre, en même temps que leurs ouailles leur reproche de ne plus faire corps, justement. (…) Aux prises avec les infirmières de base qui leur reproche de ne plus être 'dans les soins', avec le casse-tête des plannings, avec la navigation à vue entre les pouvoirs administratifs et médicaux, avec la gestion des ressources et, enfin, confrontées à la concurrence des autres cadres de l'hôpital." Des affirmations violentes, certes. Mais sont-elles à rejeter pour autant ? Ne trouvent-elles pas leur part de vérité dans le parcours des unes ou des autres ? Pour une infirmière qui continue comme Claudie à croire en son métier malgré les écueils de son parcours professionnel, combien choisissent de quitter définitivement leur métier ? Une des plaintes le plus souvent formulées par les soignants et cause probable de leurs désillusions, voire même de leur départ vers d'autres horizons professionnels, est le sentiment de manque de reconnaissance. "Les infirmières veulent maintenant être reconnues dans leur singularité, au niveau du coût psychique de leur travail. Il y a là une sorte de narcissisme à propos duquel il faudrait se poser des questions. Autrefois, il y avait cette gloire de faire don de soi aux autres, à Dieu, et au chef de service (ce qui est de l'ordre du fantasme). Or, maintenant, il faut être capable de supporter sa souffrance personnelle, celle des autres, la mort, la saleté, sans le recours de Dieu ni de l'institution." Explique le sociologue François Dubet, avant d'ajouter : "Il y a une désacralisation de la relation. Je pense à une vieille histoire qui circulait autrefois dans les hôpitaux : 'Quelle est la différence entre un chirurgien et Dieu ? C'est que Dieu ne se prend pas pour un chirurgien.' C'est de moins en moins comme ça, ce qui est loin d'être un mal mais entraîne une perte de repères. Cela dit, il ne faudrait pas perdre de vue que cette nouvelle organisation rend le travail des infirmière beaucoup plus intéressant quand même." Alors pourquoi cette insatisfaction endémique au sein du métier d'infirmière ? Selon François Dubet, un certain "goût de la plainte" se serait développé au sein de la profession, après la perte de sa "légitimité sacrée". La position de victime étant un des moyens de se faire reconnaître. Un moyen tellement peu efficace qu'il aboutit à un schéma de "serpent qui se mord la queue", tant les professionnelles sabordent l'image de leur métier.
- Soigner sans guérir
Face à l'évolution des temps et la chronicisation croissante des pires pathologies, le soignant guérit de moins en moins et soigne de plus en plus. Une donne que bien peu sont préparés à accepter. Le psychosociologue Patrice Couric la commente : "Les soignants restent trop souvent dans une logique de guérir alors que leur rôle est appelé à devenir plus éducatif que curatif. Cela engendre des frustrations importantes, d'autant que chez les infirmières, la charge de travail n'en est pas diminuée pour autant. Le soignant perd peu à peu son statut supérieur pour ne devenir que l'acteur d'une 'étape" du projet de soin du patient. Accompagner, ça change le rapport. On passe du rapport de soin actif à l'accompagnement d'une démarche personnelle. La profession infirmière a parfois du mal à l'admettre." Dans l'ouvrage de Marie-Christine Pouchelle, on peut d'ailleurs lire : "Ecouter les patients pour de bon, autrement dit, reconnaître le caractère significatif de leur ressenti le plus intime, c'est être amené à remettre en question cette dichotomie issue d'une conception toute médico-scientifique du traitement, sans bien sûr nier pour autant la nécessité des actes les plus techniques à certains moments". Selon François Dubet, le sociologue, "Avec l'entrée du malade dans le processus de soins, il est de moins en moins réductible à sa maladie. Il faut s'occuper des personnes. C'est une évolution qui valorise les infirmières mais qui rend leur travail encore plus difficile. Sans cesse, elles sont tiraillées entre trois faces de leur métier : la technologie du soin qui se renforce, la relation qui est devenue impérative, et la bureaucratie qui prend de plus en plus de place." Pour une note d'espoir, laissons le mot de la fin à Christine, "tombée" presque par hasard "dans la marmite" du soin : "Rien n'est acquis. Tout se construit en permanence. Voilà les raisons pour lesquelles je suis soignante et je le reste. Au revoir."
- Laure de Montalembert
Avec l'aimable autorisation du rédacteur en chef du magazine infirmière magazine pour medito, et la chaleureuse complicité de Laure
Bonjour à tous!
J'ai une petite question qui m'angoisse un peu: je suis passée à l'oral et ils m'ont demandé comment je réagissais aux conflits et ce que je ferais si un médecin me demandait de faire quelque chose à un patient que moi je pensais mauvais pour le patient. J'ai répondu que si le médecin ne voulait pas en discuter, je ne ferais pas ce qu'il me demande contre ma conscience.
Alors est-ce que j'ai bien fait? ou est-ce qu'une infirmière doit faire tout ce que lui demande le médecin en fermant les yeux meme si c'est contre son gré?
Rassurez moi!!
J'ai une petite question qui m'angoisse un peu: je suis passée à l'oral et ils m'ont demandé comment je réagissais aux conflits et ce que je ferais si un médecin me demandait de faire quelque chose à un patient que moi je pensais mauvais pour le patient. J'ai répondu que si le médecin ne voulait pas en discuter, je ne ferais pas ce qu'il me demande contre ma conscience.
Alors est-ce que j'ai bien fait? ou est-ce qu'une infirmière doit faire tout ce que lui demande le médecin en fermant les yeux meme si c'est contre son gré?
Rassurez moi!!
- Lilou_44
- Insatiable

- Messages : 536
- Inscription : 08 janv. 2006 13:39
- Localisation : voyage entre le 44 et le 72
unejcfe a écrit :Bonjour à tous!
J'ai une petite question qui m'angoisse un peu: je suis passée à l'oral et ils m'ont demandé comment je réagissais aux conflits et ce que je ferais si un médecin me demandait de faire quelque chose à un patient que moi je pensais mauvais pour le patient. J'ai répondu que si le médecin ne voulait pas en discuter, je ne ferais pas ce qu'il me demande contre ma conscience.
Alors est-ce que j'ai bien fait? ou est-ce qu'une infirmière doit faire tout ce que lui demande le médecin en fermant les yeux meme si c'est contre son gré?
Rassurez moi!!
jaurais repondu la meme chose mais apres en avoir discuter avec le cadre infirmier... selon sa décision
ESI 2006/2009 !
3è année qui se termine enfin...
Plus que le D.E à valider !
3è année qui se termine enfin...
Plus que le D.E à valider !
- Lolalilala
- Forcené

- Messages : 280
- Inscription : 29 janv. 2005 21:50
- Localisation : Marseille