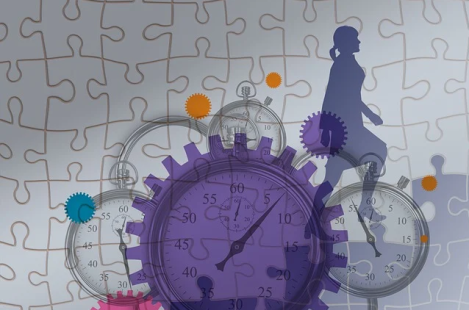D’aucuns définissent la compétence comme étant une situation naturelle à avoir des aptitudes alors que d’autres la considèrent comme une expression de la performance qui, elle-même, est le résultat dans l’exécution d’une tâche (approche sociologique de Larousse). La définition la plus appropriée pour nous ici est celle que donne Ledru. Elle privilégie « la capacité de résoudre les problèmes dans un contexte donné » qui englobe, au passage, l’approche du sens au travail donné aux équipes.
Une approche individuelle ou collective pour qualifier les tâches et activités
Dans une approche théorique, la compétence est intimement liée à la situation, à la tâche et à l’activité (Coulet, 2011). «Il s’avère qu’un même sujet, confronté à une même tâche, n’organise pas son activité de la même façon, selon les caractéristiques de la situation dans laquelle s’inscrit cette activité. A l’inverse, des sujets différents confrontés à une même tâche dans une même situation, peuvent interpréter cette situation de façon différente et, par conséquent, traiter la tâche différemment» (Coulet, 2011). Dans une autre mesure, il est possible d’avoir un cas de complémentarité des compétences entre deux sujets traitant la même tâche dans une configuration sociale donnée.
La nécessaire hiérarchisation des compétences dans une organisation
Par ailleurs, les « processus organisateurs de l’activité » sont importants dans la connaissance même de celle-ci. D’où l’intérêt des protocoles, des procédures, qui sont mis en place pour faciliter l’exécution de l’activité. La conception de logigrammes illustre bien la volonté de décrire l’activité qui peut avoir une multitude de tâches ayant un début et une fin. Un diagramme de Pert permet de hiérarchiser les tâches, les activités, celles qui doivent être effectuées en priorité en amont, avant d’entreprendre les autres. On parle de la hiérarchisation des tâches et des activités.
Nous retrouvons cette notion de hiérarchie chez Rasmussen (1986) lorsqu’il parle de décomposition de l’activité́ en «skills» (actions effectuées sans contrôle cognitif), «rules» (les conduites fondées sur des règles généralement explicables) et «knowledge» (conduites fondées sur l’utilisation des connaissances pour faire face à des situations inhabituelles). La prise en compte de cette question de la hiérarchisation est primordiale dans l’élaboration des référentiels de compétences ; ce qu’il convient de faire ou d’apprendre avant d’acquérir une nouvelle compétence.
Une dimension cognitive, technique et sociale
La notion de compétence est non seulement polysémique mais importante. Dans les années quatre-vingt-dix, elle a fait l’objet de nombreuses réflexions. On a parlé de bilans de compétences pour répondre à la problématique de l’employabilité et la gestion du « capital humain » en gestion des ressources humaine (GRH).
En dépit de la pluralité des définitions qui apparaît bien souvent consensuelle pour beaucoup d’auteurs, la littérature nous révèle qu’il y a une foisonnante diversité de conceptions. C’est ainsi que certains auteurs (comme Dietrich et al. 2002) pensent que «les ambiguïtés qui en résultent, loin de nuire à son utilisation, sont, au contraire, un facteur favorisant sa diffusion et son adaptation par un ensemble d’acteurs ayant pourtant des conceptions radicalement distinctes (sinon opposées)» (Coulet, 2011).
La compétence n’est pas seulement une somme de connaissances mais elle est aussi la façon dont on traite une information reçue, un savoir-faire.
Nous observons cependant, selon les auteurs, une double approche de la notion de compétence : celle qui privilégie la dimension cognitive ou technique d’une part et celle qui insiste sur la dimension sociale, affective et motivationnelle d’autre part (Cahour, 2006 ; Letor, 2006 cités par Coulet, 2011). Ainsi lorsqu’on définit la compétence comme «un ensemble stabilisé de savoirs et de savoir-faire, de conduites-types, de procédures standards, de types de raisonnements que l’on peut mettre en œuvre sans apprentissage nouveau», on est du côté de l’approche cognitive.
Å l’opposé, lorsque l’on énonce que «définir et reconnaitre la compétence d’un salarié ne résulte pas d’un choix définitif ni d’une évidence ; c’est le résultat, fragile et dynamique, d’une négociation invisible entre des auteurs variables et à des niveaux différents» (Defélix, 2005 cité par Coulet, 2011), on est du côté de l’approche essentiellement sociale de la compétence. Malgré́ la bipolarisation des deux approches, il peut arriver que certains auteurs les utilisent simultanément.
Les différents modes d’acquisition de la compétence
Comment acquérir la compétence? Il y a plusieurs voies. Premièrement, par le cursus universitaire : il permet d’avoir la compétence par le biais de la formation initiale et/ou par la formation continue (le développement des compétences).
Deuxièmement, par l’expérience : les stages en milieu professionnel permettent d’acquérir des compétences spécialisées. Il s’agit de mettre en pratique tous les enseignements théoriques qu’on a pu recevoir.
Troisièmement, par l’existence des réseaux. Nous savons l’importance des réseaux dans la construction des compétences par le biais de séminaires ou des conférences.
En conclusion : la compétence n’est pas seulement une somme de connaissances mais elle est aussi la façon dont on traite une information reçue, un savoir-faire. La compétence peut être personnelle, transversale ou technique au sein d’une organisation et son acquisition peut se faire de plusieurs manières.