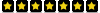Culture Générale
Modérateurs : Modérateurs, Concours IFSI
-
crepeaujambon
- Forcené

- Messages : 372
- Inscription : 18 mai 2006 14:19
- Localisation : sur un petit nuage !
CREATION D’UN CONGE DE SOUTIEN FAMILIAL
Depuis le 20 avril, salariés et non-salariés peuvent bénéficier d’un congé de soutien familial pour s’occuper d’un parent dépendant ou handicapé.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 a créé un nouveau congé pour événement familial : le congé de soutien familial.
Non rémunéré, il a pour vocation de permettre à toute personne exerçant une activité professionnelle, salariée ou non salariée, de s’occuper temporairement d’un parent dépendant ou très handicapé (conjoint, concubin, partenaire d’un pacte social de solidarité, ascendant, descendant...).
La durée du congé est de trois mois, renouvelable, dans la limite d’un an pendant toute une carrière. La personne aidée doit « résider en France de façon stable et régulière » et « ne pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié ».
Le décret d’application, paru au JO du 20 avril, a précisé les formalités liées à la demande, au renouvellement et à la fin anticipée du congé ainsi que les règles d’affiliation à l’assurance-vieillesse du parent au foyer (Avpf).
Demande à l’employeur
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit adresser à son employeur, au moins deux mois avant le début du congé, une lettre recommandée avec accusé de réception - ou lui remettre la demande en main propre - l’informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de son départ.
En cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de la personne aidée (attestée par un certificat médical) ou en cas de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l’établissement), ce délai est réduit à quinze jours.
A sa lettre recommandée, le demandeur doit joindre :
- une déclaration sur l’honneur attestant le lien familial entre lui et la personne aidée ;
- une déclaration sur l’honneur précisant qu’il n’a pas déjà eu recours à un congé de soutien familial ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle il a bénéficié d’un tel congé ;
- lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé, une copie de la décision de la Sécurité sociale ou de l’aide sociale indiquant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
- lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale (personnes les plus dépendantes).
Interruption ou prolongation
Le salarié qui souhaite mettre fin de façon anticipée à son congé de soutien familial dans des cas prévus par la loi (admission de la personne aidée en établissement, intervention d’un service d’aide à domicile, diminution importante des ressources...) doit adresser une demande motivée à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, au moins un mois avant la date souhaitée de fin de congé.
En cas de décès de la personne aidée, le délai est ramené à deux semaines. En cas de renouvellements successifs du congé, le salarié doit avertir son employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme initialement prévu, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Droits à la retraite
Pendant son congé, le salarié reste couvert par l’assurance-maladie et continue d’acquérir ses droits à la retraite au moyen de l’assurance-vieillesse de parent au foyer (Avpf).
L’affiliation prend effet le premier jour du congé et cesse à l’issue du dernier jour. Elle doit être demandée par le salarié auprès de l’organisme débiteur de prestations familiales (caisses d’allocations familiales et caisses de la Mutualité sociale agricole), et sous réserve de la présentation d’une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise de congé.
L’affiliation à l’Avpf du travailleur non salarié doit également être déposée à sa demande auprès de l’organisme débiteur de prestations familiales et sous réserve de produire des justificatifs en fonction de l’activité exercée (industrielle ou commerciale, artisanale, non salariée agricole ou libérale).
‹3/07/2007
Les autres congés
Le congé de soutien familial s’ajoute au congé de solidarité familiale et au congé de présence parentale, qui permettent d’accompagner respectivement un proche en fin de vie et un enfant à charge, gravement malade, handicapé ou accidenté.
Guide de l’aidant
Le ministère de la Santé et des Solidarités a mis en ligne un guide de l’aidant familial où sont regroupées des informations pratiques et des conseils sur les droits de l’aidant et de son proche dépendant. On peut télécharger ce guide sur www.gouv.famille.fr
Depuis le 20 avril, salariés et non-salariés peuvent bénéficier d’un congé de soutien familial pour s’occuper d’un parent dépendant ou handicapé.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 a créé un nouveau congé pour événement familial : le congé de soutien familial.
Non rémunéré, il a pour vocation de permettre à toute personne exerçant une activité professionnelle, salariée ou non salariée, de s’occuper temporairement d’un parent dépendant ou très handicapé (conjoint, concubin, partenaire d’un pacte social de solidarité, ascendant, descendant...).
La durée du congé est de trois mois, renouvelable, dans la limite d’un an pendant toute une carrière. La personne aidée doit « résider en France de façon stable et régulière » et « ne pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié ».
Le décret d’application, paru au JO du 20 avril, a précisé les formalités liées à la demande, au renouvellement et à la fin anticipée du congé ainsi que les règles d’affiliation à l’assurance-vieillesse du parent au foyer (Avpf).
Demande à l’employeur
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit adresser à son employeur, au moins deux mois avant le début du congé, une lettre recommandée avec accusé de réception - ou lui remettre la demande en main propre - l’informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de son départ.
En cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de la personne aidée (attestée par un certificat médical) ou en cas de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l’établissement), ce délai est réduit à quinze jours.
A sa lettre recommandée, le demandeur doit joindre :
- une déclaration sur l’honneur attestant le lien familial entre lui et la personne aidée ;
- une déclaration sur l’honneur précisant qu’il n’a pas déjà eu recours à un congé de soutien familial ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle il a bénéficié d’un tel congé ;
- lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé, une copie de la décision de la Sécurité sociale ou de l’aide sociale indiquant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
- lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale (personnes les plus dépendantes).
Interruption ou prolongation
Le salarié qui souhaite mettre fin de façon anticipée à son congé de soutien familial dans des cas prévus par la loi (admission de la personne aidée en établissement, intervention d’un service d’aide à domicile, diminution importante des ressources...) doit adresser une demande motivée à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, au moins un mois avant la date souhaitée de fin de congé.
En cas de décès de la personne aidée, le délai est ramené à deux semaines. En cas de renouvellements successifs du congé, le salarié doit avertir son employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme initialement prévu, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Droits à la retraite
Pendant son congé, le salarié reste couvert par l’assurance-maladie et continue d’acquérir ses droits à la retraite au moyen de l’assurance-vieillesse de parent au foyer (Avpf).
L’affiliation prend effet le premier jour du congé et cesse à l’issue du dernier jour. Elle doit être demandée par le salarié auprès de l’organisme débiteur de prestations familiales (caisses d’allocations familiales et caisses de la Mutualité sociale agricole), et sous réserve de la présentation d’une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise de congé.
L’affiliation à l’Avpf du travailleur non salarié doit également être déposée à sa demande auprès de l’organisme débiteur de prestations familiales et sous réserve de produire des justificatifs en fonction de l’activité exercée (industrielle ou commerciale, artisanale, non salariée agricole ou libérale).
‹3/07/2007
Les autres congés
Le congé de soutien familial s’ajoute au congé de solidarité familiale et au congé de présence parentale, qui permettent d’accompagner respectivement un proche en fin de vie et un enfant à charge, gravement malade, handicapé ou accidenté.
Guide de l’aidant
Le ministère de la Santé et des Solidarités a mis en ligne un guide de l’aidant familial où sont regroupées des informations pratiques et des conseils sur les droits de l’aidant et de son proche dépendant. On peut télécharger ce guide sur www.gouv.famille.fr
En mode reconversion totale PDT_028
Reçue en Juillet 2007 PDT_002 Après 1 an d'attente ma demande de financement a enfin été acceptée PDT_020 ESI Promo 2008-2011 PDT_039
Reçue en Juillet 2007 PDT_002 Après 1 an d'attente ma demande de financement a enfin été acceptée PDT_020 ESI Promo 2008-2011 PDT_039
-
crepeaujambon
- Forcené

- Messages : 372
- Inscription : 18 mai 2006 14:19
- Localisation : sur un petit nuage !
QUAND NOTRE ENVIRONNEMENT NOUS EMPOISONNE
Pollution, produits chimiques, Ogm... Quelles conséquences sur la santé ? Les moins pessimistes estiment que l’environnement serait responsable chaque année de 5 000 décès par cancer. Les plus inquiets parlent de beaucoup plus.
Difficile de savoir : le corps de chacun d’entre nous recèle des traces de plusieurs produits chimiques, et il faut des années entre l’exposition à une substance et le déclenchement de la maladie qu’elle provoque. Néanmoins, les soupçons pèsent.
L’air pollué est incriminé dans la montée des allergies et de l’asthme : il tue 30 000 personnes de moins de 65 ans par an. Les pesticides, utilisés en agriculture mais aussi dans les jardins et les maisons, sont suspectés de causer des malformations sexuelles chez les nouveau-nés, des leucémies chez les enfants, certains cancers et la maladie de Parkinson chez les agriculteurs, une baisse de la fertilité masculine...
Quant aux Ogm, on n’en sait pas grand-chose, mais une étude indépendante récente montre qu’un maïs transgénique déjà commercialisé a entraîné des troubles hépatiques et urinaires chez les rats de laboratoire.
Face à ces nouveaux dangers, faudra-t-il créer une médecine « environnementale » ? Des scientifiques se penchent sur la question. Car, aujourd’hui, il n’y a pas que les microbes et les virus qui sont dangereux pour la santé.
‹3/05/2007
Pollution, produits chimiques, Ogm... Quelles conséquences sur la santé ? Les moins pessimistes estiment que l’environnement serait responsable chaque année de 5 000 décès par cancer. Les plus inquiets parlent de beaucoup plus.
Difficile de savoir : le corps de chacun d’entre nous recèle des traces de plusieurs produits chimiques, et il faut des années entre l’exposition à une substance et le déclenchement de la maladie qu’elle provoque. Néanmoins, les soupçons pèsent.
L’air pollué est incriminé dans la montée des allergies et de l’asthme : il tue 30 000 personnes de moins de 65 ans par an. Les pesticides, utilisés en agriculture mais aussi dans les jardins et les maisons, sont suspectés de causer des malformations sexuelles chez les nouveau-nés, des leucémies chez les enfants, certains cancers et la maladie de Parkinson chez les agriculteurs, une baisse de la fertilité masculine...
Quant aux Ogm, on n’en sait pas grand-chose, mais une étude indépendante récente montre qu’un maïs transgénique déjà commercialisé a entraîné des troubles hépatiques et urinaires chez les rats de laboratoire.
Face à ces nouveaux dangers, faudra-t-il créer une médecine « environnementale » ? Des scientifiques se penchent sur la question. Car, aujourd’hui, il n’y a pas que les microbes et les virus qui sont dangereux pour la santé.
‹3/05/2007
En mode reconversion totale PDT_028
Reçue en Juillet 2007 PDT_002 Après 1 an d'attente ma demande de financement a enfin été acceptée PDT_020 ESI Promo 2008-2011 PDT_039
Reçue en Juillet 2007 PDT_002 Après 1 an d'attente ma demande de financement a enfin été acceptée PDT_020 ESI Promo 2008-2011 PDT_039
-
crepeaujambon
- Forcené

- Messages : 372
- Inscription : 18 mai 2006 14:19
- Localisation : sur un petit nuage !
LA CARTE VITALE 2
La diffusion de la carte Vitale 2 a commencé cette année. Quels renseignements comportera-t-elle ? Nécessitera-t-elle des démarches particulières ? Quelle sera sa durée de validité ? Quel est le calendrier de sa diffusion ?
Ce qui change
La carte Vitale 2 comporte la photo du titulaire. D’une capacité plus importante (32 ko au lieu de 2 ko), elle contient, en plus de renseignements administratifs, des données personnelles relatives à :
- la désignation du médecin traitant ;
- la personne à prévenir en cas d’urgence ;
- la protection maladie complémentaire. Elle précise en outre que l’assuré a bien bénéficié d’une information sur le don d’organes et sur la manière de faire connaître sa position.
Pas de démarche particulière
Vous n’aurez à effectuer aucune démarche. Votre caisse primaire vous enverra un formulaire pour recueillir les informations nécessaires à la délivrance de la carte. Ce document rempli doit être renvoyé, accompagné d’une photo et de la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité portant votre photo. Vous pouvez aussi le déposer au guichet.
Si vous n’avez pas de pièce d’identité, vous devez vous présenter au guichet de votre caisse d’assurance-maladie afin de permettre la vérification de votre identité et remettre les documents.
Mise à jour
Le titulaire de la carte est tenu d’effectuer une mise à jour en cas de changement de situation. Dans un premier temps, il doit avertir sa caisse du changement. Lorsque celle-ci lui confirme que la modification a bien été prise en compte, l’assuré dispose d’un mois pour mettre sa carte à jour. (Pour mémoire, cette opération s’effectue dans les bornes prévues à cet effet.) A défaut, la carte ne peut plus être utilisée.
En outre, elle doit être mise à jour tous les ans. Sinon le titulaire perd le bénéfice du tiers payant (dispense d’avance des frais médicaux). La mise à jour lors d’un changement de situation dispense de la mise à jour annuelle.
Durée de validité
La période de validité de la nouvelle carte est de cinq ans. Mais votre caisse peut décider de la prolonger. Vous êtes alors tenu de procéder à sa mise à jour. Si votre caisse ne la prolonge pas, elle est tenue de vous en délivrer une nouvelle.
Une diffusion sur quatre ans
La diffusion de la carte Vitale 2 a commencé en Bretagne en mars et les premières cartes ont été adressées aux assurés dès le début avril.
Sa distribution devrait continuer dans les Pays de la Loire à la mi-juin avant de s’étendre au reste de la France dès septembre. Les nouvelles cartes Vitale seront d’abord distribuées aux assurés n’en ayant pas encore (nouveaux bénéficiaires, jeunes atteignant l’âge de 16 ans), ainsi qu’à ceux dont les cartes (perdues, abîmées ou volées) doivent être remplacées. Le renouvellement de l’ensemble des cartes devrait être réalisé en quatre ans.
‹3/07/2007
La diffusion de la carte Vitale 2 a commencé cette année. Quels renseignements comportera-t-elle ? Nécessitera-t-elle des démarches particulières ? Quelle sera sa durée de validité ? Quel est le calendrier de sa diffusion ?
Ce qui change
La carte Vitale 2 comporte la photo du titulaire. D’une capacité plus importante (32 ko au lieu de 2 ko), elle contient, en plus de renseignements administratifs, des données personnelles relatives à :
- la désignation du médecin traitant ;
- la personne à prévenir en cas d’urgence ;
- la protection maladie complémentaire. Elle précise en outre que l’assuré a bien bénéficié d’une information sur le don d’organes et sur la manière de faire connaître sa position.
Pas de démarche particulière
Vous n’aurez à effectuer aucune démarche. Votre caisse primaire vous enverra un formulaire pour recueillir les informations nécessaires à la délivrance de la carte. Ce document rempli doit être renvoyé, accompagné d’une photo et de la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité portant votre photo. Vous pouvez aussi le déposer au guichet.
Si vous n’avez pas de pièce d’identité, vous devez vous présenter au guichet de votre caisse d’assurance-maladie afin de permettre la vérification de votre identité et remettre les documents.
Mise à jour
Le titulaire de la carte est tenu d’effectuer une mise à jour en cas de changement de situation. Dans un premier temps, il doit avertir sa caisse du changement. Lorsque celle-ci lui confirme que la modification a bien été prise en compte, l’assuré dispose d’un mois pour mettre sa carte à jour. (Pour mémoire, cette opération s’effectue dans les bornes prévues à cet effet.) A défaut, la carte ne peut plus être utilisée.
En outre, elle doit être mise à jour tous les ans. Sinon le titulaire perd le bénéfice du tiers payant (dispense d’avance des frais médicaux). La mise à jour lors d’un changement de situation dispense de la mise à jour annuelle.
Durée de validité
La période de validité de la nouvelle carte est de cinq ans. Mais votre caisse peut décider de la prolonger. Vous êtes alors tenu de procéder à sa mise à jour. Si votre caisse ne la prolonge pas, elle est tenue de vous en délivrer une nouvelle.
Une diffusion sur quatre ans
La diffusion de la carte Vitale 2 a commencé en Bretagne en mars et les premières cartes ont été adressées aux assurés dès le début avril.
Sa distribution devrait continuer dans les Pays de la Loire à la mi-juin avant de s’étendre au reste de la France dès septembre. Les nouvelles cartes Vitale seront d’abord distribuées aux assurés n’en ayant pas encore (nouveaux bénéficiaires, jeunes atteignant l’âge de 16 ans), ainsi qu’à ceux dont les cartes (perdues, abîmées ou volées) doivent être remplacées. Le renouvellement de l’ensemble des cartes devrait être réalisé en quatre ans.
‹3/07/2007
En mode reconversion totale PDT_028
Reçue en Juillet 2007 PDT_002 Après 1 an d'attente ma demande de financement a enfin été acceptée PDT_020 ESI Promo 2008-2011 PDT_039
Reçue en Juillet 2007 PDT_002 Après 1 an d'attente ma demande de financement a enfin été acceptée PDT_020 ESI Promo 2008-2011 PDT_039
-
crepeaujambon
- Forcené

- Messages : 372
- Inscription : 18 mai 2006 14:19
- Localisation : sur un petit nuage !
GENERIQUES, DEPENSES ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE : 3 ETUDES DE L’ASSURANCE MALADIE
L’assurance maladie publie trois études. L’une sur le médicament générique, traite de leur nouvelle progression et du taux de pénétration. A fin mai 2007, le taux de pénétration des génériques s’élève à 74,5%, soit une hausse de 4,5 points par rapport à fin 2006. L’objectif de 75% fixé pour 2007 sera atteint, positionnant la France à un niveau comparable à celui de ses voisins européens.
La deuxième étude traite des dépenses de santé à l’horizon 2015. Le rapport met en évidence les dépenses de santé sur plus de 25 ans (1979-2006) avec une croissance annuelle de 1,3 point supérieure à celle du Pib en moyenne. Les années 90 se caractérisent par une augmentation progressive des dépenses d’assurance maladie et une forte aggravation du déficit entre 2001 et 2003, suite à une reprise de la hausse des dépenses en 1998. La mise en place de la réforme de 2004 a permis d’inverser cette tendance et de réduire ce déficit de près de 6 milliards d’euros sur 2 ans (de fin 2004 à fin 2006).
Le troisième dossier de l’assurance maladie concerne les contrôles et la lutte contre la fraude : "Comment l’Assurance Maladie agit et pour quels résultats ?"
En 2006, 143 personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme ou avec sursis pour avoir escroqué l’Assurance Maladie.
223 actions civiles et 1616 actions pénales ont été engagées. 351 interdictions de donner des soins allant de 1 mois à plus d’un an ont été prononcées par les Conseils des Ordres professionnels.
En décembre dernier, les premiers résultats du plan de contrôle national de l’Assurance Maladie montraient 6 fois plus de fraudes et abus détectés en 2006 qu’en 2005 pour un montant de 120 millions d’euros.
‹6/07/2007
L’assurance maladie publie trois études. L’une sur le médicament générique, traite de leur nouvelle progression et du taux de pénétration. A fin mai 2007, le taux de pénétration des génériques s’élève à 74,5%, soit une hausse de 4,5 points par rapport à fin 2006. L’objectif de 75% fixé pour 2007 sera atteint, positionnant la France à un niveau comparable à celui de ses voisins européens.
La deuxième étude traite des dépenses de santé à l’horizon 2015. Le rapport met en évidence les dépenses de santé sur plus de 25 ans (1979-2006) avec une croissance annuelle de 1,3 point supérieure à celle du Pib en moyenne. Les années 90 se caractérisent par une augmentation progressive des dépenses d’assurance maladie et une forte aggravation du déficit entre 2001 et 2003, suite à une reprise de la hausse des dépenses en 1998. La mise en place de la réforme de 2004 a permis d’inverser cette tendance et de réduire ce déficit de près de 6 milliards d’euros sur 2 ans (de fin 2004 à fin 2006).
Le troisième dossier de l’assurance maladie concerne les contrôles et la lutte contre la fraude : "Comment l’Assurance Maladie agit et pour quels résultats ?"
En 2006, 143 personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme ou avec sursis pour avoir escroqué l’Assurance Maladie.
223 actions civiles et 1616 actions pénales ont été engagées. 351 interdictions de donner des soins allant de 1 mois à plus d’un an ont été prononcées par les Conseils des Ordres professionnels.
En décembre dernier, les premiers résultats du plan de contrôle national de l’Assurance Maladie montraient 6 fois plus de fraudes et abus détectés en 2006 qu’en 2005 pour un montant de 120 millions d’euros.
‹6/07/2007
En mode reconversion totale PDT_028
Reçue en Juillet 2007 PDT_002 Après 1 an d'attente ma demande de financement a enfin été acceptée PDT_020 ESI Promo 2008-2011 PDT_039
Reçue en Juillet 2007 PDT_002 Après 1 an d'attente ma demande de financement a enfin été acceptée PDT_020 ESI Promo 2008-2011 PDT_039
-
crepeaujambon
- Forcené

- Messages : 372
- Inscription : 18 mai 2006 14:19
- Localisation : sur un petit nuage !
POUR DONNER VIA INTERNET
Une nouvelle forme de solidarité fait son apparition sur internet. En utilisant le navigateur solidaire fourni par iGraal à la Croix-Rouge française, les internautes peuvent en effet économiser des euros sur leurs achats en ligne… et les reverser en partie ou en intégralité à la Croix-Rouge.
En pratique, il suffit de télécharger ce navigateur à partir du site de la Croix-Rouge puis de l'installer sur son ordinateur. « L'utilisation est simple, gratuite et sans risque » souligne l'association dans un communiqué.
Chaque achat effectué par l'internaute sur l'un des 350 sites partenaires d'iGraal permet de collecter des euros, sous forme de reversement d'une commission. Ensuite, libre choix d'en faire don d'un simple clic à la Croix-Rouge. Précisons enfin que ce don peut donner lieu à l'émission d'un reçu fiscal.
Source : Croix-Rouge, 13 juin 2007
Une nouvelle forme de solidarité fait son apparition sur internet. En utilisant le navigateur solidaire fourni par iGraal à la Croix-Rouge française, les internautes peuvent en effet économiser des euros sur leurs achats en ligne… et les reverser en partie ou en intégralité à la Croix-Rouge.
En pratique, il suffit de télécharger ce navigateur à partir du site de la Croix-Rouge puis de l'installer sur son ordinateur. « L'utilisation est simple, gratuite et sans risque » souligne l'association dans un communiqué.
Chaque achat effectué par l'internaute sur l'un des 350 sites partenaires d'iGraal permet de collecter des euros, sous forme de reversement d'une commission. Ensuite, libre choix d'en faire don d'un simple clic à la Croix-Rouge. Précisons enfin que ce don peut donner lieu à l'émission d'un reçu fiscal.
Source : Croix-Rouge, 13 juin 2007
En mode reconversion totale PDT_028
Reçue en Juillet 2007 PDT_002 Après 1 an d'attente ma demande de financement a enfin été acceptée PDT_020 ESI Promo 2008-2011 PDT_039
Reçue en Juillet 2007 PDT_002 Après 1 an d'attente ma demande de financement a enfin été acceptée PDT_020 ESI Promo 2008-2011 PDT_039
aide pour la culture g
bonjour, je compte repasse mes concours mais je suis nul pour rediger les textes de cultures g je n'arrive pas a faire ressortir mes idees pouvez vous me donnez des conseils je vous remercie d'avance
Vero
- LittleFoetus
- Insatiable

- Messages : 471
- Inscription : 19 mars 2007 00:19
- Localisation : NIMES
MARTINE PEREZ. Publié le 10 juillet 2007 - Le Figaro.fr
En recherchant des signes cliniques, biologiques et radiologiques, le diagnostic pourrait être plus précoce.
ACTUELLEMENT, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer n'est porté avec certitude que lorsque les symptômes cliniques de la maladie sont clairement identifiés et incontestables. En général, les troubles au moment du diagnostic évoluent déjà depuis plusieurs années quand le mot d'Alzheimer est prononcé. Selon une équipe internationale de chercheurs, notamment français, qui ont publié les résultats de leurs travaux dans la revue britannique The Lancet Neurology, la maladie d'Alzheimer pourrait être diagnostiquée plus précocement, avant l'apparition de la démence, en croisant plusieurs critères, dont des tests de mémoire et des marqueurs biologiques.
800 000 cas en France
L'équipe d'experts, coordonnée par Bruno Dubois (hôpital Pitié-Salpétrière, Paris), propose de redéfinir les critères de diagnostic établis en 1984. « Les nouveaux critères proposés permettraient de reconnaître la maladie trois à quatre ans plus tôt qu'actuellement », explique le professeur Dubois. Ainsi, le diagnostic pourrait être porté en cas de troubles de la mémoire observés par le patient ou ses proches depuis plus de six mois, avec de plus la confirmation d'un trouble de la mémoire à long terme par des tests spécifiques. De surcroît, un ou plusieurs des signes suivants doivent être associés : soit une atrophie de l'hippocampe visible à l'IRM, soit des taux anormaux d'un biomarqueur (protéine Tau...) dans le liquide céphalorachidien, ou enfin des troubles de la perfusion cérébrale dans certaines régions du cerveau visible par neuro-imagerie fonctionnelle.
« Dans les années qui viennent, dans les mois peut-être même, on va avoir des médicaments qui devraient ralentir le processus de la maladie », a déclaré le Pr Dubois, soulignant qu'il faut se tenir prêt à l'identifier précocement pour traiter le plus tôt possible les malades. Le diagnostic précoce n'a en effet de sens que si, à l'angoisse de l'annonce d'une telle maladie, le médecin peut offrir une thérapeutique efficace, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement, malgré plusieurs molécules sur le marché. La maladie d'Alzheimer affecte 24 millions de patients dans le monde, dont 800 000 en France.
IDE en cancéro à Marseille!
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"
- LittleFoetus
- Insatiable

- Messages : 471
- Inscription : 19 mars 2007 00:19
- Localisation : NIMES
OLIVIER AUGUSTE. Publié le 06 juillet 2007 - Le Figaro.fr
Coûteux et pas forcément équitable, le régime des affections de longue durée concerne 7,4 millions de patients, qui y sont très attachés.
« CE DISPOSITIF est condamné », prophétise un responsable du monde de la santé, au sujet du système des affections de longue durée (ALD). On n'en est pas encore là. Mais les voix se multiplient pour souligner la nécessité de réfléchir à l'avenir de ce régime qui exonère les personnes atteintes d'une maladie longue et coûteuse, de tout ticket modérateur. Autrement dit, qui rembourse à 100 % les soins de ces patients atteints de diabète, d'hypertension, de cancer, du sida, d'Alzheimer, de Parkinson ou encore d'une maladie psychiatrique chronique ou d'une cirrhose.
En envisageant sérieusement d'appliquer, d'ici à quelques années, un « bouclier sanitaire », François Fillon soulève implicitement le problème. En effet, « l'idée consiste à substituer aux régimes actuels », en particulier celui des ALD, « un plafonnement unique » des dépenses de santé non remboursées par la Sécu, « fonction du revenu », explique Martin Hirsch, ardent promoteur de ce bouclier. « L'ALD sera percutée par le bouclier sanitaire », confirmait Roselyne Bachelot, avant-hier, expliquant pourquoi aucune économie du plan d'urgence ne concernait les maladies longues. « On n'y touche pas pour ne pas préempter le débat », dit le ministre de la Santé. Le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie s'est penché sur les ALD dès 2005. La Haute autorité de santé y travaille. Hier, c'est la Caisse nationale d'assurance-maladie qui est venue alimenter le débat, en dévoilant ses projections à l'horizon 2015. La Cnam estime que, si les tendances actuelles se poursuivent, les dépenses de santé remboursées par la Sécu atteindront alors 210 milliards, soit 50 % de plus que maintenant ! Pour les couvrir, il faudrait des recettes supplémentaires (l'équivalent d'un point de CSG tous les cinq ans), ou réduire de 20 % les remboursements, ou encore transférer les nouvelles dépenses aux complémentaires, dont les cotisations grimperaient alors de 10 % par an. Difficile à envisager...
«Optimiser les dépenses»
Or, au rythme actuel, les ALD représenteront 70 % des remboursements en 2015, contre 60 % actuellement et 50 % en 1992. La dépense par malade de longue durée progresse certes au même rythme que les autres. Mais elle est nettement plus élevée (7 450 euros annuels par personne en ALD contre 1 050 pour les autres assurés, d'après le Haut conseil). Et les effectifs en ALD s'étendent, à cause du vieillissement de la population, de la progression de maladies comme le diabète ou tout simplement de leur meilleure détection (c'est le cas du cancer de la prostate). Pour le seul régime général, de 7,4 millions de personnes concernées en 2005, on passerait à 11 millions dix ans plus tard !
Le régime des ALD, extrêmement coûteux, n'est pas toujours équitable. Les critères d'admission dans la liste des 30 maladies concernées ne sont pas appliqués avec la même rigueur par tous les médecins. Et certains assurés frappés par une maladie « hors liste » peuvent sortir de leur poche des sommes importantes. De même certains patients en ALD ont des « reste à charge » élevés pour des soins sans lien avec leur longue maladie et donc non remboursés à 100 %.
La Cnam tire ses propres conclusions de ces observations. Pour son directeur, « la priorité n'est pas de changer le périmètre de prise en charge, avec par exemple des franchises, ou de trouver de nouvelles recettes, comme une TVA sociale. Il faut plutôt optimiser les dépenses de santé ». Frédéric van Roekeghem cite trois axes : mieux prévenir ces pathologies grâce notamment aux campagnes de dépistage, mieux suivre les malades chroniques (l'Inspection des affaires sociales est allée étudier à l'étranger le disease management), et accroître l'efficience du système de soins, par exemple en cessant d'accueillir aux urgences hospitalières des cas qui relèvent plutôt du généraliste de garde.
IDE en cancéro à Marseille!
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"
- popsette68
- Fidèle

- Messages : 187
- Inscription : 27 mars 2007 16:30
- Localisation : colmar
En fait tout d'abord fait un plan pour rédiger ce sera plus facile *
1- Définition du sujet ou du mot cléf
2- Les inconvénients ou les problèmes ou conséquences
3- Les avantages ou les solutions
4- Conclusion
Voila moi je procede comme ca, tu peux aussi avant de commencer mettre toutes tes idées en vrac et reconstitué tout ensuite avec le plan, voila je sais pas si je t'ai aidé ! bon courage
A +
1- Définition du sujet ou du mot cléf
2- Les inconvénients ou les problèmes ou conséquences
3- Les avantages ou les solutions
4- Conclusion
Voila moi je procede comme ca, tu peux aussi avant de commencer mettre toutes tes idées en vrac et reconstitué tout ensuite avec le plan, voila je sais pas si je t'ai aidé ! bon courage
A +
Esi à Colmar
Promo 2007/2010
" Faites que vos rêves dévorent votre vie afin que la vie ne dévore pas vos rêves ... "
Promo 2007/2010
" Faites que vos rêves dévorent votre vie afin que la vie ne dévore pas vos rêves ... "
- LittleFoetus
- Insatiable

- Messages : 471
- Inscription : 19 mars 2007 00:19
- Localisation : NIMES
LCI - le 10/07/2007 - 11h13
- Les pompiers sont aux prises avec deux importants feux de forêts dans le Var et en Haute-Corse.
- La progression des flammes semble stoppée mais la situation reste à haut risque, notamment en Corse où le vent peut entraîner des reprises de feu.
Globalement épargné par la météo peu clémente de ce juillet automnal, le Sud-Est n'a pas totalement évité l'un des corollaires de l'été : les incendies de forêts et de garrigues. Les pompiers sont mobilisés depuis lundi soir sur deux fronts, dans le Var et en Corse.
Dans le nord-ouest du Var, un incendie de forêt s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi sur la commune de Signes dans et a détruit 120 hectares avant que sa progression soit pratiquement stoppée. "Le feu a pris près d'une citerne d'eau pour les incendies en plein massif", a précisé le lieutenant-colonel Pierre Schaeller, commandant des opérations. Aucun blessé n'est à déplorer.
400 sapeurs pompiers du Var mais aussi des renforts des Bouches-du-Rhône et une colonne de la sécurité civile de Brignoles ont été mobilisés pour combattre les flammes dans un massif forestier où le vent d'ouest soufflait à 90 km/h. "Nous avons mis en protection la zone industrielle de Signes ainsi que le lotissement Bois-Soleil où se situe une centaine de villas", a ajouté le lieutenant-colonel Schaeller au PC de crise. Néanmoins, aucune évacuation n'a eu lieu et la zone industrielle ne semble pas menacée à l'heure qu'il est. Le front des flammes semblait avoir été contenu très tôt mardi matin, vers 4 heures, avant une reprise légère de sa progression ; mardi à la mi-journée, malgré l'intervention de bombardiers d'eau, le foyer n'était donc pas totalement fixé, malgré les assurances de la préfecture.
Le vent complique le travail des pompiers
En Haute-Corse, 75 hectares de forêt ont été détruits dans un incendie qui s'est déclaré lundi en fin d'après-midi dans un secteur inhabité près de Vivario. Les pompiers ont dû intervenir sur plusieurs mises à feu simultanées. Malgré l'intervention de très importants moyens aériens et terrestres, ils n'ont pu éviter la propagation des flammes sur un versant planté de pins le long du fleuve du Vecchio, et la progression du feu n'a pu être à peu près contenue que tôt mardi matin. Cinq Canadair, deux avions Tracker, deux avions Dash 8 et 3 hélicoptères bombardiers d'eau ont été détachés dès lundi après-midi sur la zone.
En renfort des 150 pompiers présents, les moyens aériens ont permis de "constituer une ligne humide avant la nuit en procédant à de multiples largages d'eau et de retardant dans la forêt, avant de suspendre les vols" jusqu'à ce mardi matin, a précisé un officier des pompiers de la Haute-Corse. Près de 200 hommes sont restés mobilisés pendant la nuit pour ralentir la progression du feu, avant que les moyens aériens soient de nouveau opérationnels à l'aube. Dès lors, les vols de bombardiers d'eau ont pu reprendre et ont aidé à stabiliser le front des flammes. Le feu qui s'est scindé en deux durant la nuit menace néanmoins de repartir en direction de la forêt domaniale de Vizzavona, où il a grignoté 5 hectares sur les traces d'un précédent gros incendie qui avait parcouru près de 500 hectares en 2002.
Constituée en majorité de résineux, des pins Lariccio multi-centenaires, cette forêt à flanc de montagne est particulièrement difficile d'accès et la situation reste à haut risque : le vent pourrait attiser les flammes. "Nous attendons des vents de 40 à 60 km/h, avec des pointes à 100 km/h jusqu'à mercredi matin. Nous redoutons particulièrement que le feu bascule sur un autre versant, vers les abords du village de Canaglia", a indiqué un officier du Codis de la Haute-Corse.
IDE en cancéro à Marseille!
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"
Re: aide pour la culture g
vero264 a écrit :bonjour, je compte repasse mes concours mais je suis nul pour rediger les textes de cultures g je n'arrive pas a faire ressortir mes idees pouvez vous me donnez des conseils je vous remercie d'avance
Bonjour,
une petite recherche, donne ceci
Entre autre...
La pensée vole, et les mots vont à pieds.
-
ministuffy
- Insatiable

- Messages : 607
- Inscription : 07 juin 2007 08:48
LE MONDE | 10.07.07 | 14h26 • Mis à jour le 10.07.07 | 14h26
C'est la "bible" du cannabis. Diffusé à compter de mardi 10 juillet, l'ouvrage Cannabis, données essentielles constitue la première monographie réalisée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) sur la substance illicite la plus répandue en France. Tous les résultats des études, enquêtes et données épidémiologiques, scientifiques ou sociologiques les plus récentes, et parfois inédites, sont ici synthétisés pour livrer un tableau au plus proche de la réalité du cannabis sur le territoire. On le sait, le "joint" s'est largement banalisé. Il compte près de quatre millions de consommateurs, dont 1,2 million d'usagers réguliers et 550 000 usagers quotidiens.
Ces chiffres placent la France parmi les pays les plus consommateurs en Europe, aux côtés de la République tchèque, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Chez les jeunes, toutes catégories sociales confondues, l'expérimentation du cannabis est devenue un "modèle dominant", souligne Jean-Michel Costes, directeur de l'OFDT. Depuis 2000, son usage régulier atteint presque le même niveau que celui de l'alcool. En 2005, 49,5 % des jeunes âgés de 17 ans ont déclaré avoir déjà pris du cannabis au cours de leur vie, 27,9 % au cours des trente derniers jours, 10,8 % de façon régulière et 5,2 % quotidiennement.
En hausse très nette depuis le début des années 1990, l'expérimentation est également devenue plus précoce. C'est en moyenne vers 15 ans qu'on fume son premier joint. Ensuite, l'usage du cannabis est davantage lié à "l'intensité de la sociabilité et des contacts amicaux" qu'au milieu social ou au parcours scolaire. Ainsi, l'usager de cannabis est d'abord un "fêtard". Plus le nombre de sorties - au café, dans les pubs ou chez des amis - est fréquent, plus la consommation augmente.
Si l'expérimentation du cannabis n'a cessé de se répandre, le mouvement semble néanmoins se stabiliser depuis 2002. En revanche, la part de consommateurs réguliers (au moins dix fois par mois) parmi les 15-34 ans est passée de 3,8 % en 2000 à 5,9 % en 2005 et apparaît en lien direct avec la situation scolaire ou professionnelle. Schématiquement, l'usage "festif" se retrouve davantage parmi les jeunes issus de milieux favorisés ayant un bon niveau scolaire. En revanche, on rencontre plus souvent l'usager régulier chez les jeunes en difficulté ou en échec scolaire et les chômeurs. "Un meilleur niveau d'instruction autorise l'expérimentation et ne freine pas l'usager mais "protégerait" du basculement vers une consommation régulière et un usage problématique", notent les spécialistes.
Ce tableau cache quelques surprises. Ainsi, les cadres s'avèrent plus souvent des consommateurs réguliers que les ouvriers. Quant aux étudiants de l'enseignement supérieur, ils ne sont pas plus "accros" que les actifs de leur âge. "Le cannabis est une réalité complexe. Des jeunes parviennent à gérer leur consommation et à en sortir, tandis que chez d'autres ce produit ne fait que renforcer leurs difficultés", explique M. Costes.
Pour s'approvisionner, les usagers ont recours au don (58,7 %), à l'achat auprès de proches ou de dealers (36,8 %) et à l'autoculture (5 %), en plein développement, y compris dans les zones urbaines. Environ 200 000 personnes sont passées à l'autoproduction, ce chiffre étant considéré comme une "fourchette basse". Toujours plus répandu, le cannabis est aussi de moins en moins cher. Le prix moyen d'un gramme de résine a baissé de 30 % en dix ans, pour atteindre actuellement environ 4 euros.
Quant au gramme d'herbe, il coûte 5 euros et des pousssières de centimes, contre 10 euros en 1996. Selon une étude qualitative réalisée auprès d'usagers réguliers, le budget mensuel consacré à l'achat du cannabis en 2006 se situe entre 80 et 150 euros, sans compter l'achat du tabac.
Au total, le chiffre d'affaires annuel que représente la vente de cannabis en France est estimé, sur la base de données déclaratives, à 832 millions d'euros (dont la part la plus importante est attribuable aux 15-24 ans). On considère que le chiffre d'affaires du tabac atteint 13,7 milliards d'euros TTC (14,2 milliards pour l'alcool). En prenant en compte l'ensemble des dépenses supportées par la collectivité (traitements, répression, prévention, etc.), le coût social du cannabis peut être estimé à 919 millions d'euros (dont seulement 36,5 millions au titre de la prévention, contre 523, 5 millions pour la répression), soit 0,06 % du PIB, ou encore un peu plus de 15 euros par habitant. Comparativement, le coût social de l'alcool et celui du tabac s'élevaient respectivement, en 2003, à 2,37 % et 3,05 % du PIB, soit 599 et 772 euros par habitant.
Cancers, maladies respiratoires, troubles psychiatriques : les méfaits du cannabis sur la santé peuvent être multiples "sans que les études explicitent toujours à quels niveaux de consommation ces risques sont susceptibles d'apparaître", souligne l'OFDT. Les risques de mort violente sont essentiellement liés aux accidents de la circulation. Le nombre annuel de victimes directement lié à une conduite sous l'emprise du cannabis serait d'environ 230, sur la base d'un total de 6 000 morts sur les routes.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0 ... 960,0.html
C'est la "bible" du cannabis. Diffusé à compter de mardi 10 juillet, l'ouvrage Cannabis, données essentielles constitue la première monographie réalisée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) sur la substance illicite la plus répandue en France. Tous les résultats des études, enquêtes et données épidémiologiques, scientifiques ou sociologiques les plus récentes, et parfois inédites, sont ici synthétisés pour livrer un tableau au plus proche de la réalité du cannabis sur le territoire. On le sait, le "joint" s'est largement banalisé. Il compte près de quatre millions de consommateurs, dont 1,2 million d'usagers réguliers et 550 000 usagers quotidiens.
Ces chiffres placent la France parmi les pays les plus consommateurs en Europe, aux côtés de la République tchèque, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Chez les jeunes, toutes catégories sociales confondues, l'expérimentation du cannabis est devenue un "modèle dominant", souligne Jean-Michel Costes, directeur de l'OFDT. Depuis 2000, son usage régulier atteint presque le même niveau que celui de l'alcool. En 2005, 49,5 % des jeunes âgés de 17 ans ont déclaré avoir déjà pris du cannabis au cours de leur vie, 27,9 % au cours des trente derniers jours, 10,8 % de façon régulière et 5,2 % quotidiennement.
En hausse très nette depuis le début des années 1990, l'expérimentation est également devenue plus précoce. C'est en moyenne vers 15 ans qu'on fume son premier joint. Ensuite, l'usage du cannabis est davantage lié à "l'intensité de la sociabilité et des contacts amicaux" qu'au milieu social ou au parcours scolaire. Ainsi, l'usager de cannabis est d'abord un "fêtard". Plus le nombre de sorties - au café, dans les pubs ou chez des amis - est fréquent, plus la consommation augmente.
Si l'expérimentation du cannabis n'a cessé de se répandre, le mouvement semble néanmoins se stabiliser depuis 2002. En revanche, la part de consommateurs réguliers (au moins dix fois par mois) parmi les 15-34 ans est passée de 3,8 % en 2000 à 5,9 % en 2005 et apparaît en lien direct avec la situation scolaire ou professionnelle. Schématiquement, l'usage "festif" se retrouve davantage parmi les jeunes issus de milieux favorisés ayant un bon niveau scolaire. En revanche, on rencontre plus souvent l'usager régulier chez les jeunes en difficulté ou en échec scolaire et les chômeurs. "Un meilleur niveau d'instruction autorise l'expérimentation et ne freine pas l'usager mais "protégerait" du basculement vers une consommation régulière et un usage problématique", notent les spécialistes.
Ce tableau cache quelques surprises. Ainsi, les cadres s'avèrent plus souvent des consommateurs réguliers que les ouvriers. Quant aux étudiants de l'enseignement supérieur, ils ne sont pas plus "accros" que les actifs de leur âge. "Le cannabis est une réalité complexe. Des jeunes parviennent à gérer leur consommation et à en sortir, tandis que chez d'autres ce produit ne fait que renforcer leurs difficultés", explique M. Costes.
Pour s'approvisionner, les usagers ont recours au don (58,7 %), à l'achat auprès de proches ou de dealers (36,8 %) et à l'autoculture (5 %), en plein développement, y compris dans les zones urbaines. Environ 200 000 personnes sont passées à l'autoproduction, ce chiffre étant considéré comme une "fourchette basse". Toujours plus répandu, le cannabis est aussi de moins en moins cher. Le prix moyen d'un gramme de résine a baissé de 30 % en dix ans, pour atteindre actuellement environ 4 euros.
Quant au gramme d'herbe, il coûte 5 euros et des pousssières de centimes, contre 10 euros en 1996. Selon une étude qualitative réalisée auprès d'usagers réguliers, le budget mensuel consacré à l'achat du cannabis en 2006 se situe entre 80 et 150 euros, sans compter l'achat du tabac.
Au total, le chiffre d'affaires annuel que représente la vente de cannabis en France est estimé, sur la base de données déclaratives, à 832 millions d'euros (dont la part la plus importante est attribuable aux 15-24 ans). On considère que le chiffre d'affaires du tabac atteint 13,7 milliards d'euros TTC (14,2 milliards pour l'alcool). En prenant en compte l'ensemble des dépenses supportées par la collectivité (traitements, répression, prévention, etc.), le coût social du cannabis peut être estimé à 919 millions d'euros (dont seulement 36,5 millions au titre de la prévention, contre 523, 5 millions pour la répression), soit 0,06 % du PIB, ou encore un peu plus de 15 euros par habitant. Comparativement, le coût social de l'alcool et celui du tabac s'élevaient respectivement, en 2003, à 2,37 % et 3,05 % du PIB, soit 599 et 772 euros par habitant.
Cancers, maladies respiratoires, troubles psychiatriques : les méfaits du cannabis sur la santé peuvent être multiples "sans que les études explicitent toujours à quels niveaux de consommation ces risques sont susceptibles d'apparaître", souligne l'OFDT. Les risques de mort violente sont essentiellement liés aux accidents de la circulation. Le nombre annuel de victimes directement lié à une conduite sous l'emprise du cannabis serait d'environ 230, sur la base d'un total de 6 000 morts sur les routes.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0 ... 960,0.html
Infirmière aux urgences 
- LittleFoetus
- Insatiable

- Messages : 471
- Inscription : 19 mars 2007 00:19
- Localisation : NIMES
LEMONDE.FR avec AFP | 09.07.07 | 21h46 • Mis à jour le 09.07.07 | 21h57
Le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) a préconisé, lundi 9 juillet, d'abaisser le taux d'alcool toléré au volant, actuellement fixé à 0,5 gramme par litre de sang, à 0,2 g/l en 2010. Son président, Robert Namias, a rappelé "que cette recommandation était celle de la commission européenne".
Lundi, le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau, a réaffirmé qu'il n'en était pas question. "Restons au 0,5 [g/l] et faisons-le respecter, c'est déjà pas mal", a-t-il dit, interrogé à ce sujet à la sortie du conseil des ministres.
Le CNSR, organisme créé par décret et ayant un rôle de proposition auprès du ministre en charge de la sécurité routière, a"pris connaissance du rapport établi par son comité d'experts" concernant "l'alcool sur la route" et qui dresse un "état des lieux et de propositions". L'étude établit que"la part, dans les accidents mortels, des conducteurs avec une alcoolémie supérieure au taux légal demeure à un niveau alarmant".
Le CNSR préconise "tout particulièrement" une "communication massive sur l'alcoolisation excessive" s'appuyant sur les médias. Le conseil propose également que "l'auto-contrôle de son taux d'alcoolémie au volant" ou le développement de" l'éthylotest antidémarrage comme alternative à la sanction". Enfin, il recommande une "politique pénale axée sur la confiscation systématique du véhicule en cas de récidive d'alcoolémie" et un "renforcement substantiel" de "l'efficacité des contrôles".
Vincent Julé, vice-président de l'association Victimes et citoyens, membre du CNSR, a indiqué que "le point positif, c'est l'adoption d'une recommandation visant à accentuer les contrôles d'alcoolémie et à mieux les cibler". "Le taux de 0,5 g/l parfaitement appliqué aurait les mêmes vertus" que celui de 0,2 g/l, a d'ailleurs estimé M. Julé.
IDE en cancéro à Marseille!
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"
- LittleFoetus
- Insatiable

- Messages : 471
- Inscription : 19 mars 2007 00:19
- Localisation : NIMES
Boursorama - AFP le 12/07/2007 11h25
L'assurance maladie (Cnam) ne prévoit pas de retour à l'équilibre avant 2010 et table en 2008 sur un déficit de 3,9 milliards d'euros, selon les éléments qu'elle va transmettre au gouvernement pour l'élaboration du prochain budget de la Sécurité sociale.
"Nous repartons sur le chemin prévu, avec un an de décalage", explique Frédéric van Roekeghem, le directeur de la Cnam, dans un entretien au Figaro économique de jeudi, en référence à la promesse non tenue d'un retour à l'équilibre en 2008 par Xavier Bertrand, quand il était ministre de la Santé.
Selon les prévisions de la Cnam, transmises à l'AFP, le déficit de 3,9 milliards attendu en 2008 est le même que celui qui était prévu en 2007, mais qui s'est finalement soldé par un "trou" qui devrait atteindre 6,4 milliards.
Le Conseil de la Cnam doit entériner jeudi ces prévisions, qui sont accompagnées de 16 "axes structurels" et doivent permettre de dégager 300 millions d'économies en 2008, comme "mieux prévenir les maladies chroniques" ou "accroître la productivité à l'hôpital", indique M. van Roekeghem.
Par ailleurs, "nous demandons que le panier de recettes destiné à financer les exonérations soit complété", déclare le directeur de la Cnam, en référence aux dettes de l'Etat, qui tarde souvent à rembourser à la Sécurité sociale les allégements de cotisations sociales qu'il accorde aux entreprises.
"Et nous sommes prêts, techniquement, à appliquer dès le début de l'année les franchises prévues par le gouvernement, si leur plafonnement n'est pas lié au revenu des assurés", ajoute-t-il.
Parmi les 16 propositions de l'assurance maladie figurent notamment une meilleure "maîtrise de la consommation de médicaments", de la répartition des médecins, ou encore l'assurance de trouver un médecin pratiquant les tarifs de la "sécu" (sans dépassements).
Elle propose aussi d'expérimenter des "contrats individuels" avec des médecins qui respecteraient certains objectifs de prescription et recevraient en échange "une rémunération à la performance".
"Ces contrats devraient pouvoir permettre de développer une rémunération forfaitaire pour la médecine de ville, en fonction des résultats de santé publique", écrit la Cnam, ouvrant ainsi la porte à une remise en cause du paiement à l'acte, dont le caractère inflationniste est souvent décrié.
IDE en cancéro à Marseille!
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"
- LittleFoetus
- Insatiable

- Messages : 471
- Inscription : 19 mars 2007 00:19
- Localisation : NIMES
Le Figaro.fr - MARTINE PEREZ. Publié le 12 juillet 2007
Ce vaccin destiné aux jeunes filles n'empêche pas la poursuite du dépistage par frottis. Par ailleurs, un plan de gestion des risques a été mis en place.
LE VACCIN contre le cancer du col de l'utérus, le Gardasil de Sanofi Pasteur MSD, ne prendra vraiment son envol que la semaine prochaine, date à laquelle il sera remboursé à 65 %. Bien que disponible sur le marché français depuis le mois de novembre dernier, ce produit totalement innovant a été relativement peu prescrit du fait de son coût (165 euros la dose, trois rappels nécessaires), les médecins attendant qu'il soit pris en charge par l'assurance-maladie avant de le proposer. Mais déjà dans le monde, plus de trois millions de jeunes filles, notamment aux États-Unis, Canada et Allemagne, en ont bénéficié.
Très rapidement donc, de nombreuses jeunes françaises pourraient se voir proposer ce vaccin d'un genre totalement nouveau puisqu'il vise à les protéger contre un virus, le papillomavirus, responsable des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus, ainsi que des condylomes (verrues) génitales. La décision de rembourser ce produit fait suite à l'avis favorable du Comité technique des vaccinations rendu public le 9 mars dernier.
Faut-il donc désormais vacciner nos filles et à quel âge ? « Il est clairement utile de les vacciner à l'âge de 14 ans. Pour les plus âgées, le vaccin peut être proposé encore entre 15 et 23 ans à condition qu'elles n'aient pas eu de partenaires sexuels (en tout cas, pas plus d'un au cours de leur vie), explique le docteur Michel Rosenheim, membre du Comité technique des vaccinations. Cette vaccination doit s'accompagner de conseils précis sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, notamment sur l'utilisation du préservatif. Ainsi que d'une information concernant le dépistage du cancer du col de l'utérus qui doit être maintenu impérativement malgré la vaccination. » On sait en effet que le vaccin n'apporte pas une protection totale contre ce cancer.
250 000 décès dans le monde
Le cancer du col de l'utérus est responsable actuellement d'environ 1 000 décès par an dans notre pays. Ce chiffre - encore trop élevé - a considérablement diminué grâce au dépistage systématique par frottis recommandé à toutes les femmes de 25 à 65 ans depuis plus de trente ans. Alors que dans le monde, plus de 250 000 décès sont à déplorer, principalement dans les pays en voie de développement où aucun dépistage n'est organisé. Dans les années 1970, on s'est rendu compte que ce cancer, que l'on croyait lié à un dysfonctionnement cellulaire, était dû en fait à un virus, le papillomavirus.
Depuis, les connaissances se sont accumulées sur ce virus et ses différents sous-types plus ou moins pathogènes et ont conduit progressivement, et avec un succès certain, à l'élaboration de deux vaccins. Le Gardasil, vaccin de Merck, protégerait contre quatre souches de papillomavirus, la 16 et la 18, responsables de plus de 70 % des cancers du col de l'utérus et la 6 et la 11, responsables, elles, des verrues génitales. Le Cervarix de la firme GSK non encore commercialisé lui ne protégerait que contre les souches 16 et 18. Dans l'un et l'autre cas, ils n'empêcheraient que 75 % des cancers du col. Les 25 % restants seraient dus à des souches plus rares non prises en compte par ces vaccins.
Si environ 3 300 cancers du col de l'utérus sont identifiés chaque année en France, le nombre de femmes nécessitant un recours à un traitement chirurgical ou par laser du fait de lésions du col ou du vagin de moindre gravité liées aux papillomavirus est nettement plus élevé. Le vaccin devrait contribuer à réduire la morbidité liée cette infection transmissible sexuellement.
Dans son avis, le Comité technique des vaccinations demande enfin que soient menées des études pour évaluer la durée de protection conférée par le vaccin totalement inconnue pour l'instant, et que soit surveillée l'éventuelle émergence de nouvelles souches de papillomavirus résistantes au vaccin.
IDE en cancéro à Marseille!
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"
_________________
IDE depuis le 26/11/10 ~Projet pro : IADE~ -_-"