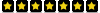Culture Générale
Modérateurs : Modérateurs, Concours IFSI
- ptitjustine
- Adepte

- Messages : 116
- Inscription : 07 déc. 2007 17:20
en principe c'est conseillé, il e faut pas que plusieurs idée qui se rejoingne soient dans le desordre et mélangé avec d'autre différente.
le correcteur va aussi noté ta faculté de synthèse et de construction de ta réponse, je pense
le correcteur va aussi noté ta faculté de synthèse et de construction de ta réponse, je pense
MéL@NiE
ESI 2008/2011 a l'IFSI Le Creusot/Montceau.....!!!!! YES!!!
ESI 2008/2011 a l'IFSI Le Creusot/Montceau.....!!!!! YES!!!
-
cramouille
- Messages : 14
- Inscription : 17 févr. 2008 20:07
- Localisation : Saint-Yrieix-La-Perche
c pareil!!
Coucou LILI,
Moi, je suis pareil que toi.J'ai beaucoup de mal à synthétiser.Lorsque je suis devant 1 sujet, j'ai du mal à trouver des ouvertures pour des arguments. Les idées ne viennent pas tout de suite.
D'ailleurs si qqn pouvait m'aider sur ce problème se serait vraiment sympa!!!!!!!
A bientot
Moi, je suis pareil que toi.J'ai beaucoup de mal à synthétiser.Lorsque je suis devant 1 sujet, j'ai du mal à trouver des ouvertures pour des arguments. Les idées ne viennent pas tout de suite.
D'ailleurs si qqn pouvait m'aider sur ce problème se serait vraiment sympa!!!!!!!
A bientot
Merci pour vos réponses et courage, on va y arriver
- lili
- Insatiable

- Messages : 387
- Inscription : 02 sept. 2007 22:14
- Localisation : Somwhere over the rainbow...
Dur dur la synthèse effectivement...Moi je m'emporte sur des phrases de trois lignes avec des élans lyriques 
 Mais j'ai retenu:
Mais j'ai retenu:
des phrases simples et courtes ( pas de subordination etc)
Une idée par phrase, en gros, aller direct à l'essentiel et ce de manière efficace...
Le seul truc en fait, c'est d'accepter de renoncer à une prose incompatible à l'épreuve snif!Mais me connaissant, je crois que quand même je me laisserais aller à quelques broderies gnark gnark
des phrases simples et courtes ( pas de subordination etc)
Une idée par phrase, en gros, aller direct à l'essentiel et ce de manière efficace...
Le seul truc en fait, c'est d'accepter de renoncer à une prose incompatible à l'épreuve snif!Mais me connaissant, je crois que quand même je me laisserais aller à quelques broderies gnark gnark
[ ESI 2009/2012 ]
Le 23 Février, c'est la rentrée!
Le 23 Février, c'est la rentrée!
- aneso81
- Insatiable

- Messages : 624
- Inscription : 10 juil. 2007 14:10
- Localisation : Dans les nuages!!!xD
Voir à nouveau grâce à une dent, c'est possible
AFP - il y a 1 heure 34 minutes
PARIS (AFP) - Recouvrir la vue grâce à une dent, la sienne ou celle de son fils, comme l'a expérimenté un Irlandais, devenu aveugle après une explosion, ne relève ni du miracle ni d'un docteur Frankenstein, mais d'une opération chirurgicale imaginée il y a des décennies par un ingénieux spécialiste italien.
"500 à 600 interventions de ce type ont été pratiquées au total dans le monde", indique le Dr Bernard Duchesne (université de Liège, Belgique) dans un entretien avec l'AFP.
La technique, dite d'"ostéo-odonto-kératoprothèse, a été "inventée par (Benedetto) Strampelli en 1956", ajoute ainsi l'un des "huit" spécialistes au monde de cette opération, avec notamment le Français Emmanuel Lacombe.
"Il s'agit d'une alternative à la greffe de cornée, quand cette dernière n'est pas possible, mais aucunement bien sûr d'un remplacement de l'oeil entier par une dent", dit-il.
La technique, surtout utilisée dans les années 60, a été entre-temps modifiée par la famille Falcinelli, Giancarlo et Giovanni, qui ont publié en 2005 la première évaluation scientifique de la méthode sur 223 patients.
"On se sert beaucoup plus fréquemment d'une dent du patient, généralement une canine, précise-t-il, que de celle d'un donneur apparenté compatible avec le receveur", comme dans le cas de l'Irlandais Bob McNichol, 57 ans.
M. McNichol avait perdu la vue en 2005 lors d'une explosion dans une entreprise de recyclage d'aluminium.
Schématiquement, "tout matériau synthétique directement implanté dans l'oeil se voit expulser par la couche de surface, c'est-à-dire l'épithélium, et c'est encore plus vrai au niveau de la cornée", explique M. Duchesne.
"Or l'inventeur a observé que dans l'organisme, deux matériaux rigides pouvaient être en contact sans problème avec de l'épithélium, les ongles et les dents", poursuit-il.
"Il a observé par ailleurs que la muqueuse buccale tolère la dent, si le ligament alvéolo-dentaire est en bon état. Sinon (problème d'hygiène, maladies familiales...), la muqueuse cherche à l'expulser, provoquant le déchaussement de la dent". Une observation dont Benedetto Strampelli, "assez génial", a su tirer parti.
Concrètement, on prélève le bloc ostéo-dentaire où se trouve la racine de la dent avec ce fameux ligament, puis l'émail est enlevé. On meule ce bloc pour obtenir un parallélépipède rectangle de 7 à 8 mm de large, de 14 à 16 mm de long et 2,5 à 3 mm d'épaisseur.
On le perce pour y introduire une simple optique en plastique transparent, et ainsi le boucher. L'ensemble est alors placé sous la peau du patient pendant 3 mois minimum, pour qu'il soit colonisé par des cellules et entouré de tissus fibreux afin de permettre de faire les points de suture.
"Parallèlement, on prépare l'oeil en lui enlevant la fine couche qui le recouvre (opération dite kératotomie) et la remplaçant par de la muqueuse buccale afin que la dent retrouve le milieu auquel elle est habituée", poursuit l'ophtalmologue.
L'aspect n'est "pas très joli (pupille sans iris, couleur rosâtre)", mais esthétiquement une grande lentille de contact avec un iris dessiné dessus peut être "acceptable".
Des lunettes permettent d'adapter ensuite la vue, poursuit le spécialiste. "La récupération visuelle est suffisante pour conduire une voiture", ajoute-t-il, évoquant un chauffeur de taxi à Rome, opéré de cette manière.
"Cette technique, très lourde (en durée et personnels), n'a jamais été très en vogue", admet-il, mais elle reste "utile".
Pour sa part, le patient irlandais opéré à Brighton se réjouit de voir "suffisamment" pour se déplacer et regarder la télévision.
AFP - il y a 1 heure 34 minutes
PARIS (AFP) - Recouvrir la vue grâce à une dent, la sienne ou celle de son fils, comme l'a expérimenté un Irlandais, devenu aveugle après une explosion, ne relève ni du miracle ni d'un docteur Frankenstein, mais d'une opération chirurgicale imaginée il y a des décennies par un ingénieux spécialiste italien.
"500 à 600 interventions de ce type ont été pratiquées au total dans le monde", indique le Dr Bernard Duchesne (université de Liège, Belgique) dans un entretien avec l'AFP.
La technique, dite d'"ostéo-odonto-kératoprothèse, a été "inventée par (Benedetto) Strampelli en 1956", ajoute ainsi l'un des "huit" spécialistes au monde de cette opération, avec notamment le Français Emmanuel Lacombe.
"Il s'agit d'une alternative à la greffe de cornée, quand cette dernière n'est pas possible, mais aucunement bien sûr d'un remplacement de l'oeil entier par une dent", dit-il.
La technique, surtout utilisée dans les années 60, a été entre-temps modifiée par la famille Falcinelli, Giancarlo et Giovanni, qui ont publié en 2005 la première évaluation scientifique de la méthode sur 223 patients.
"On se sert beaucoup plus fréquemment d'une dent du patient, généralement une canine, précise-t-il, que de celle d'un donneur apparenté compatible avec le receveur", comme dans le cas de l'Irlandais Bob McNichol, 57 ans.
M. McNichol avait perdu la vue en 2005 lors d'une explosion dans une entreprise de recyclage d'aluminium.
Schématiquement, "tout matériau synthétique directement implanté dans l'oeil se voit expulser par la couche de surface, c'est-à-dire l'épithélium, et c'est encore plus vrai au niveau de la cornée", explique M. Duchesne.
"Or l'inventeur a observé que dans l'organisme, deux matériaux rigides pouvaient être en contact sans problème avec de l'épithélium, les ongles et les dents", poursuit-il.
"Il a observé par ailleurs que la muqueuse buccale tolère la dent, si le ligament alvéolo-dentaire est en bon état. Sinon (problème d'hygiène, maladies familiales...), la muqueuse cherche à l'expulser, provoquant le déchaussement de la dent". Une observation dont Benedetto Strampelli, "assez génial", a su tirer parti.
Concrètement, on prélève le bloc ostéo-dentaire où se trouve la racine de la dent avec ce fameux ligament, puis l'émail est enlevé. On meule ce bloc pour obtenir un parallélépipède rectangle de 7 à 8 mm de large, de 14 à 16 mm de long et 2,5 à 3 mm d'épaisseur.
On le perce pour y introduire une simple optique en plastique transparent, et ainsi le boucher. L'ensemble est alors placé sous la peau du patient pendant 3 mois minimum, pour qu'il soit colonisé par des cellules et entouré de tissus fibreux afin de permettre de faire les points de suture.
"Parallèlement, on prépare l'oeil en lui enlevant la fine couche qui le recouvre (opération dite kératotomie) et la remplaçant par de la muqueuse buccale afin que la dent retrouve le milieu auquel elle est habituée", poursuit l'ophtalmologue.
L'aspect n'est "pas très joli (pupille sans iris, couleur rosâtre)", mais esthétiquement une grande lentille de contact avec un iris dessiné dessus peut être "acceptable".
Des lunettes permettent d'adapter ensuite la vue, poursuit le spécialiste. "La récupération visuelle est suffisante pour conduire une voiture", ajoute-t-il, évoquant un chauffeur de taxi à Rome, opéré de cette manière.
"Cette technique, très lourde (en durée et personnels), n'a jamais été très en vogue", admet-il, mais elle reste "utile".
Pour sa part, le patient irlandais opéré à Brighton se réjouit de voir "suffisamment" pour se déplacer et regarder la télévision.
Puéricultrice
Vis un rêve éveillée
Vis un rêve éveillée
Une protéine éclaire la réaction du cancer
Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs au Vanderbilt-Ingram Cancer Center, une technique qui “étiquète” spécifiquement les tumeurs réagissant à la chimiothérapie, représenterait une nouvelle stratégie visant à déterminer l’efficacité d’un traitement du cancer dans les quelques jours suivant le début du traitement.
Dans l’étude apparaissant en ligne avant son impression dans Nature Medicine, les chercheurs signalent l’identification d’une petite protéine qui reconnait spécifiquement les tumeurs réagissant à la chimiothérapie. Ils révèlent que lorsque la protéine est étiquetée d’une molécule émettant de la lumière, elle peut être utilisée pour visualiser la réaction du cancer chez les souris, seulement 2 jours après le début de la thérapie.
Une surveillance améliorée de la réaction tumorale aiderait à personnaliser les traitements des patients et à accélérer le développement de nouveaux médicaments contre le cancer, indiqua l’auteur principal docteur Dennis Hallahan, professeur de recherche sur le cancer à Ingram et chef du département de Radiation Oncology au Vanderbilt University Medical Center.
Actuellement, la réaction à la chimiothérapie est déterminée en mesurant les changements de la taille de la tumeur à l’aide de techniques d’imagerie telles que la scanographie et l’IRM (Imagerie par Résonnance Magnétique).
“Deux à trois mois de thérapie contre le cancer sont nécessaires avant de pouvoir déterminer si la thérapie a été efficace pour un patient,” indiqua-t-il. “Si nous pouvons obtenir cette réponse en 2 ou 3 jours, nous pourrions transférer le patient à une thérapie alternative très rapidement.”
L’évaluation rapide de la réaction tumorale est très importante actuellement, signale Hallahan, vu les percées récentes en terme de thérapies moléculaires ciblées – médicaments chimiothérapiques qui interviennent spécifiquement dans la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses, tout en évitant d’endommager les cellules saines.
“Nous avons aujourd’hui un grand nombre de médicaments moléculaires ciblés dont nous pouvons choisir et leur nombre de cesse de croitre chaque année ; nous en somme donc à une période où le patient peut être transféré d’une thérapie à l’autre,” expliqua-t-il. “Mais nous avons besoin de certains outils afin de prendre la décision d’utiliser une thérapie alternative avec le patient.”
Afin de trouver une méthode rapide et non invasive destinée à évaluer la réaction du cancer aux thérapies, Hallahan ne dirigea pas son attention sur la taille de la tumeur, mais sur les changements cellulaires et moléculaires des cancers réagissant.
Parmi des milliards de fragments de protéines, ou peptides, Hallahan et ses collègues en identifièrent une qui se lie spécifiquement aux tumeurs réagissant à la thérapie. À ce peptide, ils attachent une molécule émettant de la lumière et injectent ces peptides étiquetées aux souris auxquelles on avait greffé des tumeurs humaines.
À l’aide de cameras d’imagerie spécialisées qui détectent la lumière à courte portée infrarouge (invisible à l’œil humaine), les chercheurs observèrent que les tumeurs réagissant à la thérapie étaient plus brillantes que celles qui ne réagissaient pas. Le peptide détecta la réaction parmi une large sélection de tumeurs – cerveau, poumons, colon, prostate et sein – 2 jours après le début u traitement.
“Dans ce cas, le mot-clé est ‘jours,’” estima Hallahan. “Ceci nous permettra de minimiser la durée des traitements au régime inefficace pour les patients cancéreux.”
L’étape suivante sera de transférer cette technologie à l’être humain. La technique d’imagerie utilisée pour les souris (proche-infrarouge) n’est pas assez sensible pour pénétrer profondément dans les tissus humains ; donc, les chercheurs adoptent à technologie à une modalité d’imagerie communément utilisée pour l’Homme, appelée PET (tomographie par émission de positons).
“Cette peptide d’imagerie fera l’objet d’essais cliniques dans près de 18 mois,” indiqua Hallahan. “L’objectif, lorsque nous l’introduisons dans un corps humain, est de poser un simple question: pouvons-nous imager les cancers réagissant aussi bien chez les hommes que les souris?”
Si tel est le cas, il dit suspecter que de telles méthodes d’imagerie moléculaires contribueraient à accélérer le développement de nouveaux médicaments thérapeutiques.
“Dans l’industrie pharmaceutique, nous pouvons mettre un patient pendants des mois sous médicaments avant de pouvoir ré-évaluer la taille de la tumeur,” indiqua Hallahan. “Si nous réussissons à obtenir cette réponse en 2 jours, cela accélérera le développement de médicaments contre le cancer dans les premières phases des essais cliniques.”
Article écrit le 2008-03-03 par © Copyright InformationHospitaliere.com
Source: Vanderbilt University Medical Center - "EurekAlert!, a service of AAAS" - InformationHospitaliere.com
...
...
Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs au Vanderbilt-Ingram Cancer Center, une technique qui “étiquète” spécifiquement les tumeurs réagissant à la chimiothérapie, représenterait une nouvelle stratégie visant à déterminer l’efficacité d’un traitement du cancer dans les quelques jours suivant le début du traitement.
Dans l’étude apparaissant en ligne avant son impression dans Nature Medicine, les chercheurs signalent l’identification d’une petite protéine qui reconnait spécifiquement les tumeurs réagissant à la chimiothérapie. Ils révèlent que lorsque la protéine est étiquetée d’une molécule émettant de la lumière, elle peut être utilisée pour visualiser la réaction du cancer chez les souris, seulement 2 jours après le début de la thérapie.
Une surveillance améliorée de la réaction tumorale aiderait à personnaliser les traitements des patients et à accélérer le développement de nouveaux médicaments contre le cancer, indiqua l’auteur principal docteur Dennis Hallahan, professeur de recherche sur le cancer à Ingram et chef du département de Radiation Oncology au Vanderbilt University Medical Center.
Actuellement, la réaction à la chimiothérapie est déterminée en mesurant les changements de la taille de la tumeur à l’aide de techniques d’imagerie telles que la scanographie et l’IRM (Imagerie par Résonnance Magnétique).
“Deux à trois mois de thérapie contre le cancer sont nécessaires avant de pouvoir déterminer si la thérapie a été efficace pour un patient,” indiqua-t-il. “Si nous pouvons obtenir cette réponse en 2 ou 3 jours, nous pourrions transférer le patient à une thérapie alternative très rapidement.”
L’évaluation rapide de la réaction tumorale est très importante actuellement, signale Hallahan, vu les percées récentes en terme de thérapies moléculaires ciblées – médicaments chimiothérapiques qui interviennent spécifiquement dans la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses, tout en évitant d’endommager les cellules saines.
“Nous avons aujourd’hui un grand nombre de médicaments moléculaires ciblés dont nous pouvons choisir et leur nombre de cesse de croitre chaque année ; nous en somme donc à une période où le patient peut être transféré d’une thérapie à l’autre,” expliqua-t-il. “Mais nous avons besoin de certains outils afin de prendre la décision d’utiliser une thérapie alternative avec le patient.”
Afin de trouver une méthode rapide et non invasive destinée à évaluer la réaction du cancer aux thérapies, Hallahan ne dirigea pas son attention sur la taille de la tumeur, mais sur les changements cellulaires et moléculaires des cancers réagissant.
Parmi des milliards de fragments de protéines, ou peptides, Hallahan et ses collègues en identifièrent une qui se lie spécifiquement aux tumeurs réagissant à la thérapie. À ce peptide, ils attachent une molécule émettant de la lumière et injectent ces peptides étiquetées aux souris auxquelles on avait greffé des tumeurs humaines.
À l’aide de cameras d’imagerie spécialisées qui détectent la lumière à courte portée infrarouge (invisible à l’œil humaine), les chercheurs observèrent que les tumeurs réagissant à la thérapie étaient plus brillantes que celles qui ne réagissaient pas. Le peptide détecta la réaction parmi une large sélection de tumeurs – cerveau, poumons, colon, prostate et sein – 2 jours après le début u traitement.
“Dans ce cas, le mot-clé est ‘jours,’” estima Hallahan. “Ceci nous permettra de minimiser la durée des traitements au régime inefficace pour les patients cancéreux.”
L’étape suivante sera de transférer cette technologie à l’être humain. La technique d’imagerie utilisée pour les souris (proche-infrarouge) n’est pas assez sensible pour pénétrer profondément dans les tissus humains ; donc, les chercheurs adoptent à technologie à une modalité d’imagerie communément utilisée pour l’Homme, appelée PET (tomographie par émission de positons).
“Cette peptide d’imagerie fera l’objet d’essais cliniques dans près de 18 mois,” indiqua Hallahan. “L’objectif, lorsque nous l’introduisons dans un corps humain, est de poser un simple question: pouvons-nous imager les cancers réagissant aussi bien chez les hommes que les souris?”
Si tel est le cas, il dit suspecter que de telles méthodes d’imagerie moléculaires contribueraient à accélérer le développement de nouveaux médicaments thérapeutiques.
“Dans l’industrie pharmaceutique, nous pouvons mettre un patient pendants des mois sous médicaments avant de pouvoir ré-évaluer la taille de la tumeur,” indiqua Hallahan. “Si nous réussissons à obtenir cette réponse en 2 jours, cela accélérera le développement de médicaments contre le cancer dans les premières phases des essais cliniques.”
Article écrit le 2008-03-03 par © Copyright InformationHospitaliere.com
Source: Vanderbilt University Medical Center - "EurekAlert!, a service of AAAS" - InformationHospitaliere.com
...
...
Communiqué de Presse FNESI, Paris, le 2 mars 2008
La FNESI interpelle l'Etat pour instaurer une directive nationale déterminant les modalités de prise en charge financière de l'AFGSU.
La FNESI, adhérente à la FAGE (première organisation représentative étudiante), dénonce les conditions de mise en place de l'AFGSU dans les IFSI (Instituts de formation en soins infirmiers). Reconnue « interlocuteur principal » par le Ministère de la Santé, Jeunesse et Sports, la FNESI s'étonne de n'avoir pas été consultée sur les conditions de mise en oeuvre de l'AFGSU.
L'AFGSU est rendue obligatoire pour les étudiants et professionnels infirmiers, par les arrêtés de mars 2006 et avril 2007. Cette formation est applicable aux étudiants entrés en formation dès septembre 2007, et sera progressivement intégrée dans le cursus des formation initiale et formation professionnelle continue.
La mise en oeuvre de la prise en charge financière prend du temps, c’est pourquoi la FNESI s’étonne de la mise en place précipitée et inexpliquée de la FGSU dans la formation infirmière, et ce de façon inégale et disparate dans les IFSI.
Des milliers d’étudiants en soins infirmiers (ESI) se voient contraints de payer l'AFGSU, selon une fourchette de prix allant de 150€ à 600€ par étudiant, selon les IFSI et les départements.
La FNESI alerte sur les impacts que l'AFGSU entraîne. A l'heure où le maintien de l'attractivité de la profession infirmière est un défi pour la société, l'attractivité de la formation infirmière se trouve touchée de plein fouet. La crainte de voir s'éloigner les ESI et futurs candidats au concours infirmier se fait de plus en plus ressentir.
La FNESI demande à l'Etat d'instaurer une véritable directive nationale sur les modalités de prise en charge financières de l'AFGSU. Car, pour la FNESI, le financement de cet enseignement ne doit être, en aucun cas, un poids financier supplémentaire pour les étudiants.
La FNESI interpelle l'Etat pour instaurer une directive nationale déterminant les modalités de prise en charge financière de l'AFGSU.
La FNESI, adhérente à la FAGE (première organisation représentative étudiante), dénonce les conditions de mise en place de l'AFGSU dans les IFSI (Instituts de formation en soins infirmiers). Reconnue « interlocuteur principal » par le Ministère de la Santé, Jeunesse et Sports, la FNESI s'étonne de n'avoir pas été consultée sur les conditions de mise en oeuvre de l'AFGSU.
L'AFGSU est rendue obligatoire pour les étudiants et professionnels infirmiers, par les arrêtés de mars 2006 et avril 2007. Cette formation est applicable aux étudiants entrés en formation dès septembre 2007, et sera progressivement intégrée dans le cursus des formation initiale et formation professionnelle continue.
La mise en oeuvre de la prise en charge financière prend du temps, c’est pourquoi la FNESI s’étonne de la mise en place précipitée et inexpliquée de la FGSU dans la formation infirmière, et ce de façon inégale et disparate dans les IFSI.
Des milliers d’étudiants en soins infirmiers (ESI) se voient contraints de payer l'AFGSU, selon une fourchette de prix allant de 150€ à 600€ par étudiant, selon les IFSI et les départements.
La FNESI alerte sur les impacts que l'AFGSU entraîne. A l'heure où le maintien de l'attractivité de la profession infirmière est un défi pour la société, l'attractivité de la formation infirmière se trouve touchée de plein fouet. La crainte de voir s'éloigner les ESI et futurs candidats au concours infirmier se fait de plus en plus ressentir.
La FNESI demande à l'Etat d'instaurer une véritable directive nationale sur les modalités de prise en charge financières de l'AFGSU. Car, pour la FNESI, le financement de cet enseignement ne doit être, en aucun cas, un poids financier supplémentaire pour les étudiants.
- fleurdorangette
- Fidèle

- Messages : 224
- Inscription : 13 mars 2007 00:56
- Localisation : 35-60
Question CG
1) Selon vous quel peut être le délais entre l'actualité et les sujets proposés au concours ?
Je m'explique... Pensez vous que les sujets traitant de l'actualité pour les concours de mars par exemple peuvent etre tiré dans l'actualité de fevrier ?
2) Faut il s'éloigner complètement du texte ou pas ? J'ai toujours un peu de mal avec ca... Je sais qu'il faut éviter la paraphrase mais c'est plus dans la réponse : s'aider du texte ou s'en détacher complètement
3) Comment présentez vous vos copies ? Recopiez vous les sujets ? Faites vous des alinéa etc.. ?
4) Pour ce qui est de la forme, faut il vraiment faire : Intro avec plan/développement/ Conclusion le tout en 15/20 lignes max. ?
Merci pour vos réponses et vos conseils
J'avoue être un peu déstabilisé par rapport à la forme de l'exercice après avoir eu l'habitude de rédiger des disserts de 5 pages à la fac...
Surtout que je suis loin d'avoir une écriture magnifique ce qui m'angoisse vu que ca fait partie des 5 points de l'épreuve.
Bon courage et bonnes révisions
Je m'explique... Pensez vous que les sujets traitant de l'actualité pour les concours de mars par exemple peuvent etre tiré dans l'actualité de fevrier ?
2) Faut il s'éloigner complètement du texte ou pas ? J'ai toujours un peu de mal avec ca... Je sais qu'il faut éviter la paraphrase mais c'est plus dans la réponse : s'aider du texte ou s'en détacher complètement
3) Comment présentez vous vos copies ? Recopiez vous les sujets ? Faites vous des alinéa etc.. ?
4) Pour ce qui est de la forme, faut il vraiment faire : Intro avec plan/développement/ Conclusion le tout en 15/20 lignes max. ?
Merci pour vos réponses et vos conseils
J'avoue être un peu déstabilisé par rapport à la forme de l'exercice après avoir eu l'habitude de rédiger des disserts de 5 pages à la fac...
Surtout que je suis loin d'avoir une écriture magnifique ce qui m'angoisse vu que ca fait partie des 5 points de l'épreuve.
Bon courage et bonnes révisions
***ESI 2008/2011 au Mans !***
Contente d'avoir été sur LP à Flers, Clermont de l'oise et Beaumont !
Contente d'avoir été sur LP à Flers, Clermont de l'oise et Beaumont !
Re: Question CG
Tu peux pour commencer jeter un oeil dans les différents topics de culture générale. La suite peut d'ailleurs s'orienter ici ou là
Probable... en même temps lors de l'oral tu peux avoir des sujets datant d'il y a très peu de temps.
[quote"fleurdorangette"]2) Faut il s'éloigner complètement du texte ou pas ? J'ai toujours un peu de mal avec ca... Je sais qu'il faut éviter la paraphrase mais c'est plus dans la réponse : s'aider du texte ou s'en détacher complètement[/quote]
Il faut apprendre à se détacher du texte... Ce n'est pas dans le texte que tu trouveras tous les arguments.
Tu n'as pas le temps de recopier le sujet. Tu indiques justes de quelles questions il s'agit. Pour les Alinéa, cela fait partie de la présentation. Si tu veux en faire pour mieux séparer l'introduction, le développement ou la conclusion.
Oui !
fleurdorangette a écrit :1) Selon vous quel peut être le délais entre l'actualité et les sujets proposés au concours ?
Je m'explique... Pensez vous que les sujets traitant de l'actualité pour les concours de mars par exemple peuvent etre tiré dans l'actualité de fevrier ?
Probable... en même temps lors de l'oral tu peux avoir des sujets datant d'il y a très peu de temps.
[quote"fleurdorangette"]2) Faut il s'éloigner complètement du texte ou pas ? J'ai toujours un peu de mal avec ca... Je sais qu'il faut éviter la paraphrase mais c'est plus dans la réponse : s'aider du texte ou s'en détacher complètement[/quote]
Il faut apprendre à se détacher du texte... Ce n'est pas dans le texte que tu trouveras tous les arguments.
3) Comment présentez vous vos copies ? Recopiez vous les sujets ? Faites vous des alinéa etc.. ?
Tu n'as pas le temps de recopier le sujet. Tu indiques justes de quelles questions il s'agit. Pour les Alinéa, cela fait partie de la présentation. Si tu veux en faire pour mieux séparer l'introduction, le développement ou la conclusion.
4) Pour ce qui est de la forme, faut il vraiment faire : Intro avec plan/développement/ Conclusion le tout en 15/20 lignes max. ?
Oui !
La carte des maladies cardio-vasculaires montre de considérables disparités en Europe
LE MONDE | 03.03.08 | 15h57 • Mis à jour le 03.03.08 | 17h13
C'est une nouvelle carte du Vieux Continent que dresse, dans le dernier numéro de la revue de la Société européenne de cardiologie, un groupe de médecins, d'épidémiologistes et d'économistes de la santé dirigé par Stefan N. Willich (Charité University Medical Center, Berlin). Elle fait apparaître de considérables variations dans les morts prématurées dues aux accidents vasculaires. Economiquement, la question n'est pas négligeable. Une réunion de spécialistes organisée, mardi 26 février à Bruxelles, sous l'égide de l'Union européenne, a estimé que les décès prématurés dus aux affections vasculaires coûtaient chaque année 192 milliards d'euros à l'UE. Soit, per capita, une somme annuelle de 391 euros qui correspond pour 57 % aux soins médicaux, pour 21 % aux pertes de productivité et, pour le reste, à des pertes indirectes.
"AU NIVEAU RÉGIONAL"
Les premières études visant à évaluer l'incidence comparative des affections cardio-vasculaires dans les pays industrialisés datent du début des années 1970, après la découverte de l'augmentation constante des cas de maladie coronarienne. A partir du début des années 1980, plusieurs études internationales ont été lancées concernant les seules affections cardiaques. Elles ont permis, une dizaine d'années plus tard, de mettre en lumière les premières différences entre les pays européens. Le travail mené par les chercheurs allemands à partir des statistiques d'une trentaine de pays actualise ces approches tout en apportant un grand nombre de nouvelles données. Il ne fournit pas pour autant de grille pour comprendre l'origine des différences observées.
"Une des leçons essentielles (...) tient dans l'émergence de différences existant au niveau régional et non plus, seulement, national, explique le professeur Guy de Backer (université de Gand, Belgique). Un autre enseignement résulte de la distinction qui peut désormais être faite entre ces deux entités que sont les maladies coronariennes et les maladies cérébrovasculaires. Nous découvrons que certains pays - la Grèce et le Portugal notamment - ont une mortalité cérébrovasculaire relativement élevée coïncidant avec une faible mortalité coronarienne."
Comment comprendre ? Pour le spécialiste belge, la réponse ne réside pas totalement dans les différences nationales des systèmes de prise en charge de ces urgences médicales, pas plus que dans les incidences des facteurs de risque comme la consommation de tabac ou des taux sanguins anormaux de cholestérol. Tout se passe, selon lui, comme si, grâce sans doute aux actions de prévention, on assistait en Europe à une réduction progressive et générale de la mortalité vasculaire. Mais dans le même temps, les différences nationales ne sont pas gommées.
"Une large partie de la France est toujours, avec la Catalogne, une des zones où les incidences de mortalité vasculaire sont les plus basses en Europe, souligne le professeur de Backer. En Belgique, nous observons des différences entre la Flandre, moins touchée, et la Wallonie. Mieux comprendre imposera sans doute, à l'avenir, de compter aussi avec certains paramètres psychosociaux."
Pour la communauté des cardiologues européens, les interrogations qui demeurent ne sauraient remettre en cause la promotion des vertus d'une alimentation saine et d'un mode de vie hygiénique.
Jean-Yves Nau
LE MONDE | 03.03.08 | 15h57 • Mis à jour le 03.03.08 | 17h13
C'est une nouvelle carte du Vieux Continent que dresse, dans le dernier numéro de la revue de la Société européenne de cardiologie, un groupe de médecins, d'épidémiologistes et d'économistes de la santé dirigé par Stefan N. Willich (Charité University Medical Center, Berlin). Elle fait apparaître de considérables variations dans les morts prématurées dues aux accidents vasculaires. Economiquement, la question n'est pas négligeable. Une réunion de spécialistes organisée, mardi 26 février à Bruxelles, sous l'égide de l'Union européenne, a estimé que les décès prématurés dus aux affections vasculaires coûtaient chaque année 192 milliards d'euros à l'UE. Soit, per capita, une somme annuelle de 391 euros qui correspond pour 57 % aux soins médicaux, pour 21 % aux pertes de productivité et, pour le reste, à des pertes indirectes.
"AU NIVEAU RÉGIONAL"
Les premières études visant à évaluer l'incidence comparative des affections cardio-vasculaires dans les pays industrialisés datent du début des années 1970, après la découverte de l'augmentation constante des cas de maladie coronarienne. A partir du début des années 1980, plusieurs études internationales ont été lancées concernant les seules affections cardiaques. Elles ont permis, une dizaine d'années plus tard, de mettre en lumière les premières différences entre les pays européens. Le travail mené par les chercheurs allemands à partir des statistiques d'une trentaine de pays actualise ces approches tout en apportant un grand nombre de nouvelles données. Il ne fournit pas pour autant de grille pour comprendre l'origine des différences observées.
"Une des leçons essentielles (...) tient dans l'émergence de différences existant au niveau régional et non plus, seulement, national, explique le professeur Guy de Backer (université de Gand, Belgique). Un autre enseignement résulte de la distinction qui peut désormais être faite entre ces deux entités que sont les maladies coronariennes et les maladies cérébrovasculaires. Nous découvrons que certains pays - la Grèce et le Portugal notamment - ont une mortalité cérébrovasculaire relativement élevée coïncidant avec une faible mortalité coronarienne."
Comment comprendre ? Pour le spécialiste belge, la réponse ne réside pas totalement dans les différences nationales des systèmes de prise en charge de ces urgences médicales, pas plus que dans les incidences des facteurs de risque comme la consommation de tabac ou des taux sanguins anormaux de cholestérol. Tout se passe, selon lui, comme si, grâce sans doute aux actions de prévention, on assistait en Europe à une réduction progressive et générale de la mortalité vasculaire. Mais dans le même temps, les différences nationales ne sont pas gommées.
"Une large partie de la France est toujours, avec la Catalogne, une des zones où les incidences de mortalité vasculaire sont les plus basses en Europe, souligne le professeur de Backer. En Belgique, nous observons des différences entre la Flandre, moins touchée, et la Wallonie. Mieux comprendre imposera sans doute, à l'avenir, de compter aussi avec certains paramètres psychosociaux."
Pour la communauté des cardiologues européens, les interrogations qui demeurent ne sauraient remettre en cause la promotion des vertus d'une alimentation saine et d'un mode de vie hygiénique.
Jean-Yves Nau
IDE depuis le 31 mai 2012 ! 
Tuberculose : flambée des souches multirésistantes
NOUVELOBS.COM | 03.03.2008 | 16:16
Selon l’OMS, chaque année 500 000 nouveaux cas de tuberculose à bacilles multirésistants (MR) sont diagnostiqués et des microbes ultrarésistants (UR), pratiquement inguérissables, émergent également un peu partout dans le monde.
La tuberculose est une maladie infectieuse qui tue chaque année près de deux millions de personnes dans le monde tandis que neuf millions de nouveaux cas apparaissent. Depuis une vingtaine d’année cette maladie connaît une recrudescence liée à l’apparition de souches résistantes aux traitements. Pour mieux cerner ce phénomène, l’Organisation pour la santé a mené la plus vaste enquête jamais réalisée sur l’ampleur de la pharmacorésistance : les résultats sont plus qu’alarmants.
Sur la base de l'analyse des données de cette enquête, l’OMS estime qu’environ un demi-million de nouveaux cas de tuberculose MR chaque année dans le monde, soit 5% environ du nombre total de nouveaux cas de tuberculose qui est de neuf millions. Les taux les plus élevés sont retrouvés dans les nouveaux pays de l’Est et d’Asie centrale. A noter que ce sont les malades du SIDA qui paient le plus lourd tribut à cette maladie puisqu’ils sont deux fois plus nombreux à développer une tuberculose MR. Pour traiter cette affeion , il faut recourir à des médicaments de deuxième génération beaucoup plus chers et présentant plus d’effets secondaires. La mauvaise utilisation des traitements de première intention est l’une des causes de l’apparition de germes multirésistants.
L’OMS constate également que des cas de tuberculose à bacilles ultrarésistants (tuberculose UR), une forme qu’il est pratiquement impossible de traiter, ont été enregistrés dans 45 pays. Comme l’a fait observer le Dr Mario Raviglione, Directeur du Département Halte à la tuberculose de l’OMS, «une riposte frontale s’impose contre le problème de la pharmacorésistance et, si les pays et la communauté internationale ne font pas preuve de la détermination nécessaire, la bataille sera perdue ».L’OMS estime qu’il faut en 2008, 4,8 milliards de dollars pour lutter globalement contre la tuberculose dans les pays à revenu faible et intermédiaire, dont un milliard pour la tuberculose MR et UR. Or, le déficit de financement atteint 2,5 milliards, dont 500 millions en ce qui concerne la tuberculose MR et UR. Un effort urgent s’impose donc.
J.I.
Sciences et Avenir.com
03/03/08
NOUVELOBS.COM | 03.03.2008 | 16:16
Selon l’OMS, chaque année 500 000 nouveaux cas de tuberculose à bacilles multirésistants (MR) sont diagnostiqués et des microbes ultrarésistants (UR), pratiquement inguérissables, émergent également un peu partout dans le monde.
La tuberculose est une maladie infectieuse qui tue chaque année près de deux millions de personnes dans le monde tandis que neuf millions de nouveaux cas apparaissent. Depuis une vingtaine d’année cette maladie connaît une recrudescence liée à l’apparition de souches résistantes aux traitements. Pour mieux cerner ce phénomène, l’Organisation pour la santé a mené la plus vaste enquête jamais réalisée sur l’ampleur de la pharmacorésistance : les résultats sont plus qu’alarmants.
Sur la base de l'analyse des données de cette enquête, l’OMS estime qu’environ un demi-million de nouveaux cas de tuberculose MR chaque année dans le monde, soit 5% environ du nombre total de nouveaux cas de tuberculose qui est de neuf millions. Les taux les plus élevés sont retrouvés dans les nouveaux pays de l’Est et d’Asie centrale. A noter que ce sont les malades du SIDA qui paient le plus lourd tribut à cette maladie puisqu’ils sont deux fois plus nombreux à développer une tuberculose MR. Pour traiter cette affeion , il faut recourir à des médicaments de deuxième génération beaucoup plus chers et présentant plus d’effets secondaires. La mauvaise utilisation des traitements de première intention est l’une des causes de l’apparition de germes multirésistants.
L’OMS constate également que des cas de tuberculose à bacilles ultrarésistants (tuberculose UR), une forme qu’il est pratiquement impossible de traiter, ont été enregistrés dans 45 pays. Comme l’a fait observer le Dr Mario Raviglione, Directeur du Département Halte à la tuberculose de l’OMS, «une riposte frontale s’impose contre le problème de la pharmacorésistance et, si les pays et la communauté internationale ne font pas preuve de la détermination nécessaire, la bataille sera perdue ».L’OMS estime qu’il faut en 2008, 4,8 milliards de dollars pour lutter globalement contre la tuberculose dans les pays à revenu faible et intermédiaire, dont un milliard pour la tuberculose MR et UR. Or, le déficit de financement atteint 2,5 milliards, dont 500 millions en ce qui concerne la tuberculose MR et UR. Un effort urgent s’impose donc.
J.I.
Sciences et Avenir.com
03/03/08
IDE depuis le 31 mai 2012 ! 
Activité physique : quel est le minimum vital ?
Vivre le plus longtemps possible, c'est bien, mais vivre le plus longtemps possible en forme, c'est mieux. C'est précisément ce qui est possible si l'on pratique régulièrement une activité physique. Les personnes qui font du sport, par rapport à celles qui sont sédentaires toute leur vie, gagnent 8 années en bonne forme physique. Alors en pratique, quelle est la quantité minimale de sport qu'il faut pratiquer et son équivalent en dépense calorique ?
Lorsqu'on pratique une activité physique régulière, on diminue son risque de mourir d'une maladie cardiaque d'environ 35 à 40%. Et comme le souligne le Dr Martin Juneau*, on sait aujourd'hui que c'est valable pour toutes les causes de mortalité. Par comparaison avec les personnes totalement sédentaires, on peut également dire que le sport permet de vivre 8 années de plus en bonne forme.
Quelle est la quantité minimale d'activité physique qu'il faut pratiquer ?
Un exercice physique modéré peut parfaitement suffire. L'objectif de brûler 1.000 calories par semaine est réaliste pour nous tous : cela correspond à 30 minutes de marche par jour.
En d'autres termes, il faut réaliser chaque semaine 7 marches de 30 minutes puisque lors d'une marche de 30 minutes on dépense 150 calories.
Si l'on préfère réaliser seulement 4 marches par semaine, c'est possible, mais il faut alors augmenter leur durée à 40 minutes (250 calories).
Il est donc possible de marcher moins souvent, mais à condition de marcher plus longtemps pour que la quantité totale de calories dépensées soit la même.
De la même façon on peut faire des joggings de 20 minutes 7 fois dans la semaine (20 minutes de jogging équivalent à 150 calories) ou des joggings de 30 minutes 4 fois par semaine (4 x 30 minutes à 250 calories).
L'intensité ne compte pas vraiment si elle est modulée par la durée. C'est-à-dire que si l'on choisi la marche rapide par exemple, elle pourra durer moins longtemps qu'une marche lente mais plus longtemps que si on avait choisi le jogging. La quantité de sueur n'est pas non plus un indicateur. C'est la quantité totale qui compte.
Utilisez un podomètre
Un conseil, portez un podomètre durant toute une semaine afin de connaître votre dépense énergétique réelle.
Entre 0 et 5.000 pas par jour, vous êtes sédentaire.
Entre 5.000 à 7.500 : légèrement actif.
Entre 7.500 à 9.999 : modérément actif.
Plus de 10.000 : actif.
Plus de 12.500 : très actif
L'objectif est donc de cumuler un total de 10.000 pas par jour.
A titre indicatif, lors d'une activité de bureau on réalise en moyenne 2.000 pas par jour, ce qui est très loin des 10.000 pas. Il est donc nécessaire de réaliser encore 8.000 pas supplémentaires lors de ses activités de loisirs et de la vie quotidienne autres que professionnelles.
Et oui, il ne faut pas oublier que tous les pas s'ajoutent, absolument tous, même ceux que l'on réalise chez soi pour aller ouvrir le frigo.
A savoir
10.000 pas par jour équivalent à une dépense de 300 à 400 calories.
30 minutes de marche équivalent à 4.000 pas et à une dépense de 150 calories.
Un gros morceau de gâteau au chocolat équivaut à 400 calories…
Pourquoi faut-il répartir l'exercice physique ?
En d'autres termes, peut-on grouper toute l'activité physique hebdomadaire en une seule séance (par ex. une seule marche de 3 heures et demie une fois dans la semaine) ?
La réponse est négative, l'activité physique doit être fragmentée.
De nombreux effets de l'exercice physique ne durent pas toute la semaine. Par exemple, l'effet d'une séance de sport sur la glycémie (taux de sucre dans le sang) ne dure pas. L'exercice diminue le taux de sucre sanguin et augmente la sensibilité à l'insuline des muscles, ce qui est très bon pour prévenir nombre de maladies, dont le diabète et l'obésité. Mais cet effet ne dure que 24 à 48 heures. Il faut donc recommencer tous les deux jours pour obtenir un effet préventif sur le long terme.
Et enfin, il faut savoir que si pendant une marche de 30 minutes, on dépense 150 calories, le métabolisme reste activé durant les heures qui suivent la fin de l'exercice (pendant environ 10-12 heures) et continue à brûler des calories additionnelles. La dépense réelle est donc plus élevée que la théorique... Une bonne raison de pratiquer régulièrement et souvent.
* Le Dr Martin Juneau est cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal.
03/03/2008
Dr Philippe Presles
Conférence du Dr Martin Juneau, " Exercice, alimentation et prévention des maladies cardiovasculaires ", causeries PasseportSanté.net, mai 2007.
Vivre le plus longtemps possible, c'est bien, mais vivre le plus longtemps possible en forme, c'est mieux. C'est précisément ce qui est possible si l'on pratique régulièrement une activité physique. Les personnes qui font du sport, par rapport à celles qui sont sédentaires toute leur vie, gagnent 8 années en bonne forme physique. Alors en pratique, quelle est la quantité minimale de sport qu'il faut pratiquer et son équivalent en dépense calorique ?
Lorsqu'on pratique une activité physique régulière, on diminue son risque de mourir d'une maladie cardiaque d'environ 35 à 40%. Et comme le souligne le Dr Martin Juneau*, on sait aujourd'hui que c'est valable pour toutes les causes de mortalité. Par comparaison avec les personnes totalement sédentaires, on peut également dire que le sport permet de vivre 8 années de plus en bonne forme.
Quelle est la quantité minimale d'activité physique qu'il faut pratiquer ?
Un exercice physique modéré peut parfaitement suffire. L'objectif de brûler 1.000 calories par semaine est réaliste pour nous tous : cela correspond à 30 minutes de marche par jour.
En d'autres termes, il faut réaliser chaque semaine 7 marches de 30 minutes puisque lors d'une marche de 30 minutes on dépense 150 calories.
Si l'on préfère réaliser seulement 4 marches par semaine, c'est possible, mais il faut alors augmenter leur durée à 40 minutes (250 calories).
Il est donc possible de marcher moins souvent, mais à condition de marcher plus longtemps pour que la quantité totale de calories dépensées soit la même.
De la même façon on peut faire des joggings de 20 minutes 7 fois dans la semaine (20 minutes de jogging équivalent à 150 calories) ou des joggings de 30 minutes 4 fois par semaine (4 x 30 minutes à 250 calories).
L'intensité ne compte pas vraiment si elle est modulée par la durée. C'est-à-dire que si l'on choisi la marche rapide par exemple, elle pourra durer moins longtemps qu'une marche lente mais plus longtemps que si on avait choisi le jogging. La quantité de sueur n'est pas non plus un indicateur. C'est la quantité totale qui compte.
Utilisez un podomètre
Un conseil, portez un podomètre durant toute une semaine afin de connaître votre dépense énergétique réelle.
Entre 0 et 5.000 pas par jour, vous êtes sédentaire.
Entre 5.000 à 7.500 : légèrement actif.
Entre 7.500 à 9.999 : modérément actif.
Plus de 10.000 : actif.
Plus de 12.500 : très actif
L'objectif est donc de cumuler un total de 10.000 pas par jour.
A titre indicatif, lors d'une activité de bureau on réalise en moyenne 2.000 pas par jour, ce qui est très loin des 10.000 pas. Il est donc nécessaire de réaliser encore 8.000 pas supplémentaires lors de ses activités de loisirs et de la vie quotidienne autres que professionnelles.
Et oui, il ne faut pas oublier que tous les pas s'ajoutent, absolument tous, même ceux que l'on réalise chez soi pour aller ouvrir le frigo.
A savoir
10.000 pas par jour équivalent à une dépense de 300 à 400 calories.
30 minutes de marche équivalent à 4.000 pas et à une dépense de 150 calories.
Un gros morceau de gâteau au chocolat équivaut à 400 calories…
Pourquoi faut-il répartir l'exercice physique ?
En d'autres termes, peut-on grouper toute l'activité physique hebdomadaire en une seule séance (par ex. une seule marche de 3 heures et demie une fois dans la semaine) ?
La réponse est négative, l'activité physique doit être fragmentée.
De nombreux effets de l'exercice physique ne durent pas toute la semaine. Par exemple, l'effet d'une séance de sport sur la glycémie (taux de sucre dans le sang) ne dure pas. L'exercice diminue le taux de sucre sanguin et augmente la sensibilité à l'insuline des muscles, ce qui est très bon pour prévenir nombre de maladies, dont le diabète et l'obésité. Mais cet effet ne dure que 24 à 48 heures. Il faut donc recommencer tous les deux jours pour obtenir un effet préventif sur le long terme.
Et enfin, il faut savoir que si pendant une marche de 30 minutes, on dépense 150 calories, le métabolisme reste activé durant les heures qui suivent la fin de l'exercice (pendant environ 10-12 heures) et continue à brûler des calories additionnelles. La dépense réelle est donc plus élevée que la théorique... Une bonne raison de pratiquer régulièrement et souvent.
* Le Dr Martin Juneau est cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal.
03/03/2008
Dr Philippe Presles
Conférence du Dr Martin Juneau, " Exercice, alimentation et prévention des maladies cardiovasculaires ", causeries PasseportSanté.net, mai 2007.
IDE depuis le 31 mai 2012 !