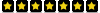séisme Asie du Sud
Modérateur : Modérateurs
m-p a écrit :
Que faire concrétement ?
Vivre avec le meilleur bilan écologique ( recyclage , énergies renouvelables , éviter la voiture ... )
Pour ma part la j essayes de pouvoir partir aprés mes partiels fin janvier mais bon rien de sur .
De ce qui est humain et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est divin et de ce qui est simplement ... un rêve
Charlotte Bousquet
Charlotte Bousquet
-
Hub
- Accro

- Messages : 1474
- Inscription : 15 nov. 2003 15:59
- Localisation : Pas loin d'une chopine de malt et de houblon
Euh partir?
A mon avis ce dont ils ont besoin, c'est d'un don en materiel de Cat, de Volvo, de Komatsu et autres, du savoir faire de boites comme Bouygues pour remettre en état les infrastuctures routières, hydrauliques et de genie civil.
D'une armée de logisticiens professionnelles rodés aux situations de désastres pour acheminer au plus vite l'aide.
Un bravo aux usa tout de même, envoyer les helicos de l'armée sans demander l'avis de personne pour faire plus vite c'est pas mal.
Hub
A mon avis ce dont ils ont besoin, c'est d'un don en materiel de Cat, de Volvo, de Komatsu et autres, du savoir faire de boites comme Bouygues pour remettre en état les infrastuctures routières, hydrauliques et de genie civil.
D'une armée de logisticiens professionnelles rodés aux situations de désastres pour acheminer au plus vite l'aide.
Un bravo aux usa tout de même, envoyer les helicos de l'armée sans demander l'avis de personne pour faire plus vite c'est pas mal.
Hub
Des peuples déjà bien miséreux touchés par une telle catastrophe!
Les images que je voie tous les jours dans les médias me refroidissent!
Je suis contente d' être française, d' avoir à manger, d' avoir un toit, d' avoir un enfant en bonne santé!
J' ai mal pour tous ces pauvres gens démunis, je me sens impuissante face à de telles detresses!!!
Les images que je voie tous les jours dans les médias me refroidissent!
Je suis contente d' être française, d' avoir à manger, d' avoir un toit, d' avoir un enfant en bonne santé!
J' ai mal pour tous ces pauvres gens démunis, je me sens impuissante face à de telles detresses!!!

~oLeeLeeo~ a écrit :Il est vrai que c'est la la nature qui l'a voulu.Certes.Mais pourquoi les populations les plus pauvres et les plus démunies sont toujours touchées par les pires fléaus tels que les guerres,les catastrophes naturelles...
Je me demande parfois si la vie,la terre,et l'humain lui-même ne sont pas injustes.
J'avais entendu une théorie comme quoi la nature "purgeait" le trop plein d'humains sur la planète...[…].
En disant que c’est la nature qui l’a voulu, tu fais référence aux mythes fondateurs et/ou destructeurs où la nature était dotée de volonté et capable de jugement envers l’humanité.
La symbolique des risques naturelle est très riche (voir les déluges et l’Atlantide ).
La symbolique de l’eau aussi ! L’élément aqueux est ambivalent car à la fois dangereux et bienfaisant, l’eau est à la fois destructrice et bienfaitrice, symbole de mort et de vie : tout organisme vivant, l’homme compris, a besoin d’eau pour vivre.
Selon la perspective théologique, le Déluge est un châtiment divin et selon la perspective philosophique, le Déluge fait partie d’un cycle qui comprend une alternance de destruction et de renaissance de l’humanité (je vais éviter ici l’approche psycho-sociologique).
D’autre part, ces catastrophes frappent des pays, déjà en proie à de sérieuses difficultés économiques et politiques, affaiblissant encore davantage des services publics fragilisés, dans les domaines notamment de la santé, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. Certaines catastrophes récurrentes, comme les inondations saisonnières empêchent les sinistrés de se relever d’une année sur l’autre
De tout temps, les catastrophes naturelles ont bouleversé la vie quotidienne de l’humanité, emportant vies et biens sur leur passage.
Le développement de la démographie, de l’urbanisme et de la technologie a multiplié les risques et rendu dramatique les conséquences de ces désastres.
Les pays en développement souffrent de problèmes écologiques (comme le réchauffement de la planète et l'appauvrissement de la couche d'ozone) qui jusqu'ici ont été largement causés par les activités économiques des pays développés. Les pays pauvres manquent de ressources financières pour passer à des technologies écologiquement rationnelles qui sont plus chères et adopter des pratiques de développement durable.
En plus de la facture écologique et humanitaire, la pauvreté contribue à des tensions sociales, à l'instabilité politique et à des conflits armés.
Et le pouvoir des images !!!! … Il y aurait grandement à dire en ce moment…
Durden a écrit :Prier.
Non c'est pas toujours les même qui trinque, même si c'était pas à même échelle, tout le monde en prend pour son grade;
Pourquoi pas ! ...
Tout le monde en prend pour son grade, mais ce n’est pas la même échelle ni de valeur, ni de comparaison. Il y a vraiment une zone de fracture entre le Nord et le Sud !
Aujourd’hui on sait assez précisément prévoir les risques à défaut de les prévenir efficacement
m-p a écrit :Il faut croire que les catastrophes naturelles et les guerres ne suffisent pas .
La terre est surpeuplée : + de 6 milliards d'humains , bientôt 7 milliards !
Que faire concrétement ?
Des chiffres ...des chiffres ! pas toujours récents, ceux-ci datent de la fin du siècle passé !
=> Sur environ 4,2 milliards d'habitants que comptent les pays en développement, 1 milliard vivent en état de pauvreté.
=> Parmi ce milliard de pauvres, 450 millions vivent dans des régions agricoles au potentiel réduit, 450 millions dans des zones écologiquement vulnérables exposées à l'érosion des sols, à la dégradation des terres, à des inondations et autres catastrophes, et 100 millions dans des taudis urbains.
=> En Afrique subsaharienne, 62% de la population vit en état de pauvreté; en Amérique latine, 35%; en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 28%; et en Asie, 25%.
=> Depuis 1975, le nombre de citadins pauvres a doublé en Amérique latine; il a augmenté de 81% en Afrique et de 55% en Asie.
=> Les pays industrialisés consomment entre 48 et 72% des produits alimentaires de base de la planète, comme les céréales, la viande et le lait.
=> Deux tiers des pauvres dans le monde ont moins de 15 ans.
77% des habitants de la planète reçoivent 15% de l'ensemble des revenus.
=> En Amérique latine, 1% de la population possède 40% des terres arables.
=> Si les tendances actuelles continuent, on prévoit que la population du globe atteindra 8,5 milliards en 2025 et entre 9 et 14 milliards à la fin du XXI siècle. Quatre-vingt-dix pour cent de la croissance de la population future aura lieu dans les pays en développement.
=> Une assistance égale à 0,7% du PNB des pays industrialisés représenterait 150 milliards de dollars par an, plus que les 125 milliards de dollars qu'on a estimés être le coût d'un développement durable..
=> Les dépenses militaires à l'échelle de la planète se montent officiellement à 1000 milliards de dollars par an et pourraient en atteindre 3000.
=> Une taxe "écologique" de 1 dollar sur chaque baril de pétrole consommé dans les pays industrialisés permettrait de recueillir 13,6 milliards de dollars par an.
=> Les sommes administrées par le Fonds pour l'environnement mondial s'élèvent actuellement à 400 millions de dollars par an.
=> Personne ne sait exactement combien d'espèces il y a sur la terre, bien que 1,4 million d'entre elles aient été identifiées et cataloguées.
=> On estime qu'il existe entre 5 millions et 100 millions d'espèces. Nombre d'entre elles meurent avant même d'avoir été cataloguées.
=> Les scientifiques pensent qu'au cours des derniers 600 millions d'années moins de 10 espèces par an se sont éteintes. De nos jours, environ 50 espèces disparaissent chaque jour; à ce rythme, environ un quart de toutes les espèces est menacé d'extinction dans le courant des cinquante prochaines années.
=> Environ 17 millions d'hectares de forêts tropicales ombrophiles, une superficie égale à celle du Japon, sont détruites chaque année. Ces forêts couvrent 7% de la surface de la terre, mais elles constituent l'habitat de 50 à 80% des espèces de la planète.
=> Sur une étendue typique d'environ 1000 hectares de forêt tropicale ombrophile, on trouve 1500 espèces de plantes qui fleurissent, 700 espèces d'arbres, 400 espèces d'oiseaux, 150 espèces de papillons et d'innombrables espèces d'insectes.
=> Près de 7000 zones protégées dans 130 pays sauvegardent les habitats de la faune et de la flore sauvages sur environ 5% de la surface des terres émergées.
=> L'agriculture est responsable de 70 à 80% de la demande mondiale d'eau douce; moins de 20% va à l'industrie et 6% est utilisée pour les usages domestiques.
=> 25% seulement du 1,5 milliard de citadins dans les pays en développement disposent d'eau salubre et de services d'assainissement.
1,2 milliard de personnes au monde manquent d'eau potable.
=> Dans les pays en développement, 80% de toutes les maladies et plus de 30% des décès sont causés par la consommation d'eaux contaminées.
Certes c'est assez rébarbatif.... et encore je n'ai pas tout relevé
Ceci pour dire que nous ne sommes pas tous égaux non plus devant les catastrophes naturelles.... La faille est insondable entre le Nord et le Sud de la planète, les riches et les pauvres, les souvent ex-colonisés et les ex-colonisateurs. Pas tous égaux dans la manière d'envisager les conséquences à court, moyen et long terme.
______
La pensée vole, et les mots vont à pieds.
Les derniers des premiers
L'Express du 03/01/2005
Sur les côtes de l'Asie vivaient certains des plus anciens peuples de l'humanité. Il faudra tout tenter pour les sauver
Quand meurt un vieillard, c'est une bibliothèque qui disparaît. Quand périt un enfant, c'est au moins un lecteur qui s'en va. Quand décèdent l'un et l'autre, c'est une civilisation qui trépasse. Dans l'amoncellement des désastres dont l'Asie est aujourd'hui frappée, les sauveteurs, pris par les urgences, oublient encore de comptabiliser, parmi les victimes, des entités bien plus difficiles à dénombrer que les cadavres: des civilisations entières, dont plus personne ne sera là pour témoigner.
Sur les côtes de l'Asie, de l'Inde à l'Indonésie, vivaient en effet certains des plus anciens peuples premiers de l'humanité, jusque-là presque entièrement protégés, par leur isolement, des bouleversements de la modernité. Pêcheurs pour la plupart, aux modes de vie si particuliers, aux rites si spécifiques, aux langues si uniques, ils vivaient en nomades, comme le faisaient tous les hommes il y a dix mille ans. Ils constituaient l'ultime mémoire du patrimoine premier de l'humanité. Parmi eux, les Négritos des îles Andaman, les Jarawa, les Sentinelese, les Nicobarais, les Shonpen, et bien d'autres encore en Thaïlande, à Sumatra, à Java, en Malaisie, à Sri Lanka. Certains de ces peuples n'avaient plus que quelques centaines de membres; d'autres, au maximum, que quelques milliers. Au total, ils rassemblaient plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ils ont, semble-t-il, presque tous disparu. Parfois, leurs îles elles-mêmes sont englouties. Il n'y aura plus personne pour parler leurs langues, pour transmettre leur foi, leur art.
Cette mort simultanée de peuples premiers et de touristes venus d'Occident, de nomades contraints et de nomades ludiques, nous renvoie à la réalité de notre société, où riches et pauvres se mêlent, se côtoient, involontairement solidaires. Où ne survivent que les plus forts, les mieux protégés, les mieux reliés aux réseaux de communication et de prévision du monde.
Parmi les innombrables impératifs qui vont s'imposer aux sauveteurs d'aujourd'hui et aux reconstructeurs de demain, il ne faudra pas oublier de tout faire pour retrouver ce qui peut l'être de ces cultures et de tout tenter pour les transmettre. Mais qui s'occupera de contes et de légendes quand tant d'autres urgences s'imposent? Surtout, il ne faudra pas attendre de nouvelles catastrophes, naturelles ou provoquées par l'homme, pour protéger les différents peuples en péril dans des régions précaires, en particulier dans la forêt amazonienne, les déserts de l'Asie centrale et les forêts de l'Afrique subsaharienne. Il faudra notamment se préoccuper de leur apporter les moyens de résister à ces autres «tsunamis» que sont le réchauffement climatique, l'indifférence, l'absence de soins et d'éducation.
Alors que se prépare à Paris l'ouverture d'un magnifique musée des civilisations premières, il est plus urgent que jamais de faire en sorte que ne disparaissent pas ceux qui les portent encore.
L'Express du 03/01/2005
Sur les côtes de l'Asie vivaient certains des plus anciens peuples de l'humanité. Il faudra tout tenter pour les sauver
Quand meurt un vieillard, c'est une bibliothèque qui disparaît. Quand périt un enfant, c'est au moins un lecteur qui s'en va. Quand décèdent l'un et l'autre, c'est une civilisation qui trépasse. Dans l'amoncellement des désastres dont l'Asie est aujourd'hui frappée, les sauveteurs, pris par les urgences, oublient encore de comptabiliser, parmi les victimes, des entités bien plus difficiles à dénombrer que les cadavres: des civilisations entières, dont plus personne ne sera là pour témoigner.
Sur les côtes de l'Asie, de l'Inde à l'Indonésie, vivaient en effet certains des plus anciens peuples premiers de l'humanité, jusque-là presque entièrement protégés, par leur isolement, des bouleversements de la modernité. Pêcheurs pour la plupart, aux modes de vie si particuliers, aux rites si spécifiques, aux langues si uniques, ils vivaient en nomades, comme le faisaient tous les hommes il y a dix mille ans. Ils constituaient l'ultime mémoire du patrimoine premier de l'humanité. Parmi eux, les Négritos des îles Andaman, les Jarawa, les Sentinelese, les Nicobarais, les Shonpen, et bien d'autres encore en Thaïlande, à Sumatra, à Java, en Malaisie, à Sri Lanka. Certains de ces peuples n'avaient plus que quelques centaines de membres; d'autres, au maximum, que quelques milliers. Au total, ils rassemblaient plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ils ont, semble-t-il, presque tous disparu. Parfois, leurs îles elles-mêmes sont englouties. Il n'y aura plus personne pour parler leurs langues, pour transmettre leur foi, leur art.
Cette mort simultanée de peuples premiers et de touristes venus d'Occident, de nomades contraints et de nomades ludiques, nous renvoie à la réalité de notre société, où riches et pauvres se mêlent, se côtoient, involontairement solidaires. Où ne survivent que les plus forts, les mieux protégés, les mieux reliés aux réseaux de communication et de prévision du monde.
Parmi les innombrables impératifs qui vont s'imposer aux sauveteurs d'aujourd'hui et aux reconstructeurs de demain, il ne faudra pas oublier de tout faire pour retrouver ce qui peut l'être de ces cultures et de tout tenter pour les transmettre. Mais qui s'occupera de contes et de légendes quand tant d'autres urgences s'imposent? Surtout, il ne faudra pas attendre de nouvelles catastrophes, naturelles ou provoquées par l'homme, pour protéger les différents peuples en péril dans des régions précaires, en particulier dans la forêt amazonienne, les déserts de l'Asie centrale et les forêts de l'Afrique subsaharienne. Il faudra notamment se préoccuper de leur apporter les moyens de résister à ces autres «tsunamis» que sont le réchauffement climatique, l'indifférence, l'absence de soins et d'éducation.
Alors que se prépare à Paris l'ouverture d'un magnifique musée des civilisations premières, il est plus urgent que jamais de faire en sorte que ne disparaissent pas ceux qui les portent encore.
La pensée vole, et les mots vont à pieds.
Deuil planétaire
L'Express du 03/01/2005
Nous vivons la mort au bout du monde comme une affaire personnelle, en direct. Puissions-nous en tirer quelques leçons
Sur la longue liste des séismes qui ont éventré la terre depuis le début du XXe siècle, le drame qui vient de dévaster l'Asie n'est pas le plus meurtrier. Par trois fois, la Chine a connu des catastrophes qui ont fait plus de 200 000 victimes (en 1920, 1927 et 1976). Le Japon (en 1923), l'Italie (en 1908) et le Turkménistan (en 1948) ont aussi vu périr plus de 100 000 personnes dans les entrailles soudain béantes de leur sol. Jamais, cependant, le deuil ne prit la dimension planétaire qu'il connaît aujourd'hui. L'émotion que soulève ce raz de marée est comparable à celle qui saisit la planète après les attentats du 11 septembre 2001. Ces deux tragédies nous offrent, en fait, la face douloureuse de la mondialisation. Plus encore que dans les ruines du World Trade Center, des dizaines de nations pleurent aujourd'hui des morts. Bien sûr, les principales victimes sont, d'abord, les habitants des pays riverains de l'océan Indien, mais des touristes d'au moins 30 nationalités différentes (des dizaines, voire des centaines, de Français, de Suédois, de Finlandais, de Tchèques, de Roumains, etc.) ont également été emportés par les flots de ces tsunamis. Ce désastre devient donc le nôtre: il se décline en corps rapatriés et en deuils nationaux. Avec le tourisme globalisé, nous nous sommes approprié les plus beaux rivages de la planète et nous avons fait des océans une suite de «mare nostrum» avec hôtels de luxe, bungalows de rêve et autres clubs dits «paradisiaques». Dans ce monde «houellebecquien», nous avons glissé, sans vergogne, nos pénates d'individus mondialisés, oubliant que les lois de la nature n'obéissent pas à celles du progrès. Nous découvrons que ces accélérateurs d'échanges que sont les transports modernes et les médias peuvent aussi devenir des instruments de douleur et des broyeurs de rêves. Nous vivons la mort au bout du monde comme une affaire personnelle, en direct et en instantané. Puissions-nous en tirer quelques leçons. Le pire serait de nous en tenir à nos afflictions nationales. Il n'est pas de disparitions plus dramatiques que d'autres. Toutes ces vies enlevées se valent. Cessons, aussi, de croire au mirage du risque zéro et n'imaginons pas que l'on peut tout prévoir. La Terre n'est pas plus fâchée contre l'homme qu'hier. Mais la démographie mondiale et les moyens modernes de communication font que, occupant davantage ses espaces, nous nous exposons plus à ses caprices. Le temps des drames mondialisés ne fait que commencer
Éditorial de Denis Jeambar
L'Express du 03/01/2005
Nous vivons la mort au bout du monde comme une affaire personnelle, en direct. Puissions-nous en tirer quelques leçons
Sur la longue liste des séismes qui ont éventré la terre depuis le début du XXe siècle, le drame qui vient de dévaster l'Asie n'est pas le plus meurtrier. Par trois fois, la Chine a connu des catastrophes qui ont fait plus de 200 000 victimes (en 1920, 1927 et 1976). Le Japon (en 1923), l'Italie (en 1908) et le Turkménistan (en 1948) ont aussi vu périr plus de 100 000 personnes dans les entrailles soudain béantes de leur sol. Jamais, cependant, le deuil ne prit la dimension planétaire qu'il connaît aujourd'hui. L'émotion que soulève ce raz de marée est comparable à celle qui saisit la planète après les attentats du 11 septembre 2001. Ces deux tragédies nous offrent, en fait, la face douloureuse de la mondialisation. Plus encore que dans les ruines du World Trade Center, des dizaines de nations pleurent aujourd'hui des morts. Bien sûr, les principales victimes sont, d'abord, les habitants des pays riverains de l'océan Indien, mais des touristes d'au moins 30 nationalités différentes (des dizaines, voire des centaines, de Français, de Suédois, de Finlandais, de Tchèques, de Roumains, etc.) ont également été emportés par les flots de ces tsunamis. Ce désastre devient donc le nôtre: il se décline en corps rapatriés et en deuils nationaux. Avec le tourisme globalisé, nous nous sommes approprié les plus beaux rivages de la planète et nous avons fait des océans une suite de «mare nostrum» avec hôtels de luxe, bungalows de rêve et autres clubs dits «paradisiaques». Dans ce monde «houellebecquien», nous avons glissé, sans vergogne, nos pénates d'individus mondialisés, oubliant que les lois de la nature n'obéissent pas à celles du progrès. Nous découvrons que ces accélérateurs d'échanges que sont les transports modernes et les médias peuvent aussi devenir des instruments de douleur et des broyeurs de rêves. Nous vivons la mort au bout du monde comme une affaire personnelle, en direct et en instantané. Puissions-nous en tirer quelques leçons. Le pire serait de nous en tenir à nos afflictions nationales. Il n'est pas de disparitions plus dramatiques que d'autres. Toutes ces vies enlevées se valent. Cessons, aussi, de croire au mirage du risque zéro et n'imaginons pas que l'on peut tout prévoir. La Terre n'est pas plus fâchée contre l'homme qu'hier. Mais la démographie mondiale et les moyens modernes de communication font que, occupant davantage ses espaces, nous nous exposons plus à ses caprices. Le temps des drames mondialisés ne fait que commencer
Éditorial de Denis Jeambar
La pensée vole, et les mots vont à pieds.
Le 8e jour
Libération :
 Les organisations humanitaires françaises ont déjà récolté plus de dix millions d'euros de dons pour les sinistrés du Tsunami • A quoi sert cet argent? Quels sont les urgences? Les réponses de Jacques Hintzy, président d'Unicef-France.
Les organisations humanitaires françaises ont déjà récolté plus de dix millions d'euros de dons pour les sinistrés du Tsunami • A quoi sert cet argent? Quels sont les urgences? Les réponses de Jacques Hintzy, président d'Unicef-France.
 En Asie et en Europe,des escrocs exploitent le tsunami
En Asie et en Europe,des escrocs exploitent le tsunami
Le Monde
 Des armées occidentales s'engagent dans l'opération de secours
Des armées occidentales s'engagent dans l'opération de secours
 Des répliques de forte magnitude secouent la région depuis une semaine.
Des répliques de forte magnitude secouent la région depuis une semaine.
 Plaidoyer pour des systèmes d'alerte aux raz de marée par Jean-Claude Sibuet, géophysicien à l'Ifremer, centre de Brest
Plaidoyer pour des systèmes d'alerte aux raz de marée par Jean-Claude Sibuet, géophysicien à l'Ifremer, centre de Brest
Ouest-France
 La solidarité ne doit pas se manifester seulement à l'heure des catastrophes. Elle doit conduire à instaurer des règles internationales qui aident au développement de ces pays, au lieu de dérégler l'économie des pays les plus fragiles.
La solidarité ne doit pas se manifester seulement à l'heure des catastrophes. Elle doit conduire à instaurer des règles internationales qui aident au développement de ces pays, au lieu de dérégler l'économie des pays les plus fragiles.
Solidaires, jusqu'au bout...
Courrier International :
 La province séparatiste indonésienne d'Ajteh est l'une des régions les plus touchées par la catastrophe naturelle qui a frappé l'Asie du Sud le 26 décembre. Mais malgré l'urgence humanitaire, les autorités indonésiennes semblent surtout préoccupées par des considérations politiques.
La province séparatiste indonésienne d'Ajteh est l'une des régions les plus touchées par la catastrophe naturelle qui a frappé l'Asie du Sud le 26 décembre. Mais malgré l'urgence humanitaire, les autorités indonésiennes semblent surtout préoccupées par des considérations politiques.
Malgré le désastre, Jakarta se méfie des rebelles à Atjeh
Libération :
Le Monde
Ouest-France
Solidaires, jusqu'au bout...
Courrier International :
Malgré le désastre, Jakarta se méfie des rebelles à Atjeh
La pensée vole, et les mots vont à pieds.
pablo gad a écrit :une petite pensée aussi aux 110 morts en somalie car la vague ne s'est pas arrétée comme ca ...
Flo84 a écrit :Oui, tout à l'heure j'ai entendu ça aux infos, que la vague avait touché la Somalie.
Pourquoi n'en a t-on pas bcp parlé?
En tout cas, les images ce soir au JT de france 2 étaient impressionantes (les vidéos amateurs)... ça fait froid dans le dos
Si ! "on" en a parle, certes dans une moindre mesure : environ dans une proportion de 110 / 145 000 ...
La pensée vole, et les mots vont à pieds.
La Somalie , contrairement à certains pays asiatiques , n'interessent pas les investisseurs .
Pas de tourisme , pas de richesses naturelles , climat trop chaud.......
Le gouvernement thaïlandais hier faisait des déclarations . Il va tout faire pour reconstruire au plus vite les hôtels , discothèques , etc......
L'usine à tourisme , donc . Pour le + grand bonheur des dépravés qui viennent consommer sans problème , pas cher , sans être inquiétés , des petits garçons et des petites filles !
Pendant ce temps-là , les sinistrés les plus isolés et les plus touchés crévent de faim , d'insalubrité , de douleur physique et surtout psychologique !
Seul le fric compte et le bonheur de quelques uns au détriment du plus grand nombre ! Rien de nouveau sous le soleil !
Le délire du journaliste sur les tribus isolées , hors du temps , bof !
Tout le monde s'en fout de leurs particularités et à la limite , ils sont regardés comme des animaux de cirque !
Pas de tourisme , pas de richesses naturelles , climat trop chaud.......
Le gouvernement thaïlandais hier faisait des déclarations . Il va tout faire pour reconstruire au plus vite les hôtels , discothèques , etc......
L'usine à tourisme , donc . Pour le + grand bonheur des dépravés qui viennent consommer sans problème , pas cher , sans être inquiétés , des petits garçons et des petites filles !
Pendant ce temps-là , les sinistrés les plus isolés et les plus touchés crévent de faim , d'insalubrité , de douleur physique et surtout psychologique !
Seul le fric compte et le bonheur de quelques uns au détriment du plus grand nombre ! Rien de nouveau sous le soleil !
Le délire du journaliste sur les tribus isolées , hors du temps , bof !
Tout le monde s'en fout de leurs particularités et à la limite , ils sont regardés comme des animaux de cirque !
marie-pierre