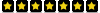Culture Générale
Modérateurs : Modérateurs, Concours IFSI
Des jonquilles contre le cancer
Publié le 19 mars 2008 - 10:02
La jonquille est devenue, il y a plus de 50 ans, le symbole universel de la lutte contre le cancer. Pour la 5ème année consécutive, le public est invité à acheter des jonquilles au profit de la lutte contre le cancer.
Cette opération, baptisée "Une jonquille pour la Vie", permettra du 20 au 30 mars d'acheter des bouquets dans les magasins participants, de cueillir des jonquilles au Panthéon de Paris, ou de fleurir des jardins virtuels sur Internet.
La jonquille est l'une des premières fleurs à apparaître au printemps et, comme le rappelle l'Institut Curie, elle doit résister contre les dernières rigueurs climatiques.
Elle est ainsi devenue, il y a plus de 50 ans, le symbole universel de la lutte contre le cancer.
Pour manifester son soutien au combat mené contre cette maladie, le public est ainsi invité à se rendre au "Jardin pour la Vie", du 21 au 23 mars, sur le parvis du Panthéon à Paris. Chaque visiteur peut cueillir une des 50.000 jonquilles qui composent ce jardin éphémère, contre un don minimum de 2 euros au profit de l'Institut Curie. Des spectacles (contes, musique...), des ateliers jardinage ainsi qu'une animation spéciale Pâques pour les enfants sont également prévus.
Par ailleurs, 51 magasins Truffaut relaieront l'opération partout en France du 20 au 30 mars. Les clients de l'enseigne spécialisée en jardinage pourront acheter un pot de bulbes de jonquilles vendu 5 euros (dont 2 euros reversés à l'Institut Curie).
Les internautes pourront également planter des jonquilles dans un jardin virtuel sur le site Jonquille.curie.fr, mais aussi laisser des messages de soutient pour les malades, les chercheurs ou les médecins.
Les quatre premières éditions de l'opération "Une jonquille pour la Vie" ont accueilli près de 120.000 visiteurs donateurs et ont permis de récolter 400.000 euros pour financer des programmes de recherche sur le cancer.
Cette année, l'événement est parrainé et soutenu par de nombreuses personnalités, comme l'acteur Bernard Giraudeau, le champion cycliste Bernard Hinault, le navigateur Michel Desjoyeaux, et les journalistes Thierry Gilardi, Gérard Holtz, Hervé Mathoux et Henri Sannier.
Site : http://jonquille.curie.fr
Source : Relaxnews
Publié le 19 mars 2008 - 10:02
La jonquille est devenue, il y a plus de 50 ans, le symbole universel de la lutte contre le cancer. Pour la 5ème année consécutive, le public est invité à acheter des jonquilles au profit de la lutte contre le cancer.
Cette opération, baptisée "Une jonquille pour la Vie", permettra du 20 au 30 mars d'acheter des bouquets dans les magasins participants, de cueillir des jonquilles au Panthéon de Paris, ou de fleurir des jardins virtuels sur Internet.
La jonquille est l'une des premières fleurs à apparaître au printemps et, comme le rappelle l'Institut Curie, elle doit résister contre les dernières rigueurs climatiques.
Elle est ainsi devenue, il y a plus de 50 ans, le symbole universel de la lutte contre le cancer.
Pour manifester son soutien au combat mené contre cette maladie, le public est ainsi invité à se rendre au "Jardin pour la Vie", du 21 au 23 mars, sur le parvis du Panthéon à Paris. Chaque visiteur peut cueillir une des 50.000 jonquilles qui composent ce jardin éphémère, contre un don minimum de 2 euros au profit de l'Institut Curie. Des spectacles (contes, musique...), des ateliers jardinage ainsi qu'une animation spéciale Pâques pour les enfants sont également prévus.
Par ailleurs, 51 magasins Truffaut relaieront l'opération partout en France du 20 au 30 mars. Les clients de l'enseigne spécialisée en jardinage pourront acheter un pot de bulbes de jonquilles vendu 5 euros (dont 2 euros reversés à l'Institut Curie).
Les internautes pourront également planter des jonquilles dans un jardin virtuel sur le site Jonquille.curie.fr, mais aussi laisser des messages de soutient pour les malades, les chercheurs ou les médecins.
Les quatre premières éditions de l'opération "Une jonquille pour la Vie" ont accueilli près de 120.000 visiteurs donateurs et ont permis de récolter 400.000 euros pour financer des programmes de recherche sur le cancer.
Cette année, l'événement est parrainé et soutenu par de nombreuses personnalités, comme l'acteur Bernard Giraudeau, le champion cycliste Bernard Hinault, le navigateur Michel Desjoyeaux, et les journalistes Thierry Gilardi, Gérard Holtz, Hervé Mathoux et Henri Sannier.
Site : http://jonquille.curie.fr
Source : Relaxnews
Courage à tous et à toutes !
dernière ligne droite, on y croit tous ! No stress que de la motivation !!!
dernière ligne droite, on y croit tous ! No stress que de la motivation !!!
Les News Santé
La lutte contre la tuberculose marque le pas
Mercredi 19 Mars 2008
Le 24 mars marque la journée mondiale contre la tuberculose. Quelques jours avant ce rendez-vous, l'Organisation mondiale de la Santé note un ralentissement de la lutte contre cette maladie, en particulier un ralentissement dans la progression du nombre de diagnostics. Cela traduit-il un essoufflement de la stratégie DOTS, méthode de lutte contre la tuberculose mise en place par l'OMS depuis 1995 ?
De 2001 à 2005, le nombre des nouveaux cas détectés a augmenté à un rythme annuel moyen de 6 %, mais de seulement la moitié, 3 %, de 2005 à 2006. Des chiffres qui témoignent d'un ralentissement des progrès pour endiguer l'épidémie qui continue de progresser. Ce serait principalement la faiblesse des programmes nationaux africains et asiatiques qui expliquerait en grande partie ce recul.
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la raison de ce ralentissement se trouve dans certains programmes nationaux qui progressaient à grand pas au cours des cinq années précédentes et qui n'ont pas pu maintenir le rythme en 2006. De plus, dans la plupart des pays africains, il n'y a pas eu d'augmentation de la détection des cas par les programmes nationaux. D'autres études ont également montré que de nombreux patients sont soignés dans le privé ou par des organisations non gouvernementales, confessionnelles ou communautaires, échappant ainsi à la détection par les programmes publics.
"Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, a estimé le Dr Magaret Chan, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Pour progresser, il faut premièrement renforcer davantage les programmes publics. Deuxièmement, nous devons tirer parti au maximum du potentiel qu'ont d'autres prestataires de service. Le diagnostic et le traitement de ceux qui en ont besoin se développeront de manière marquée en dressant la liste de ces autres prestataires et en partenariat avec les programmes nationaux."
les 5 pays les plus touchés sont dans l'ordre : l'Inde, la Chine, l'Indonésie, l'Afrique du sud et le Nigeria. Il y a eu 9,2 millions de nouveaux cas de tuberculose en 2006, dont 700 000 chez des personnes vivant avec le VIH et 500 000 cas de tuberculose à bacilles multirésistants (tuberculose-MR). On estime que la tuberculose a tué 1,5 million de personnes en 2006, auxquelles s'ajoutent 200 000 séropositifs pour le VIH morts de la co-infection.
Compte tenu des moyens limités des laboratoires et des services de traitement, les projections des pays indiquent qu'à l'échelle mondiale, seuls 10 % des cas de tuberculose multirésistante pourront être traités en 2008. "La tuberculose est la première cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH/sida, a rappelé le Dr Jorge Sampaio, ancien Président du Portugal et Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'initiative Halte à la tuberculose. Plusieurs pays ont montré qu'on pouvait atteindre les cibles fixées pour la co-infection tuberculose-VIH et ont pris des mesures qui auront des effets pour ceux qui sont les plus exposés. Mais c'est une bataille sans relâche : nous devons agir bien mieux et bien davantage."
Source : Communiqué de l'OMS - mars 2008
La lutte contre la tuberculose marque le pas
Mercredi 19 Mars 2008
Le 24 mars marque la journée mondiale contre la tuberculose. Quelques jours avant ce rendez-vous, l'Organisation mondiale de la Santé note un ralentissement de la lutte contre cette maladie, en particulier un ralentissement dans la progression du nombre de diagnostics. Cela traduit-il un essoufflement de la stratégie DOTS, méthode de lutte contre la tuberculose mise en place par l'OMS depuis 1995 ?
De 2001 à 2005, le nombre des nouveaux cas détectés a augmenté à un rythme annuel moyen de 6 %, mais de seulement la moitié, 3 %, de 2005 à 2006. Des chiffres qui témoignent d'un ralentissement des progrès pour endiguer l'épidémie qui continue de progresser. Ce serait principalement la faiblesse des programmes nationaux africains et asiatiques qui expliquerait en grande partie ce recul.
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la raison de ce ralentissement se trouve dans certains programmes nationaux qui progressaient à grand pas au cours des cinq années précédentes et qui n'ont pas pu maintenir le rythme en 2006. De plus, dans la plupart des pays africains, il n'y a pas eu d'augmentation de la détection des cas par les programmes nationaux. D'autres études ont également montré que de nombreux patients sont soignés dans le privé ou par des organisations non gouvernementales, confessionnelles ou communautaires, échappant ainsi à la détection par les programmes publics.
"Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, a estimé le Dr Magaret Chan, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Pour progresser, il faut premièrement renforcer davantage les programmes publics. Deuxièmement, nous devons tirer parti au maximum du potentiel qu'ont d'autres prestataires de service. Le diagnostic et le traitement de ceux qui en ont besoin se développeront de manière marquée en dressant la liste de ces autres prestataires et en partenariat avec les programmes nationaux."
les 5 pays les plus touchés sont dans l'ordre : l'Inde, la Chine, l'Indonésie, l'Afrique du sud et le Nigeria. Il y a eu 9,2 millions de nouveaux cas de tuberculose en 2006, dont 700 000 chez des personnes vivant avec le VIH et 500 000 cas de tuberculose à bacilles multirésistants (tuberculose-MR). On estime que la tuberculose a tué 1,5 million de personnes en 2006, auxquelles s'ajoutent 200 000 séropositifs pour le VIH morts de la co-infection.
Compte tenu des moyens limités des laboratoires et des services de traitement, les projections des pays indiquent qu'à l'échelle mondiale, seuls 10 % des cas de tuberculose multirésistante pourront être traités en 2008. "La tuberculose est la première cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH/sida, a rappelé le Dr Jorge Sampaio, ancien Président du Portugal et Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'initiative Halte à la tuberculose. Plusieurs pays ont montré qu'on pouvait atteindre les cibles fixées pour la co-infection tuberculose-VIH et ont pris des mesures qui auront des effets pour ceux qui sont les plus exposés. Mais c'est une bataille sans relâche : nous devons agir bien mieux et bien davantage."
Source : Communiqué de l'OMS - mars 2008
Courage à tous et à toutes !
dernière ligne droite, on y croit tous ! No stress que de la motivation !!!
dernière ligne droite, on y croit tous ! No stress que de la motivation !!!
Chantal Sébire a été retrouvée morte à son domicile
Chantal Sébire, la femme âgée de 52 ans qui souffrait d'une tumeur incurable et avait sollicité le droit de recourir à l'euthanasie active, a été retrouvée morte chez elle, mercredi 19 mars en fin d'après-midi, selon le ministère de l'intérieur. Son corps sans vie a été trouvé en fin d'après-midi à son domicile de Plombières-lès-Dijon (Côte-d'Or).
Le procureur de la République de Dijon, Jean-Pierre Allachi, a déclaré, jeudi matin, que les autorités ne disposaient pas "d'éléments suffisants" pour déterminer les causes de la mort. La veille au soir, après une visite sur place, il avait indiqué que les causes de la mort demeuraient inconnues et que des prélèvements et des analyses allaient être effectués. Avant d'ajouter : "Nous en saurons plus demain" (jeudi). Le magistrat avait précisé que le décès avait été "constaté à 19 h 30".
Mme Sébire, mère de trois enfants, souffrait d'un esthésioneuroblastome, une tumeur évolutive des sinus et de la cloison nasale, qui lui déformait cruellement le visage et la faisait atrocement souffrir. Cette maladie rarissime et incurable, au très mauvais pronostic vital, lui avait fait perdre la vue il y a quelques mois, après le goût et l'odorat.
SA DEMANDE D'EUTHANASIE ACTIVE REJETÉE
La tumeur prenant des "proportions insupportables", sans rémission possible, Mme Sébire avait écrit, le 6 mars, au président de la République, Nicolas Sarkozy, pour lui réclamer le droit de mourir. Assistée de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), elle avait déposé une requête exceptionnelle devant le président du tribunal de grande instance de Dijon. Mais la justice avait rejeté sa demande d'euthanasie active lundi 17 mars.
Face à loi sur la fin de vie du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, qui tend à instaurer un droit au "laisser mourir" sans permettre aux médecins de pratiquer une euthanasie active, Mme Sébire opposait des "souffrances intenses et permanentes", le "caractère incurable des maux dont elle est atteinte" depuis huit ans, et son "refus de devoir supporter l'irréversible dégradation de son état".
Nicolas Sarkozy avait reçu mercredi après-midi à l'Elysée le Dr Emmanuel Debost, le médecin traitant de Mme Sébire, en présence du professeur Arnold Munnich, conseiller du président, et du professeur Daniel Brasnu, chef du service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital européen Georges-Pompidou, spécialiste de la maladie dont elle souffrait. Après avoir reçu un courrier de la malade, Nicolas Sarkozy avait demandé au Pr Munnich qu'un "nouvel avis" soit donné "par un collège de professionnels de la santé du plus haut niveau" sur son cas.
Matignon a par ailleurs demandé mercredi à Jean Leonetti, rapporteur de la loi de 2005 instaurant un droit au "laisser mourir" mais pas à l'euthanasie active, une mission d'évaluation pour remédier éventuellement à "l'insuffisance de la législation".
ps: Hamlet, pour le nombre de cas, je ne sais plus quoi penser, je vais chercher mais bon au pire n'étant pas sûre, je ne dirai rien dessus.
Chantal Sébire, la femme âgée de 52 ans qui souffrait d'une tumeur incurable et avait sollicité le droit de recourir à l'euthanasie active, a été retrouvée morte chez elle, mercredi 19 mars en fin d'après-midi, selon le ministère de l'intérieur. Son corps sans vie a été trouvé en fin d'après-midi à son domicile de Plombières-lès-Dijon (Côte-d'Or).
Le procureur de la République de Dijon, Jean-Pierre Allachi, a déclaré, jeudi matin, que les autorités ne disposaient pas "d'éléments suffisants" pour déterminer les causes de la mort. La veille au soir, après une visite sur place, il avait indiqué que les causes de la mort demeuraient inconnues et que des prélèvements et des analyses allaient être effectués. Avant d'ajouter : "Nous en saurons plus demain" (jeudi). Le magistrat avait précisé que le décès avait été "constaté à 19 h 30".
Mme Sébire, mère de trois enfants, souffrait d'un esthésioneuroblastome, une tumeur évolutive des sinus et de la cloison nasale, qui lui déformait cruellement le visage et la faisait atrocement souffrir. Cette maladie rarissime et incurable, au très mauvais pronostic vital, lui avait fait perdre la vue il y a quelques mois, après le goût et l'odorat.
SA DEMANDE D'EUTHANASIE ACTIVE REJETÉE
La tumeur prenant des "proportions insupportables", sans rémission possible, Mme Sébire avait écrit, le 6 mars, au président de la République, Nicolas Sarkozy, pour lui réclamer le droit de mourir. Assistée de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), elle avait déposé une requête exceptionnelle devant le président du tribunal de grande instance de Dijon. Mais la justice avait rejeté sa demande d'euthanasie active lundi 17 mars.
Face à loi sur la fin de vie du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, qui tend à instaurer un droit au "laisser mourir" sans permettre aux médecins de pratiquer une euthanasie active, Mme Sébire opposait des "souffrances intenses et permanentes", le "caractère incurable des maux dont elle est atteinte" depuis huit ans, et son "refus de devoir supporter l'irréversible dégradation de son état".
Nicolas Sarkozy avait reçu mercredi après-midi à l'Elysée le Dr Emmanuel Debost, le médecin traitant de Mme Sébire, en présence du professeur Arnold Munnich, conseiller du président, et du professeur Daniel Brasnu, chef du service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital européen Georges-Pompidou, spécialiste de la maladie dont elle souffrait. Après avoir reçu un courrier de la malade, Nicolas Sarkozy avait demandé au Pr Munnich qu'un "nouvel avis" soit donné "par un collège de professionnels de la santé du plus haut niveau" sur son cas.
Matignon a par ailleurs demandé mercredi à Jean Leonetti, rapporteur de la loi de 2005 instaurant un droit au "laisser mourir" mais pas à l'euthanasie active, une mission d'évaluation pour remédier éventuellement à "l'insuffisance de la législation".
ps: Hamlet, pour le nombre de cas, je ne sais plus quoi penser, je vais chercher mais bon au pire n'étant pas sûre, je ne dirai rien dessus.
IDE depuis le 31 mai 2012 ! 
Cancer : davantage de cas mais plus d'espérance de vie
LE MONDE POUR DIRECTMATINPLUS | 20.03.08 | 07h37 • Mis à jour le 20.03.08 | 07h37
Le temps n'est plus où l'on ignorait tout ou presque, en France, des chiffres du cancer. Alors que va être organisée la deuxième semaine nationale sur le cancer colorectal et que l'Institut Curie de Paris donne le coup d'envoi, aujourd'hui, de son opération caritative "Une jonquille pour la vie", l'Institut national de veille sanitaire (INVS) vient de publier les dernières statistiques dans ce domaine. Si le nombre de cas de cancers a considérablement augmenté en 25 ans, en France, il en va de même de l'espérance de vie des personnes concernées.
En 2005, le nombre de nouveaux cas de cancer, selon l'INVS, a été estimé à près de 320 000 dont 180 000 chez les hommes et 140 000 chez les femmes. Les trois localisations les plus fréquentes chez l'homme sont la prostate (62 000), le poumon (24 000) et le côlon (20 000). Chez la femme, il s'agit respectivement du sein (50 000), du côlon (17 000) et du poumon (7 000). Or, en 1980, le nombre total des cancers s'élevait à 170 000. En d'autres termes ce nombre a presque doublé chez l'homme (augmentation de 93 %) et a progressé de 84 % chez la femme.
Comment comprendre? Pour les spécialistes de l'INVS, il faut prendre en compte les importantes modifications démographiques. Ils estiment, schématiquement, qu'en un quart de siècle, 25 % de l'augmentation du nombre de cas est la conséquence directe de l'augmentation de la population et pour 20 % celle de son vieillissement, le risque de cancer augmentant avec l'âge. Ainsi, on est plus exposé au risque d'être atteint d'un cancer, aujourd'hui qu'en 1980, mais cette augmentation du risque doit être replacée dans un contexte plus général. Elle correspond approximativement à la moitié des cas diagnostiqués.
S'intéresser à l'épidémiologie des cancers, c'est aussi analyser les chiffres de la mortalité qui leur sont associés. En 2005, le nombre de décès par cancer a été estimé à 146 000, soit une augmentation de 13% depuis 1980. "Cette augmentation du nombre de décès par cancer n'est liée qu'aux changements démographiques, explique-t-on auprès de l'INVS. En réalité, le risque de mortalité par cancer a, en fait, diminué entre ces deux années. Cette diminution du taux de mortalité est en moyenne de - 1,1 % par an chez l'homme et -0,9 % chez la femme. Elle est encore plus marquée ces 5 dernières années avec respectivement - 2,5 % et - 1,2 %." Pour Guy Launois, responsable du réseau des registres français du cancer, c'est la première fois qu'on observe une telle diminution de la mortalité.
Ce phénomène, quelque peu paradoxal (augmentation de l'incidence et baisse de la mortalité), a une explication. On observe depuis plusieurs années une baisse du nombre des cancers les plus agressifs (de l'oesophage, de l'estomac et des voies aérodigestives supérieures) et une augmentation des cancers qui peuvent plus aisément être traités. C'est ainsi que la moitié des cas supplémentaires chez la femme concerne le cancer du sein, cette proportion étant de 70 %, chez l'homme, pour le cancer de la prostate. Force est aussi de constater que ces deux lésions cancéreuses ont fait l'objet d'un dépistage croissant . Conséquence, leur nombre augmente mais on en guérit plus fréquemment.
Selon une récente étude réalisée par la Caisse nationale d'assurance maladie, alors qu'il ne cessait d'augmenter dans des proportions inquiétantes depuis une trentaine d'années, le nombre de cas de cancer du sein est en diminution depuis 2005. Pour l'heure, la seule explication rationnelle semble résider dans la désaffection massive des femmes vis-à-vis des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. "Les Français fument moins, boivent moins : la prévention, ça marche", assure le professeur Dominique Maraninchi, président de l'Institut national du cancer.
Pour autant une question reste entière : à quoi attribuer, au delà de l'efficacité des campagnes de dépistage et des évolutions démographiques, l'augmentation relative du nombre des cancers en un quart de siècle? Les spécialistes estiment que les modifications de l'environnement (ainsi que de l'alimentation) constituent une hypothèse qui peut être retenue. C'est notamment le cas de l'exposition à l'amiante. Mais d'une manière générale, les liens de causalité sont encore loin d'être scientifiquement établis. Des efforts constants de recherche permettront peut-être de conclure et de prendre les mesures sanitaires qui, alors, s'imposeront.
Jean-Yves Nau
LE MONDE POUR DIRECTMATINPLUS | 20.03.08 | 07h37 • Mis à jour le 20.03.08 | 07h37
Le temps n'est plus où l'on ignorait tout ou presque, en France, des chiffres du cancer. Alors que va être organisée la deuxième semaine nationale sur le cancer colorectal et que l'Institut Curie de Paris donne le coup d'envoi, aujourd'hui, de son opération caritative "Une jonquille pour la vie", l'Institut national de veille sanitaire (INVS) vient de publier les dernières statistiques dans ce domaine. Si le nombre de cas de cancers a considérablement augmenté en 25 ans, en France, il en va de même de l'espérance de vie des personnes concernées.
En 2005, le nombre de nouveaux cas de cancer, selon l'INVS, a été estimé à près de 320 000 dont 180 000 chez les hommes et 140 000 chez les femmes. Les trois localisations les plus fréquentes chez l'homme sont la prostate (62 000), le poumon (24 000) et le côlon (20 000). Chez la femme, il s'agit respectivement du sein (50 000), du côlon (17 000) et du poumon (7 000). Or, en 1980, le nombre total des cancers s'élevait à 170 000. En d'autres termes ce nombre a presque doublé chez l'homme (augmentation de 93 %) et a progressé de 84 % chez la femme.
Comment comprendre? Pour les spécialistes de l'INVS, il faut prendre en compte les importantes modifications démographiques. Ils estiment, schématiquement, qu'en un quart de siècle, 25 % de l'augmentation du nombre de cas est la conséquence directe de l'augmentation de la population et pour 20 % celle de son vieillissement, le risque de cancer augmentant avec l'âge. Ainsi, on est plus exposé au risque d'être atteint d'un cancer, aujourd'hui qu'en 1980, mais cette augmentation du risque doit être replacée dans un contexte plus général. Elle correspond approximativement à la moitié des cas diagnostiqués.
S'intéresser à l'épidémiologie des cancers, c'est aussi analyser les chiffres de la mortalité qui leur sont associés. En 2005, le nombre de décès par cancer a été estimé à 146 000, soit une augmentation de 13% depuis 1980. "Cette augmentation du nombre de décès par cancer n'est liée qu'aux changements démographiques, explique-t-on auprès de l'INVS. En réalité, le risque de mortalité par cancer a, en fait, diminué entre ces deux années. Cette diminution du taux de mortalité est en moyenne de - 1,1 % par an chez l'homme et -0,9 % chez la femme. Elle est encore plus marquée ces 5 dernières années avec respectivement - 2,5 % et - 1,2 %." Pour Guy Launois, responsable du réseau des registres français du cancer, c'est la première fois qu'on observe une telle diminution de la mortalité.
Ce phénomène, quelque peu paradoxal (augmentation de l'incidence et baisse de la mortalité), a une explication. On observe depuis plusieurs années une baisse du nombre des cancers les plus agressifs (de l'oesophage, de l'estomac et des voies aérodigestives supérieures) et une augmentation des cancers qui peuvent plus aisément être traités. C'est ainsi que la moitié des cas supplémentaires chez la femme concerne le cancer du sein, cette proportion étant de 70 %, chez l'homme, pour le cancer de la prostate. Force est aussi de constater que ces deux lésions cancéreuses ont fait l'objet d'un dépistage croissant . Conséquence, leur nombre augmente mais on en guérit plus fréquemment.
Selon une récente étude réalisée par la Caisse nationale d'assurance maladie, alors qu'il ne cessait d'augmenter dans des proportions inquiétantes depuis une trentaine d'années, le nombre de cas de cancer du sein est en diminution depuis 2005. Pour l'heure, la seule explication rationnelle semble résider dans la désaffection massive des femmes vis-à-vis des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. "Les Français fument moins, boivent moins : la prévention, ça marche", assure le professeur Dominique Maraninchi, président de l'Institut national du cancer.
Pour autant une question reste entière : à quoi attribuer, au delà de l'efficacité des campagnes de dépistage et des évolutions démographiques, l'augmentation relative du nombre des cancers en un quart de siècle? Les spécialistes estiment que les modifications de l'environnement (ainsi que de l'alimentation) constituent une hypothèse qui peut être retenue. C'est notamment le cas de l'exposition à l'amiante. Mais d'une manière générale, les liens de causalité sont encore loin d'être scientifiquement établis. Des efforts constants de recherche permettront peut-être de conclure et de prendre les mesures sanitaires qui, alors, s'imposeront.
Jean-Yves Nau
IDE depuis le 31 mai 2012 ! 
La Guyane ne parvient pas à faire face au virus du sida
LE MONDE | 17.03.08 | 14h58 • Mis à jour le 17.03.08 | 14h58
Dans un rapport intitulé "L'épidémie d'infection à VIH en Guyane : un problème politique" et rendu public lundi 17 mars, le Conseil national du sida (CNS) estime que le département est en "situation d'épidémie généralisée : plus de 1 % des femmes enceintes sont infectées par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine), situation similaire à celle de certains pays d'Afrique". La Guyane connaît le taux de prévalence le plus élevé de France. En 2006, le taux par million d'habitants de découverte de l'infection à VIH y était de 308 contre 150 en Ile-de-France.
Après ceux de 1996 et de 2003, c'est le troisième rapport que le CNS consacre à la lutte contre l'épidémie d'infection à VIH en Guyane. Celui de 2003 s'alarmait d'une "épidémie active et incontrôlée face à laquelle aucune réponse structurée et adaptée n'était apportée". Dans son nouveau rapport, le CNS considère la situation "inacceptable du point de vue des objectifs de santé tant nationaux qu'internationaux de la France". Pour lui, "la stigmatisation et la discrimination dont font toujours l'objet les personnes vivant avec le VIH constituent des barrières au dépistage, à la prévention et à la prise en charge".
Le CNS rappelle que la région Caraïbe est "la seconde région au monde la plus touchée après l'Afrique par l'épidémie d'infection à VIH". La Guyane y constitue "un relatif îlot de richesse au milieu de pays pauvres ou frontaliers de zones pauvres de pays émergents". De ce fait, elle "connaît un profil épidémique conforme à la situation régionale, amplifié par l'importance des migrations économiques vers le département, qui concernent par définition des populations précaires, originaires de pays à forte prévalence".
La Guyane possède une population "hétérogène", "vivant dans des zones bien identifiées du département", indique le rapport. Cela "contribue au fractionnement de l'espace public et politique" et participe à des "pesanteurs", dont le Conseil national du sida juge qu'elles "ne doivent pas pour autant justifier la retenue des responsables locaux et nationaux dans les stratégies et moyens déployés contre l'épidémie".
Découverte trop tardive de l'infection par le virus du sida, sous-encadrement médical, démographie médicale vieillissante, précarité des conditions de vie de beaucoup des personnes en charge sont quelques-uns des facteurs qui affaiblissent la lutte contre l'épidémie. Auxquels s'ajoute "la politique de lutte contre les migrations illégales (qui) ne favorise pas un accès aisé aux soins et façonne trop souvent l'approche de l'épidémie au détriment des considérations de santé publique", selon le CNS.
Celui-ci invite à oeuvrer selon trois axes : développer "une action politique résolue à la hauteur des enjeux", mettre en place "un pilotage concerté de la lutte contre l'épidémie" et "améliorer la réponse en santé publique". Pour le CNS, "le ministre chargé de l'outre-mer doit, avec le ministre chargé de la santé, porter ces changements à l'heure où une nouvelle loi de programme pour l'outre-mer est en préparation".
Paul Benkimoun
LE MONDE | 17.03.08 | 14h58 • Mis à jour le 17.03.08 | 14h58
Dans un rapport intitulé "L'épidémie d'infection à VIH en Guyane : un problème politique" et rendu public lundi 17 mars, le Conseil national du sida (CNS) estime que le département est en "situation d'épidémie généralisée : plus de 1 % des femmes enceintes sont infectées par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine), situation similaire à celle de certains pays d'Afrique". La Guyane connaît le taux de prévalence le plus élevé de France. En 2006, le taux par million d'habitants de découverte de l'infection à VIH y était de 308 contre 150 en Ile-de-France.
Après ceux de 1996 et de 2003, c'est le troisième rapport que le CNS consacre à la lutte contre l'épidémie d'infection à VIH en Guyane. Celui de 2003 s'alarmait d'une "épidémie active et incontrôlée face à laquelle aucune réponse structurée et adaptée n'était apportée". Dans son nouveau rapport, le CNS considère la situation "inacceptable du point de vue des objectifs de santé tant nationaux qu'internationaux de la France". Pour lui, "la stigmatisation et la discrimination dont font toujours l'objet les personnes vivant avec le VIH constituent des barrières au dépistage, à la prévention et à la prise en charge".
Le CNS rappelle que la région Caraïbe est "la seconde région au monde la plus touchée après l'Afrique par l'épidémie d'infection à VIH". La Guyane y constitue "un relatif îlot de richesse au milieu de pays pauvres ou frontaliers de zones pauvres de pays émergents". De ce fait, elle "connaît un profil épidémique conforme à la situation régionale, amplifié par l'importance des migrations économiques vers le département, qui concernent par définition des populations précaires, originaires de pays à forte prévalence".
La Guyane possède une population "hétérogène", "vivant dans des zones bien identifiées du département", indique le rapport. Cela "contribue au fractionnement de l'espace public et politique" et participe à des "pesanteurs", dont le Conseil national du sida juge qu'elles "ne doivent pas pour autant justifier la retenue des responsables locaux et nationaux dans les stratégies et moyens déployés contre l'épidémie".
Découverte trop tardive de l'infection par le virus du sida, sous-encadrement médical, démographie médicale vieillissante, précarité des conditions de vie de beaucoup des personnes en charge sont quelques-uns des facteurs qui affaiblissent la lutte contre l'épidémie. Auxquels s'ajoute "la politique de lutte contre les migrations illégales (qui) ne favorise pas un accès aisé aux soins et façonne trop souvent l'approche de l'épidémie au détriment des considérations de santé publique", selon le CNS.
Celui-ci invite à oeuvrer selon trois axes : développer "une action politique résolue à la hauteur des enjeux", mettre en place "un pilotage concerté de la lutte contre l'épidémie" et "améliorer la réponse en santé publique". Pour le CNS, "le ministre chargé de l'outre-mer doit, avec le ministre chargé de la santé, porter ces changements à l'heure où une nouvelle loi de programme pour l'outre-mer est en préparation".
Paul Benkimoun
IDE depuis le 31 mai 2012 ! 
OGM : le Conseil d'Etat maintient l'interdiction
NOUVELOBS.COM | 19.03.2008 | 18:15
Le juge a rejeté le recours de plusieurs producteurs qui réclamaient la suspension de l'arrêté interdisant la culture du maïs OGM. L'institution doit encore se prononcer sur le "fond" du dossier.
Le Conseil d'Etat a rejeté, mercredi 19 mars, le recours de plusieurs producteurs qui réclamaient la suspension de l'arrêté d'interdiction de la culture du maïs OGM en 2008. Cette décision confirme celle du gouvernement, a annoncé une porte-parole de l'institution.
"Le juge a rejeté le recours. Pour lui, il n'y a pas de doutes sérieux sur la légalité des arrêtés (d'interdiction, ndlr) des 7 et 13 février", a indiqué la porte-parole.
Cependant, la décision du Conseil n'est pas définitive, puisque l'institution devra encore se prononcer sur le "fond" du dossier, à une date qui reste à fixer.
Monsanto parmi les plaignants
Des semenciers et producteurs de maïs avaient déposé le 20 février des recours au Conseil d'Etat contre les arrêtés d'interdiction.
Parmi les neuf plaignants figurent l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM), le groupe agrochimique Monsanto, le semencier Pioneer ainsi que la coopérative Limagrain et le syndicat des établissements de semences de maïs (Seproma).
Les producteurs et semenciers mettent en avant les préjudices financiers causés par une suspension alors que le gouvernement évoque les risques de dissémination, ainsi que des "effets" sur la flore et la faune.
NOUVELOBS.COM | 19.03.2008 | 18:15
Le juge a rejeté le recours de plusieurs producteurs qui réclamaient la suspension de l'arrêté interdisant la culture du maïs OGM. L'institution doit encore se prononcer sur le "fond" du dossier.
Le Conseil d'Etat a rejeté, mercredi 19 mars, le recours de plusieurs producteurs qui réclamaient la suspension de l'arrêté d'interdiction de la culture du maïs OGM en 2008. Cette décision confirme celle du gouvernement, a annoncé une porte-parole de l'institution.
"Le juge a rejeté le recours. Pour lui, il n'y a pas de doutes sérieux sur la légalité des arrêtés (d'interdiction, ndlr) des 7 et 13 février", a indiqué la porte-parole.
Cependant, la décision du Conseil n'est pas définitive, puisque l'institution devra encore se prononcer sur le "fond" du dossier, à une date qui reste à fixer.
Monsanto parmi les plaignants
Des semenciers et producteurs de maïs avaient déposé le 20 février des recours au Conseil d'Etat contre les arrêtés d'interdiction.
Parmi les neuf plaignants figurent l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM), le groupe agrochimique Monsanto, le semencier Pioneer ainsi que la coopérative Limagrain et le syndicat des établissements de semences de maïs (Seproma).
Les producteurs et semenciers mettent en avant les préjudices financiers causés par une suspension alors que le gouvernement évoque les risques de dissémination, ainsi que des "effets" sur la flore et la faune.
IDE depuis le 31 mai 2012 ! 
MORT DE CHANTAL SEBIRE
Mort de Chantal Sébire : les réactions
NOUVELOBS.COM | 20.03.2008 | 11:20
Voici les principales réactions après l'annonce, mercredi 19 mars, de la mort de Chantal Sébire, une mère de famille de 52 ans atteinte d'une tumeur incurable, qui avait en vain sollicité auprès de la justice le droit de recourir à l'euthanasie.
Me Gilles Antonowicz, avocat de Chantal Sébire : "S'ils font l'autopsie c'est honteux. Si Mme Sébire s'était jetée dans le canal tout proche de son appartement il n'y aurait pas eu d'enquête et là ils feraient une autopsie comme ils l'ont faite pour le fils de Marie Humbert" qui avait aidé son fils tétraplégique à mourir en 2003. Chantal Sébire qu'il a "rencontrée à deux reprises et (qu'il a) eue cinq ou six fois au téléphone restera un souvenir très fort". "Je garde un de ses messages téléphoniques en mémoire et je l'écoute tous les jours" (Déclaration à l'AFP, jeudi 20 mars)
Marie Humbert, qui avait bénéficié d'un non-lieu après avoir aidé avec un médecin son fils Vincent tétraplégique à mourir en 2003, marraine de l'association "Faut qu'on s'active": "Elle n'a pas voulu me dire quand, mais je suis persuadée qu'elle s'est suicidée. Ça me met en colère vraiment, car elle espérait vraiment que le juge lui accorderait le droit de mourir" (Déclaration sur LCI, jeudi 20 mars)
- "Je me sens bouleversée. Elle a dû partir toute seule en cachette. Je trouve ça vraiment moche. C'est le gouvernement qui n'a pas su écouter. Au téléphone, elle me disait qu'elle n'en pouvait plus. Qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle n'avait même plus la force d'aller en Suisse. Je lui disais de ne pas faire de bêtise parce qu'elle me disait qu'elle allait se jeter par la fenêtre"."Elle a été obligée de faire ça toute seule et c'est triste, vraiment. Il y a deux mois, on aurait pu l'aider, sans en arriver là, où elle a dû partir toute seule en cachette, et je trouve ça vraiment moche. Tous les Français ont entendu son message, c'est le gouvernement qui n'a pas su entendre" (Déclaration sur Europe 1, jeudi 20 mars)
- "Pour elle maintenant, elle est mieux où elle est, c'est un fait. Mais il faut absolument que les choses changent parce que ce n'est plus possible". "Tout le monde commence à dire: 'Oui c'est vrai, la loi ne va peut-être pas assez loin, il faudra peut-être qu'on fasse ci, il faudra peut-être qu'on fasse ça', et puis en attendant, des choses horribles comme ça se produisent" (Déclaration sur RTL, jeudi 10 mars)
Luc Chatel, porte-parole du gouvernement : "Je voudrais avoir une pensée pour Chantal Sébire, pour sa famille, ses proches. Sa maladie a bouleversé les Français ces derniers jours". "C'est un cas qui inspire un grand respect de la part de nos concitoyens". Soulignant que la loi votée en 2005 à l'unanimité et instaurant un droit au "laisser mourir" mais pas à l'euthanasie active "a été une énorme avancée" qui "permet aujourd'hui de traiter 90% ou 99% des cas", il a rappelé que le Premier ministre François Fillon avait chargé Jean Leonetti (UMP) d'une mission d'évaluation de ce texte. Ce serait "précisément à Jean Leonetti de dire si aujourd'hui il y a une volonté d'aller plus loin que la loi de 2005". "Il faut bien sûr prendre en compte les cas qui sont les plus douloureux comme celui de Chantal Sébire". "Il faut à la fois aller vite, parce qu'il y a régulièrement des cas exceptionnels comme celui de Chantal Sébire, et en même temps il ne faut pas légiférer dans l'urgence", indiquant que Jean Leonetti allait "avoir plusieurs semaines" pour faire son travail. (Déclaration sur LCI, jeudi 20 mars)
Nadine Morano, nouvelle secrétaire d'Etat à la Famille : "Il nous faut d'abord évaluer la loi actuelle qui répond à 99% des cas" mais "est insuffisamment connue". "Sur le 1% de cas d'exception, j'avais proposé à l'époque de créer une commission nationale d'exception d'euthanasie à qui reviendrait le soin d'examiner ces cas particuliers graves". Je suis toujours "favorable à titre personnel" et s'en "être entretenu avec le Premier ministre" François Fillon. "Il nous faut réfléchir à la question". "Le débat est mûr mais c'est un sujet grave, difficile qui ne doit pas être pas traité dans le cadre d'une émotion forte, comme celui de Madame Sébire". "Il y a des gens qui réclament la mort à un moment et qui après avoir reçu des soins palliatifs ne la réclament plus" (Déclaration sur France Info, jeudi 20 mars)
Bernard Accoyer, président UMP de l'Assemblée nationale : "Je crois qu'il ne faut jamais légiférer dans la précipitation, dans la pression passionnelle, même si celle-ci est particulièrement douloureuse et émouvante". "Comme président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'il faut aller plus loin". "Je pense que plus que d'autres, ce problème extrêmement grave doit être examiné avec recul, avec mesure et ne doit pas être traité avec précipitation sous la pression de ceux qui militent pour l'euthanasie active" (Déclaration sur Radio Classique, jeudi 20 mars)
Jean-Claude Ameisen, professeur membre du Comité national d'éthique : "Dans des situations exceptionnelles, où tout a été fait, faut-il que le législateur envisage une formule d'exception". Cette formule d'exception, autorisant le suicide médicalement assisté ne pourrait intervenir que "comme un constat d'échec à tout ce qui a été tenté", comme "une sorte de transgression" de la loi. Le Comité national d'éthique dans un avis en 2000 envisageait "l'exception de l'assistance au suicide, sans demander de l'inscrire dans la loi". Cette "exception" ne pourrait être "considérée qu'au cas par cas", par une commission multidisciplinaire, et "ne serait possible que si l'accès au soin palliatif est devenu universel". En effet la loi de 2005 sur la fin de vie "qui a été un grand progrès" est encore très loin d'être parfaitement appliquée et "la moitié des personnes qui meurent à l'hôpital ou en institution n'ont pas accès à un accompagnement et à des soins palliatifs" (Déclaration sur LCP, mercredi 19 mars)
Jean-Luc Romero, le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD): "Même si c'était le souhait (de mourir) de Chantal, j'ai beaucoup de tristesse car c'(était) une femme d'exception, avec un caractère exceptionnel, une grande force, une volonté et une voix pour un combat formidable: celui de la fin de vie dans la dignité" (Déclaration à l'AFP, mercredi 19 mars)
- "Je suis triste parce que je l'ai rencontrée à plusieurs reprises et c'était une femme exceptionnelle, d'une grande intelligence. En dépit de son apparence, c'était une femme très belle, qui a mené un combat jusqu'au bout". "Nous ne l'avons pas aidée. Je ne sais pas si elle est décédée naturellement. Je ne connais pas les circonstances de sa mort. Ce qui est sûr, c'est qu'elle souffrait énormément et je pèse mes mots". "Je trouve dramatique qu'il faille que des personnes comme Marie Humbert pour son fils, Maïa Simon, la comédienne et Chantal Sébire doivent prendre la parole pour faire bouger les politiques. Tout le monde sait qu'en France, il y a entre 10.000 et 15.000 euthanasies clandestines pour mettre fin à des vies terribles" (Déclaration au Parisien, jeudi 20 mars)
Jean Léonetti, rapporteur de la loi sur la fin de vie: "Dans la mission qu'il me confie, le Premier ministre me demande plusieurs choses. Si la loi n'est pas bien comprise, faites de la pédagogie. Si la loi n'est pas bien appliquée, donnons-lui les moyens de la faire appliquer. Si elle est insuffisamment appliquée, donnons-lui la possibilité de s'accomplir. Deux rapports indiquent que les textes actuels restent méconnus". "Dans les pays comme les Pys-Bas, où l'euthanasie est légalisée, je constate que leur nombre est en bausse. Car on leur préfère d'autres solutions comme la sédation terminale" (Déclaration au Parisien, jeudi 20 mars)
- "Chantal Sébire n'a pas demandé à la loi de s'appliquer. La loi aurait pu soulager ses souffrances même au prix de raccourcir sa vie". "Son choix était une demande de suicide". "Je ne sais pas dans quelles circonstances Chantal Sébire est morte. On peut quand même imaginer que, peut-être, elle a mis fin à ses jours. C'est une liberté qui est respectable" (Déclaration sur RTL, jeudi 20 mars)
Gaétan Gorce, député socialiste de la Nièvre : "ce qui a été terrible dans le cas de Chantal Sébire, c'est qu'il n'y avait pas d'issue directe pour elle, pour répondre à une demande qui était digne et formulée de manière responsable, pour laquelle aucune réponse institutionnelle n'était possible, c'est cela qu'il faut changer". Pour "sortir de l'hypocrisie", je suis "pour la création d'une haute autorité morale qui pourrait être saisie de ces situations et pourrait donner a priori son sentiment sur l'issue à proposer" (Déclaration sur RTL, jeudi 20 mars)
Les déclarations avant la mort de Chantal Sébire
Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères : "Je trouve très difficile de ne pas lui offrir une porte de sortie qui serait une porte d'amour avec les siens". Il faut "lui permettre de ne pas avoir besoin de se suicider dans une espèce de clandestinité dont tout le monde souffrirait, surtout ses proches". Je me suis "battu pour qu'on ait le droit de mourir dans la dignité". "J'ai beaucoup d'admiration et d'amour pour Chantal Sébire". Il faut faire "une exception à la loi" qui l'empêche d'accéder à l'euthanasie. "Ce serait humain, nécessaire" (Déclaration sur RMC et BFM-TV, mercredi 19 mars)
Jean-Claude Ameisen, professeur membre du Comité national d'éthique :
"Lorsque l'accompagnement, que tout ce qu'on peut proposer ne permet pas à la personne de considérer que sa souffrance est soulagée, il faut poser la question de savoir si on peut aller plus loin". "Est-ce que la loi envisage tous les cas les plus extrêmes ou est-ce que la loi s'arrête et qu'il faut essayer d'envisager l'exception, un pas plus loin". "Je pense qu'il faut dissocier le cas dramatique de Mme Sébire de ce que serait le fait de réviser une loi". "On a trop tendance en France à légiférer rapidement sur le fait d'événements dramatiques particuliers". Jean-Claude Ameisen rappelle que le Comité national d'éthique dans un avis en 2000 envisageait "l'exception de l'assistance au suicide, sans demander d'ailleurs de l'inscrire dans la loi". "Penser l'exception dans la loi demande d'être sûr qu'il n'y a pas de dérive (et) tant qu'il n'y a pas d'accompagnement véritable pour la plupart des personnes, il est dangereux de l'envisager d'emblée". Il y a "une très grande discordance aujourd'hui entre ce que dit la loi, c'est à dire le fait que chacun peut avoir accès aux soins palliatifs et au soulagement de la douleur, et la réalité" (Déclaration sur France Inter, mardi 18 mars)
Gaëtan Gorce, député PS, et ancien président de la commission spéciale sur le sujet : "Ma conviction est que la méthode qui a prévalu voici trois ans reste la seule possible: rouvrir le débat parlementaire", pour "évaluer les conditions d'applications de la loi du 22 avril 2005" et éventuellement "proposer sans passion, les évolutions législatives nécessaires". Il faudrait "une formule d'exception" qui consisterait pour le malade incurable en proie à des souffrances insupportables et désireux de mourir à "saisir une haute autorité morale", qui pourrait autoriser "faute d'autre solution et à condition que toutes les garanties soient réunies, un médecin à accéder à la demande de mort de son malade". La loi Leonetti de 2005 n'a "absolument pas répondu au problème de l'euthanasie" (Déclaration, mardi 18 mars)
Mort de Chantal Sébire : les réactions
NOUVELOBS.COM | 20.03.2008 | 11:20
Voici les principales réactions après l'annonce, mercredi 19 mars, de la mort de Chantal Sébire, une mère de famille de 52 ans atteinte d'une tumeur incurable, qui avait en vain sollicité auprès de la justice le droit de recourir à l'euthanasie.
Me Gilles Antonowicz, avocat de Chantal Sébire : "S'ils font l'autopsie c'est honteux. Si Mme Sébire s'était jetée dans le canal tout proche de son appartement il n'y aurait pas eu d'enquête et là ils feraient une autopsie comme ils l'ont faite pour le fils de Marie Humbert" qui avait aidé son fils tétraplégique à mourir en 2003. Chantal Sébire qu'il a "rencontrée à deux reprises et (qu'il a) eue cinq ou six fois au téléphone restera un souvenir très fort". "Je garde un de ses messages téléphoniques en mémoire et je l'écoute tous les jours" (Déclaration à l'AFP, jeudi 20 mars)
Marie Humbert, qui avait bénéficié d'un non-lieu après avoir aidé avec un médecin son fils Vincent tétraplégique à mourir en 2003, marraine de l'association "Faut qu'on s'active": "Elle n'a pas voulu me dire quand, mais je suis persuadée qu'elle s'est suicidée. Ça me met en colère vraiment, car elle espérait vraiment que le juge lui accorderait le droit de mourir" (Déclaration sur LCI, jeudi 20 mars)
- "Je me sens bouleversée. Elle a dû partir toute seule en cachette. Je trouve ça vraiment moche. C'est le gouvernement qui n'a pas su écouter. Au téléphone, elle me disait qu'elle n'en pouvait plus. Qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle n'avait même plus la force d'aller en Suisse. Je lui disais de ne pas faire de bêtise parce qu'elle me disait qu'elle allait se jeter par la fenêtre"."Elle a été obligée de faire ça toute seule et c'est triste, vraiment. Il y a deux mois, on aurait pu l'aider, sans en arriver là, où elle a dû partir toute seule en cachette, et je trouve ça vraiment moche. Tous les Français ont entendu son message, c'est le gouvernement qui n'a pas su entendre" (Déclaration sur Europe 1, jeudi 20 mars)
- "Pour elle maintenant, elle est mieux où elle est, c'est un fait. Mais il faut absolument que les choses changent parce que ce n'est plus possible". "Tout le monde commence à dire: 'Oui c'est vrai, la loi ne va peut-être pas assez loin, il faudra peut-être qu'on fasse ci, il faudra peut-être qu'on fasse ça', et puis en attendant, des choses horribles comme ça se produisent" (Déclaration sur RTL, jeudi 10 mars)
Luc Chatel, porte-parole du gouvernement : "Je voudrais avoir une pensée pour Chantal Sébire, pour sa famille, ses proches. Sa maladie a bouleversé les Français ces derniers jours". "C'est un cas qui inspire un grand respect de la part de nos concitoyens". Soulignant que la loi votée en 2005 à l'unanimité et instaurant un droit au "laisser mourir" mais pas à l'euthanasie active "a été une énorme avancée" qui "permet aujourd'hui de traiter 90% ou 99% des cas", il a rappelé que le Premier ministre François Fillon avait chargé Jean Leonetti (UMP) d'une mission d'évaluation de ce texte. Ce serait "précisément à Jean Leonetti de dire si aujourd'hui il y a une volonté d'aller plus loin que la loi de 2005". "Il faut bien sûr prendre en compte les cas qui sont les plus douloureux comme celui de Chantal Sébire". "Il faut à la fois aller vite, parce qu'il y a régulièrement des cas exceptionnels comme celui de Chantal Sébire, et en même temps il ne faut pas légiférer dans l'urgence", indiquant que Jean Leonetti allait "avoir plusieurs semaines" pour faire son travail. (Déclaration sur LCI, jeudi 20 mars)
Nadine Morano, nouvelle secrétaire d'Etat à la Famille : "Il nous faut d'abord évaluer la loi actuelle qui répond à 99% des cas" mais "est insuffisamment connue". "Sur le 1% de cas d'exception, j'avais proposé à l'époque de créer une commission nationale d'exception d'euthanasie à qui reviendrait le soin d'examiner ces cas particuliers graves". Je suis toujours "favorable à titre personnel" et s'en "être entretenu avec le Premier ministre" François Fillon. "Il nous faut réfléchir à la question". "Le débat est mûr mais c'est un sujet grave, difficile qui ne doit pas être pas traité dans le cadre d'une émotion forte, comme celui de Madame Sébire". "Il y a des gens qui réclament la mort à un moment et qui après avoir reçu des soins palliatifs ne la réclament plus" (Déclaration sur France Info, jeudi 20 mars)
Bernard Accoyer, président UMP de l'Assemblée nationale : "Je crois qu'il ne faut jamais légiférer dans la précipitation, dans la pression passionnelle, même si celle-ci est particulièrement douloureuse et émouvante". "Comme président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'il faut aller plus loin". "Je pense que plus que d'autres, ce problème extrêmement grave doit être examiné avec recul, avec mesure et ne doit pas être traité avec précipitation sous la pression de ceux qui militent pour l'euthanasie active" (Déclaration sur Radio Classique, jeudi 20 mars)
Jean-Claude Ameisen, professeur membre du Comité national d'éthique : "Dans des situations exceptionnelles, où tout a été fait, faut-il que le législateur envisage une formule d'exception". Cette formule d'exception, autorisant le suicide médicalement assisté ne pourrait intervenir que "comme un constat d'échec à tout ce qui a été tenté", comme "une sorte de transgression" de la loi. Le Comité national d'éthique dans un avis en 2000 envisageait "l'exception de l'assistance au suicide, sans demander de l'inscrire dans la loi". Cette "exception" ne pourrait être "considérée qu'au cas par cas", par une commission multidisciplinaire, et "ne serait possible que si l'accès au soin palliatif est devenu universel". En effet la loi de 2005 sur la fin de vie "qui a été un grand progrès" est encore très loin d'être parfaitement appliquée et "la moitié des personnes qui meurent à l'hôpital ou en institution n'ont pas accès à un accompagnement et à des soins palliatifs" (Déclaration sur LCP, mercredi 19 mars)
Jean-Luc Romero, le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD): "Même si c'était le souhait (de mourir) de Chantal, j'ai beaucoup de tristesse car c'(était) une femme d'exception, avec un caractère exceptionnel, une grande force, une volonté et une voix pour un combat formidable: celui de la fin de vie dans la dignité" (Déclaration à l'AFP, mercredi 19 mars)
- "Je suis triste parce que je l'ai rencontrée à plusieurs reprises et c'était une femme exceptionnelle, d'une grande intelligence. En dépit de son apparence, c'était une femme très belle, qui a mené un combat jusqu'au bout". "Nous ne l'avons pas aidée. Je ne sais pas si elle est décédée naturellement. Je ne connais pas les circonstances de sa mort. Ce qui est sûr, c'est qu'elle souffrait énormément et je pèse mes mots". "Je trouve dramatique qu'il faille que des personnes comme Marie Humbert pour son fils, Maïa Simon, la comédienne et Chantal Sébire doivent prendre la parole pour faire bouger les politiques. Tout le monde sait qu'en France, il y a entre 10.000 et 15.000 euthanasies clandestines pour mettre fin à des vies terribles" (Déclaration au Parisien, jeudi 20 mars)
Jean Léonetti, rapporteur de la loi sur la fin de vie: "Dans la mission qu'il me confie, le Premier ministre me demande plusieurs choses. Si la loi n'est pas bien comprise, faites de la pédagogie. Si la loi n'est pas bien appliquée, donnons-lui les moyens de la faire appliquer. Si elle est insuffisamment appliquée, donnons-lui la possibilité de s'accomplir. Deux rapports indiquent que les textes actuels restent méconnus". "Dans les pays comme les Pys-Bas, où l'euthanasie est légalisée, je constate que leur nombre est en bausse. Car on leur préfère d'autres solutions comme la sédation terminale" (Déclaration au Parisien, jeudi 20 mars)
- "Chantal Sébire n'a pas demandé à la loi de s'appliquer. La loi aurait pu soulager ses souffrances même au prix de raccourcir sa vie". "Son choix était une demande de suicide". "Je ne sais pas dans quelles circonstances Chantal Sébire est morte. On peut quand même imaginer que, peut-être, elle a mis fin à ses jours. C'est une liberté qui est respectable" (Déclaration sur RTL, jeudi 20 mars)
Gaétan Gorce, député socialiste de la Nièvre : "ce qui a été terrible dans le cas de Chantal Sébire, c'est qu'il n'y avait pas d'issue directe pour elle, pour répondre à une demande qui était digne et formulée de manière responsable, pour laquelle aucune réponse institutionnelle n'était possible, c'est cela qu'il faut changer". Pour "sortir de l'hypocrisie", je suis "pour la création d'une haute autorité morale qui pourrait être saisie de ces situations et pourrait donner a priori son sentiment sur l'issue à proposer" (Déclaration sur RTL, jeudi 20 mars)
Les déclarations avant la mort de Chantal Sébire
Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères : "Je trouve très difficile de ne pas lui offrir une porte de sortie qui serait une porte d'amour avec les siens". Il faut "lui permettre de ne pas avoir besoin de se suicider dans une espèce de clandestinité dont tout le monde souffrirait, surtout ses proches". Je me suis "battu pour qu'on ait le droit de mourir dans la dignité". "J'ai beaucoup d'admiration et d'amour pour Chantal Sébire". Il faut faire "une exception à la loi" qui l'empêche d'accéder à l'euthanasie. "Ce serait humain, nécessaire" (Déclaration sur RMC et BFM-TV, mercredi 19 mars)
Jean-Claude Ameisen, professeur membre du Comité national d'éthique :
"Lorsque l'accompagnement, que tout ce qu'on peut proposer ne permet pas à la personne de considérer que sa souffrance est soulagée, il faut poser la question de savoir si on peut aller plus loin". "Est-ce que la loi envisage tous les cas les plus extrêmes ou est-ce que la loi s'arrête et qu'il faut essayer d'envisager l'exception, un pas plus loin". "Je pense qu'il faut dissocier le cas dramatique de Mme Sébire de ce que serait le fait de réviser une loi". "On a trop tendance en France à légiférer rapidement sur le fait d'événements dramatiques particuliers". Jean-Claude Ameisen rappelle que le Comité national d'éthique dans un avis en 2000 envisageait "l'exception de l'assistance au suicide, sans demander d'ailleurs de l'inscrire dans la loi". "Penser l'exception dans la loi demande d'être sûr qu'il n'y a pas de dérive (et) tant qu'il n'y a pas d'accompagnement véritable pour la plupart des personnes, il est dangereux de l'envisager d'emblée". Il y a "une très grande discordance aujourd'hui entre ce que dit la loi, c'est à dire le fait que chacun peut avoir accès aux soins palliatifs et au soulagement de la douleur, et la réalité" (Déclaration sur France Inter, mardi 18 mars)
Gaëtan Gorce, député PS, et ancien président de la commission spéciale sur le sujet : "Ma conviction est que la méthode qui a prévalu voici trois ans reste la seule possible: rouvrir le débat parlementaire", pour "évaluer les conditions d'applications de la loi du 22 avril 2005" et éventuellement "proposer sans passion, les évolutions législatives nécessaires". Il faudrait "une formule d'exception" qui consisterait pour le malade incurable en proie à des souffrances insupportables et désireux de mourir à "saisir une haute autorité morale", qui pourrait autoriser "faute d'autre solution et à condition que toutes les garanties soient réunies, un médecin à accéder à la demande de mort de son malade". La loi Leonetti de 2005 n'a "absolument pas répondu au problème de l'euthanasie" (Déclaration, mardi 18 mars)
Courage à tous et à toutes !
dernière ligne droite, on y croit tous ! No stress que de la motivation !!!
dernière ligne droite, on y croit tous ! No stress que de la motivation !!!
L'extension du dossier pharmaceutique autorisée
par la Cnil
20/03/2008 | Mise à jour : 10:18 | .
La Cnil a autorisé l'extension du dossier pharmaceutique. Crédits photo : Patrick ALLARD/REA
Il est déjà lancé dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, puis arrivera dans des stations balnéaires ou de montagne.
Testé depuis l'été, le dossier pharmaceutique fait un pas vers la généralisation. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a autorisé son extension à 2000 officines, sur 23000 en France. Il est donc maintenant lancé dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, puis arrivera dans des stations balnéaires ou de montagne. Dans ces zones, les patients sont nombreux à entrer dans une pharmacie sans en être un habitué. Or le dossier permet au pharmacien de visualiser sur son ordinateur les médicaments vendus à un patient depuis quatre mois, dans toutes les officines, même sans ordonnance. Et ce pour éviter les mélanges nocifs qui, selon le ministère de la Santé, causent 130000 hospitalisations par an.
La carte Vitale sert de clé d'entrée. Chacun est libre d'accepter ou non la création de son dossier. Mais, selon l'ordre des pharmaciens, dans les départements tests (Doubs, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Pas-de-Calais, Rhône, Seine-Maritime), plus de 8 patients sur 10 acceptent et 170000 dossiers fonctionnent. Dans la Nièvre, par exemple, les dimanches de garde, 6 dossiers sur 10 contiennent des médicaments délivrés dans une autre pharmacie, alors que 60 officines sur 95 restent à «connecter». Installée à Corbigny et en charge du projet à l'ordre des pharmaciens, Isabelle Adenot raconte : «Plusieurs fois déjà, après consultation d'un dossier, j'ai refusé de délivrer un médicament, appelé un médecin pour vérifier son ordonnance ou changé mon conseil pour un produit à prescription facultative.»
La généralisation du dossier pharmaceutique, prévue d'ici à deux ans, doit coûter 20 millions aux pharmaciens eux-mêmes, par le biais de leurs cotisations à l'Ordre. Mais cet outil les distinguera des grandes surfaces qui veulent vendre des médicaments.
par la Cnil
20/03/2008 | Mise à jour : 10:18 | .
La Cnil a autorisé l'extension du dossier pharmaceutique. Crédits photo : Patrick ALLARD/REA
Il est déjà lancé dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, puis arrivera dans des stations balnéaires ou de montagne.
Testé depuis l'été, le dossier pharmaceutique fait un pas vers la généralisation. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a autorisé son extension à 2000 officines, sur 23000 en France. Il est donc maintenant lancé dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, puis arrivera dans des stations balnéaires ou de montagne. Dans ces zones, les patients sont nombreux à entrer dans une pharmacie sans en être un habitué. Or le dossier permet au pharmacien de visualiser sur son ordinateur les médicaments vendus à un patient depuis quatre mois, dans toutes les officines, même sans ordonnance. Et ce pour éviter les mélanges nocifs qui, selon le ministère de la Santé, causent 130000 hospitalisations par an.
La carte Vitale sert de clé d'entrée. Chacun est libre d'accepter ou non la création de son dossier. Mais, selon l'ordre des pharmaciens, dans les départements tests (Doubs, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Pas-de-Calais, Rhône, Seine-Maritime), plus de 8 patients sur 10 acceptent et 170000 dossiers fonctionnent. Dans la Nièvre, par exemple, les dimanches de garde, 6 dossiers sur 10 contiennent des médicaments délivrés dans une autre pharmacie, alors que 60 officines sur 95 restent à «connecter». Installée à Corbigny et en charge du projet à l'ordre des pharmaciens, Isabelle Adenot raconte : «Plusieurs fois déjà, après consultation d'un dossier, j'ai refusé de délivrer un médicament, appelé un médecin pour vérifier son ordonnance ou changé mon conseil pour un produit à prescription facultative.»
La généralisation du dossier pharmaceutique, prévue d'ici à deux ans, doit coûter 20 millions aux pharmaciens eux-mêmes, par le biais de leurs cotisations à l'Ordre. Mais cet outil les distinguera des grandes surfaces qui veulent vendre des médicaments.
Courage à tous et à toutes !
dernière ligne droite, on y croit tous ! No stress que de la motivation !!!
dernière ligne droite, on y croit tous ! No stress que de la motivation !!!
- aneso81
- Insatiable

- Messages : 624
- Inscription : 10 juil. 2007 14:10
- Localisation : Dans les nuages!!!xD
Obésité infantile : l’industrie alimentaire sèche la concertation
[19 mars 2008 - 15:45]
Dans la lutte contre le surpoids des petits Français, ça tire vraiment à hue et à dia ! Le collectif « Obésité : protégeons nos enfants » dénonce aujourd’hui « la dérobade de l’industrie alimentaire et de la grande distribution », qui ne participent pas à la concertation organisée par la ministre de la Santé Roselyne Bachelot-Narquin. Deux réunions, deux absences… Même si une partie seulement des professionnels concernés ne jouent pas le jeu, pour le collectif en question c’est insupportable.
« Pour la deuxième fois hier, l’industrie et la grande distribution ont boycotté les réunions de concertations » rapportent les 6 associations en question, dont l’UFC-Que Choisir. Cette politique de la chaise vide paraît d’autant plus malvenue que les industriels naturellement, étaient attendus au tournant.
Ils étaient en effet, « invités à présenter des propositions volontaires pour retirer les confiseries aux caisses de la grande distribution et encadrer la diffusion pendant les programmes pour enfants des publicités pour les aliments gras, sucrés ou salés »… Le motif de cette bouderie ? Toute simplement le refus du ministre de la Santé de rencontrer les industriels… à huis clos.
Le collectif estime cette exigence inadmissible. Et il contre-attaque en pointant les obstructionnistes : « Danone, Kellogg’s, Nestlé, Yoplait ainsi que les enseignes Auchan, Carrefour, Casino et Cora ». Ces derniers ont même droit à une lettre ouverte en forme de réquisitoire. A malappris, malappris-et-demi ! Et pour bien enfoncer le clou, le collectif donne également la liste des « bons élèves » : Coca-Cola, Ferrero, le groupe de distribution E. Leclerc, Mc Donald’s, Orangina-Schweppes et le syndicat du Chocolat.
[19 mars 2008 - 15:45]
Dans la lutte contre le surpoids des petits Français, ça tire vraiment à hue et à dia ! Le collectif « Obésité : protégeons nos enfants » dénonce aujourd’hui « la dérobade de l’industrie alimentaire et de la grande distribution », qui ne participent pas à la concertation organisée par la ministre de la Santé Roselyne Bachelot-Narquin. Deux réunions, deux absences… Même si une partie seulement des professionnels concernés ne jouent pas le jeu, pour le collectif en question c’est insupportable.
« Pour la deuxième fois hier, l’industrie et la grande distribution ont boycotté les réunions de concertations » rapportent les 6 associations en question, dont l’UFC-Que Choisir. Cette politique de la chaise vide paraît d’autant plus malvenue que les industriels naturellement, étaient attendus au tournant.
Ils étaient en effet, « invités à présenter des propositions volontaires pour retirer les confiseries aux caisses de la grande distribution et encadrer la diffusion pendant les programmes pour enfants des publicités pour les aliments gras, sucrés ou salés »… Le motif de cette bouderie ? Toute simplement le refus du ministre de la Santé de rencontrer les industriels… à huis clos.
Le collectif estime cette exigence inadmissible. Et il contre-attaque en pointant les obstructionnistes : « Danone, Kellogg’s, Nestlé, Yoplait ainsi que les enseignes Auchan, Carrefour, Casino et Cora ». Ces derniers ont même droit à une lettre ouverte en forme de réquisitoire. A malappris, malappris-et-demi ! Et pour bien enfoncer le clou, le collectif donne également la liste des « bons élèves » : Coca-Cola, Ferrero, le groupe de distribution E. Leclerc, Mc Donald’s, Orangina-Schweppes et le syndicat du Chocolat.
Puéricultrice
Vis un rêve éveillée
Vis un rêve éveillée
- aneso81
- Insatiable

- Messages : 624
- Inscription : 10 juil. 2007 14:10
- Localisation : Dans les nuages!!!xD
Quand la narcolepsie rend… boulimique
[20 mars 2008 - 09:52]
Les patients souffrant de narcolepsie seraient davantage sujets aux troubles du comportement alimentaire. Avec notamment une tendance accrue à la boulimie. Or en France, 30 000 personnes seraient atteintes de narcolepsie, une affection caractérisée par des accès soudains et irrésistibles de sommeil.
Le Pr Hal Droogleever Fortuyn, de l’Université de Nimègue aux Pays-Bas, a étudié le comportement alimentaire de 60 patients souffrant de narcolepsie. Il l’a ensuite comparé à celui de 120 autres personnes, qui ont constitué un groupe témoin.
Il a ainsi observé que près du quart des patients du premier groupe souffrait de troubles alimentaires, ce qui n’était le cas d’aucun membre de l’autre groupe. « Ces résultats souligne-t-il, « démontrent clairement que la narcolepsie n’est pas uniquement un trouble du sommeil. Chez les patients qui en souffrent un neurotransmetteur particulier, l’hypocrétine, est absent ». Or de nombreuses études ont montré que ce neurotransmetteur était impliqué dans la régulation de l’appétit chez l’animal. Et en attendant, le bon vieil adage selon lequel « Qui dort dîne » prend un coup dans l’aile…
[20 mars 2008 - 09:52]
Les patients souffrant de narcolepsie seraient davantage sujets aux troubles du comportement alimentaire. Avec notamment une tendance accrue à la boulimie. Or en France, 30 000 personnes seraient atteintes de narcolepsie, une affection caractérisée par des accès soudains et irrésistibles de sommeil.
Le Pr Hal Droogleever Fortuyn, de l’Université de Nimègue aux Pays-Bas, a étudié le comportement alimentaire de 60 patients souffrant de narcolepsie. Il l’a ensuite comparé à celui de 120 autres personnes, qui ont constitué un groupe témoin.
Il a ainsi observé que près du quart des patients du premier groupe souffrait de troubles alimentaires, ce qui n’était le cas d’aucun membre de l’autre groupe. « Ces résultats souligne-t-il, « démontrent clairement que la narcolepsie n’est pas uniquement un trouble du sommeil. Chez les patients qui en souffrent un neurotransmetteur particulier, l’hypocrétine, est absent ». Or de nombreuses études ont montré que ce neurotransmetteur était impliqué dans la régulation de l’appétit chez l’animal. Et en attendant, le bon vieil adage selon lequel « Qui dort dîne » prend un coup dans l’aile…
Puéricultrice
Vis un rêve éveillée
Vis un rêve éveillée
- aneso81
- Insatiable

- Messages : 624
- Inscription : 10 juil. 2007 14:10
- Localisation : Dans les nuages!!!xD
Dépistage gratuit des cancers de la peau : une nécessité de santé publique
[21 mars 2008 - 07:50]
Les Journées nationales de prévention et de dépistage des cancers de la peau organisées depuis 1998, ont permis d’examiner plus de 220 000 patients. Et surtout de détecter 1 600 lésions cancéreuses. C’est dire si ces opérations répondent à un besoin !
Cette année, le Syndicat des dermatologues et vénérologues invite encore une fois les Français à se faire dépister gratuitement, le 15 mai prochain. Il y a urgence, car chaque jour en France 5 personnes meurent d’un cancer de la peau. Ce qui représente plus de 1 500 décès chaque année.
Au-delà d’un dépistage pur et simple, la journée du 15 mai visera à informer et sensibiliser les Français au danger réel des cancers de la peau. Et notamment du mélanome. Ce dernier frappe 6 000 de nos concitoyens chaque année. Traité à temps, il peut être guéri sans suites dans 90% des cas. Encore faut-il le rechercher et… savoir reconnaître les lésions pré-cancéreuses.
[21 mars 2008 - 07:50]
Les Journées nationales de prévention et de dépistage des cancers de la peau organisées depuis 1998, ont permis d’examiner plus de 220 000 patients. Et surtout de détecter 1 600 lésions cancéreuses. C’est dire si ces opérations répondent à un besoin !
Cette année, le Syndicat des dermatologues et vénérologues invite encore une fois les Français à se faire dépister gratuitement, le 15 mai prochain. Il y a urgence, car chaque jour en France 5 personnes meurent d’un cancer de la peau. Ce qui représente plus de 1 500 décès chaque année.
Au-delà d’un dépistage pur et simple, la journée du 15 mai visera à informer et sensibiliser les Français au danger réel des cancers de la peau. Et notamment du mélanome. Ce dernier frappe 6 000 de nos concitoyens chaque année. Traité à temps, il peut être guéri sans suites dans 90% des cas. Encore faut-il le rechercher et… savoir reconnaître les lésions pré-cancéreuses.
Puéricultrice
Vis un rêve éveillée
Vis un rêve éveillée
- aneso81
- Insatiable

- Messages : 624
- Inscription : 10 juil. 2007 14:10
- Localisation : Dans les nuages!!!xD
Deux lots d’héparine retirés par mesure de précaution
[21 mars 2008 - 11:30]
L’Agence française de Sécurité sanitaire des Produits de Santé (AFSSaPS) a demandé au laboratoire Panpharma de retirer deux lots d’héparine, un anti-coagulant utilisé en prévention ou en traitement des thromboses. Il s’agit d’une « mesure de précaution », qui fait suite à la survenue « de cas de réactions allergiques » observés ces dernières semaines aux Etats-Unis et en Allemagne.
« Aucun accroissement du nombre de réactions allergiques graves n’a été détecté en France » rassure néanmoins l’AFSSaPS, à propos d’une affaire qui a débuté le mois dernier aux Etats-Unis.
Le 28 février, les lots d’héparine commercialisés par Baxter sur le marché américain étaient retirés, à la suite de « cas graves de réactions allergiques ». Plus récemment, les autorités allemandes, « confrontées à des effets indésirables de moindre gravité, ont retiré des lots d’héparine de sodium distribués par Rotexmedica, filiale de Panpharma, qui commercialise de l’héparine en France, pour un usage hospitalier ».
Point commun entre ces deux alertes : « les lots américains et allemands ont été fabriqués à partir d’une matière première d’origine chinoise », indique l’AFSSaPS. Quant aux lots français, ils proviennent justement « d’un des fournisseurs chinois dont la matière première a été utilisée pour la fabrication des héparines en cause dans les effets indésirables observés en Allemagne ».
L’Agence française a d’ores et déjà réalisé des contrôles sur les produits en question. « Les premiers résultats montrent une anomalie qui nécessite des investigations complémentaires ». En attendant, Panpharma effectue à la demande de l’AFSSaPS, le rappel du lot 70480, date de péremption 06/2010 et du lot lot 70590, date de péremption 10/2010 du produit Héparine Panpharma 25000 UI/5ml®.
[21 mars 2008 - 11:30]
L’Agence française de Sécurité sanitaire des Produits de Santé (AFSSaPS) a demandé au laboratoire Panpharma de retirer deux lots d’héparine, un anti-coagulant utilisé en prévention ou en traitement des thromboses. Il s’agit d’une « mesure de précaution », qui fait suite à la survenue « de cas de réactions allergiques » observés ces dernières semaines aux Etats-Unis et en Allemagne.
« Aucun accroissement du nombre de réactions allergiques graves n’a été détecté en France » rassure néanmoins l’AFSSaPS, à propos d’une affaire qui a débuté le mois dernier aux Etats-Unis.
Le 28 février, les lots d’héparine commercialisés par Baxter sur le marché américain étaient retirés, à la suite de « cas graves de réactions allergiques ». Plus récemment, les autorités allemandes, « confrontées à des effets indésirables de moindre gravité, ont retiré des lots d’héparine de sodium distribués par Rotexmedica, filiale de Panpharma, qui commercialise de l’héparine en France, pour un usage hospitalier ».
Point commun entre ces deux alertes : « les lots américains et allemands ont été fabriqués à partir d’une matière première d’origine chinoise », indique l’AFSSaPS. Quant aux lots français, ils proviennent justement « d’un des fournisseurs chinois dont la matière première a été utilisée pour la fabrication des héparines en cause dans les effets indésirables observés en Allemagne ».
L’Agence française a d’ores et déjà réalisé des contrôles sur les produits en question. « Les premiers résultats montrent une anomalie qui nécessite des investigations complémentaires ». En attendant, Panpharma effectue à la demande de l’AFSSaPS, le rappel du lot 70480, date de péremption 06/2010 et du lot lot 70590, date de péremption 10/2010 du produit Héparine Panpharma 25000 UI/5ml®.
Puéricultrice
Vis un rêve éveillée
Vis un rêve éveillée
Ok ne pas donner son avis c'est noté 
Je vais suivre vos conseil : plan / idées clairs et simple/ ne pas trop developper / ne pas s'impliquer . J'ai rien oublié ?
Maintenant faut voir si j'arrive a bien faire mes plan et a rediger comme il faut
merci a vous tous en tous cas
Je vais suivre vos conseil : plan / idées clairs et simple/ ne pas trop developper / ne pas s'impliquer . J'ai rien oublié ?
Maintenant faut voir si j'arrive a bien faire mes plan et a rediger comme il faut
merci a vous tous en tous cas
EIDE 1ere année montpellier
titema a écrit :Maintenant faut voir si j'arrive a bien faire mes plan et a rediger comme il faut
Entraîne-toi à la culture générale
- Azazel
- Fidèle

- Messages : 241
- Inscription : 08 août 2007 21:35
- Localisation : Proche Provins (77)
- Contact :
Le tabagisme et la consommation d'alcool ont enregistré un net recul chez les jeunes de 18 à 25 ans, entre 2000 et 2005, bien que l'ivresse se répande parmi les mineurs âgés de 17 ans, selon plusieurs études dont les résultats sont publiés, mardi 25 mars, dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Institut de veille sanitaire (InVS).
Cette analyse, réalisée notamment par des chercheurs de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, montre que sept jeunes de 17 ans sur dix ont fumé au moins une cigarette au cours de leur vie et 33 % fument quotidiennement, contre 41 % en 2000. "La baisse du tabagisme quotidien est constante depuis la fin des années 1990", constatent les auteurs de l'étude. Cependant, "la part des gros consommateurs se maintient et l'âge d'expérimentation décroît légèrement". Les chercheurs notent ainsi que l'âge moyen de la première cigarette a sensiblement baissé, passant de 13,7 ans en 2000 à 13,4 ans en 2005.
LE CANNABIS, PLUS RÉPANDU QUE L'ALCOOL CHEZ LES JEUNES DE 17 ANS
A 17 ans, 11 % des jeunes disent boire régulièrement de l'alcool (au moins dix fois par mois), un chiffre similaire à celui de 2000. Près de six jeunes sur dix, à ce même âge, déclarent avoir déjà été ivres et près de 10 % l'ont été au moins à dix reprises au cours de leur vie (6,4 % en 2000).
Un jeune de 17 ans sur deux dit avoir déjà fumé du cannabis et un sur dix en fume régulièrement, des chiffres en faible évolution par rapport à 2000. "A 17 ans, la consommation quotidienne de cannabis est beaucoup plus répandue que celle d'alcool [5,2 % contre 1,2 %]", notent les chercheurs. Dans cette classe d'âge, 12,3 % des adolescents ont consommé au moins une fois dans leur vie un autre produit illicite, comme les poppers, des liquides vasodilatateurs aphrodisiaques interdits à la vente en France, ou des champignons hallucinogènes. Les chercheurs constatent également une hausse de la consommation d'ecstasy et d'amphétamines, mais aussi de cocaïne. En 2005, 3,5 % des jeunes de 17 ans en avaient déjà consommé, contre 0,9 % cinq ans plus tôt.
ORIGINE SOCIALE DES CONSOMMATEURS
Les jeunes adultes de 18 à 25 ans connaissent des usages d'alcool et de tabac plus fréquents que les plus jeunes, mais leur consommation de tabac est en baisse depuis 2000 (36,3 % contre 40,4 % en 2000 fument quotidiennement). Quant à la consommation régulière d'alcool, elle s'est quasiment divisée par deux, passant de 17,6 % à 8,9 %. Les 18-25 ans consomment un peu moins de cannabis que les plus jeunes (8,7 % contre 10,8 %).
Dans leur conclusion, les chercheurs remarquent que les résultats de leur enquête doivent "se doubler d'observations sur l'origine sociale des consommateurs". Tout en notant que "les milieux favorisés [...] présentent de forts niveaux d'expérimentation ou d'usage occasionnels", ils soulignent que "les parcours scolaires dégradés ou écourtés d'un côté, l'exclusion du monde du travail de l'autre sont associés à des usages souvent plus intenses, voire problématiques, de produits licites et illicites".
Cette analyse, réalisée notamment par des chercheurs de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, montre que sept jeunes de 17 ans sur dix ont fumé au moins une cigarette au cours de leur vie et 33 % fument quotidiennement, contre 41 % en 2000. "La baisse du tabagisme quotidien est constante depuis la fin des années 1990", constatent les auteurs de l'étude. Cependant, "la part des gros consommateurs se maintient et l'âge d'expérimentation décroît légèrement". Les chercheurs notent ainsi que l'âge moyen de la première cigarette a sensiblement baissé, passant de 13,7 ans en 2000 à 13,4 ans en 2005.
LE CANNABIS, PLUS RÉPANDU QUE L'ALCOOL CHEZ LES JEUNES DE 17 ANS
A 17 ans, 11 % des jeunes disent boire régulièrement de l'alcool (au moins dix fois par mois), un chiffre similaire à celui de 2000. Près de six jeunes sur dix, à ce même âge, déclarent avoir déjà été ivres et près de 10 % l'ont été au moins à dix reprises au cours de leur vie (6,4 % en 2000).
Un jeune de 17 ans sur deux dit avoir déjà fumé du cannabis et un sur dix en fume régulièrement, des chiffres en faible évolution par rapport à 2000. "A 17 ans, la consommation quotidienne de cannabis est beaucoup plus répandue que celle d'alcool [5,2 % contre 1,2 %]", notent les chercheurs. Dans cette classe d'âge, 12,3 % des adolescents ont consommé au moins une fois dans leur vie un autre produit illicite, comme les poppers, des liquides vasodilatateurs aphrodisiaques interdits à la vente en France, ou des champignons hallucinogènes. Les chercheurs constatent également une hausse de la consommation d'ecstasy et d'amphétamines, mais aussi de cocaïne. En 2005, 3,5 % des jeunes de 17 ans en avaient déjà consommé, contre 0,9 % cinq ans plus tôt.
ORIGINE SOCIALE DES CONSOMMATEURS
Les jeunes adultes de 18 à 25 ans connaissent des usages d'alcool et de tabac plus fréquents que les plus jeunes, mais leur consommation de tabac est en baisse depuis 2000 (36,3 % contre 40,4 % en 2000 fument quotidiennement). Quant à la consommation régulière d'alcool, elle s'est quasiment divisée par deux, passant de 17,6 % à 8,9 %. Les 18-25 ans consomment un peu moins de cannabis que les plus jeunes (8,7 % contre 10,8 %).
Dans leur conclusion, les chercheurs remarquent que les résultats de leur enquête doivent "se doubler d'observations sur l'origine sociale des consommateurs". Tout en notant que "les milieux favorisés [...] présentent de forts niveaux d'expérimentation ou d'usage occasionnels", ils soulignent que "les parcours scolaires dégradés ou écourtés d'un côté, l'exclusion du monde du travail de l'autre sont associés à des usages souvent plus intenses, voire problématiques, de produits licites et illicites".
« Nous sommes éduqués à croire et non à savoir. La croyance peut-être manipulée.
Seul le savoir est dangereux. »
Sous fifre au fouet du Chef ^^
ESI 2008-2011 à Provins
Seul le savoir est dangereux. »
Sous fifre au fouet du Chef ^^
ESI 2008-2011 à Provins