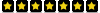séisme Asie du Sud
Modérateur : Modérateurs
Lundi 17 janvier 2005
bilan
Selon le dernier bilan officiel, le raz de marée provoqué par le séisme du 26 décembre a fait plus de 168 000 morts et des milliers de disparus dans les pays riverains de l’océan Indien.
-> Indonésie : 115 229 morts, 12 132 disparus, selon le ministère des Affaires sociales. Plus de 700 000 personnes déplacées.
-> Sri Lanka : 30 920 morts, 6 034 disparus, 15 256 blessés,
selon le gouvernement. Le nombre de déplacés s’est stabilisé à près de 500 000.
-> Inde : 10 627 morts, 5 711 disparus présumés morts, selon le ministère de l’Intérieur. Quelque 378 000 personnes restent temporairement abritées dans des camps.
-> Thaïlande : 5 321 morts, dont 1 732 Thaïlandais, 2 173 étrangers et 1 416 personnes dont l’appartenance à l’un ou l’autre des deux groupes n’a pu être déterminée, selon le ministère de l’Intérieur. Le nombre des disparus, en baisse, est de 3 170 personnes, dont 1 039 étrangers.
-> Maldives : 82 morts, 26 disparus, près de 13 000 personnes déplacées, selon le gouvernement
Le Monde
Sous l'égide de l'ONU, un congrès mondial sur les calamités naturelles réunit à partir de mardi à Kobé, au Japon, plusieurs milliers d'experts, Chaque année, entre 1994 et 2003, 255 millions de personnes ont été touchées par les catastrophes d'origine naturelle, et 58 000 en sont décédées, le tribut le plus lourd étant payé par l'Afrique et l'Asie.
Depuis 1974, on a recensé plus de 6 300 désastres, hors épidémies, qui ont frappé 5 milliards d'humains et en ont tué 2 millions. Le changement climatique pourrait, de surcroît, provoquer dans l'avenir une augmentation des inondations et des cyclones.
 Les pays pauvres sont les plus vulnérables face aux catastrophes
Les pays pauvres sont les plus vulnérables face aux catastrophes
Au Bengladesh, un système exemplaire.
La vitesse étant la clé du succès, un système d'alerte a été mis au point, permettant de diffuser les alarmes lancées par les stations météorologiques. Des volontaires du Croissant-Rouge sont formés dans chaque village pour réagir rapidement et des drapeaux flottent dans les bazars, signalant sept niveaux de danger que les gens connaissent. Enfin, des gamins équipés de mégaphones parcourent les rues en cas d'alerte pour avertir les gens de rejoindre les abris
 Le Bangladesh a mis en place un système exemplaire de réaction aux cyclones
Le Bangladesh a mis en place un système exemplaire de réaction aux cyclones
Situé à la jonction de quatre plaques tectoniques, l'archipel nippon est continuellement agité de secousses sismiques. Le cinquième des séismes dont la magnitude dépasse 6 sur l'échelle de Richter ont lieu au Japon.
 Dans ses entrailles, Tokyo se prépare au "Big One"
Dans ses entrailles, Tokyo se prépare au "Big One"
Le drame de l'Océan indien aurait-il pu être évité, atténué dans ses effets meurtriers ? Sans doute, si les populations avaient été alertées à temps et, surtout, si elles avaient su ce qu'elles devaient faire. Le point faible de tout système de prévention des tsunamis est le facteur humain.
 Alerte et information sont des "garanties de survie"
Alerte et information sont des "garanties de survie"
On ne mord pas la main qui donne. Et pourtant. Le mouvement de générosité sans précédent provoqué par le tsunami en Asie démontre la violence de l'onde de choc ressentie dans les pays occidentaux.
Il faut pourtant se demander si, sur le plan économique, un tel afflux de dons se justifie, s'il n'est pas exagéré. Les sommes promises aux zones dévastées n'atteignent-elles pas des niveaux disproportionnés par rapport aux besoins réels ? Ne doit-on pas redouter des effets d'éviction, l'argent pour l'Asie n'étant plus disponible pour d'autres régions du monde, plus nécessiteuses encore, dont l'Afrique ? La générosité, en plus d'être aveugle, n'est-elle pas un facteur d'injustice et un créateur d'inégalités ?
 Asie du Sud : la générosité tombe dans l'excès
Asie du Sud : la générosité tombe dans l'excès
Le Nouvel Obs
Le ministre indonésien de la Défense a annoncé dimanche que Djakarta ne donnait plus trois mois aux troupes étrangères engagées dans les opérations de secours d'après-tsunami pour quitter l'archipel
 L'Indonésie fait un geste d'ouverture
L'Indonésie fait un geste d'ouverture
L'organisation américaine des droits de l'homme parle de discriminations dans la distribution de l'aide envers les Dalits, ou intouchables.
 Inde : HRW dénonce des aides inégales
Inde : HRW dénonce des aides inégales
L’Humanité
 Les militaires français enfin à pied d’oeuvre
Les militaires français enfin à pied d’oeuvre
Libération
Les ONG doivent oeuvrer de concert avec les autorités publiques, étatiques et internationales
 Tsunami, coordonner l'aide
Tsunami, coordonner l'aide
L'urgence passée, médecins et ONG médicales restent en grand nombre.
 A Aceh, des hôpitaux de fortune en mal de malades
A Aceh, des hôpitaux de fortune en mal de malades
 Pour avoir un éclairage sur un conflit qui fait des milliers de morts, déplacés et affamés et que l’on a mis récemment en parallèle, en polémique (et/ou en lumière pour certains) avec le tsunami en Asie
Pour avoir un éclairage sur un conflit qui fait des milliers de morts, déplacés et affamés et que l’on a mis récemment en parallèle, en polémique (et/ou en lumière pour certains) avec le tsunami en Asie
L’Express
Voilà deux ans que la guerre ravage l'ouest du Soudan. En apparence, un litige entre paysans africains et nomades arabes; en réalité, la campagne féroce d'un régime totalitaire qui, profitant de la faiblesse des réactions occidentales, joue l'enlisement du conflit
 L'enfer du Darfour
L'enfer du Darfour
bilan
Selon le dernier bilan officiel, le raz de marée provoqué par le séisme du 26 décembre a fait plus de 168 000 morts et des milliers de disparus dans les pays riverains de l’océan Indien.
-> Indonésie : 115 229 morts, 12 132 disparus, selon le ministère des Affaires sociales. Plus de 700 000 personnes déplacées.
-> Sri Lanka : 30 920 morts, 6 034 disparus, 15 256 blessés,
selon le gouvernement. Le nombre de déplacés s’est stabilisé à près de 500 000.
-> Inde : 10 627 morts, 5 711 disparus présumés morts, selon le ministère de l’Intérieur. Quelque 378 000 personnes restent temporairement abritées dans des camps.
-> Thaïlande : 5 321 morts, dont 1 732 Thaïlandais, 2 173 étrangers et 1 416 personnes dont l’appartenance à l’un ou l’autre des deux groupes n’a pu être déterminée, selon le ministère de l’Intérieur. Le nombre des disparus, en baisse, est de 3 170 personnes, dont 1 039 étrangers.
-> Maldives : 82 morts, 26 disparus, près de 13 000 personnes déplacées, selon le gouvernement
Le Monde
Sous l'égide de l'ONU, un congrès mondial sur les calamités naturelles réunit à partir de mardi à Kobé, au Japon, plusieurs milliers d'experts, Chaque année, entre 1994 et 2003, 255 millions de personnes ont été touchées par les catastrophes d'origine naturelle, et 58 000 en sont décédées, le tribut le plus lourd étant payé par l'Afrique et l'Asie.
Depuis 1974, on a recensé plus de 6 300 désastres, hors épidémies, qui ont frappé 5 milliards d'humains et en ont tué 2 millions. Le changement climatique pourrait, de surcroît, provoquer dans l'avenir une augmentation des inondations et des cyclones.
Au Bengladesh, un système exemplaire.
La vitesse étant la clé du succès, un système d'alerte a été mis au point, permettant de diffuser les alarmes lancées par les stations météorologiques. Des volontaires du Croissant-Rouge sont formés dans chaque village pour réagir rapidement et des drapeaux flottent dans les bazars, signalant sept niveaux de danger que les gens connaissent. Enfin, des gamins équipés de mégaphones parcourent les rues en cas d'alerte pour avertir les gens de rejoindre les abris
Situé à la jonction de quatre plaques tectoniques, l'archipel nippon est continuellement agité de secousses sismiques. Le cinquième des séismes dont la magnitude dépasse 6 sur l'échelle de Richter ont lieu au Japon.
Le drame de l'Océan indien aurait-il pu être évité, atténué dans ses effets meurtriers ? Sans doute, si les populations avaient été alertées à temps et, surtout, si elles avaient su ce qu'elles devaient faire. Le point faible de tout système de prévention des tsunamis est le facteur humain.
On ne mord pas la main qui donne. Et pourtant. Le mouvement de générosité sans précédent provoqué par le tsunami en Asie démontre la violence de l'onde de choc ressentie dans les pays occidentaux.
Il faut pourtant se demander si, sur le plan économique, un tel afflux de dons se justifie, s'il n'est pas exagéré. Les sommes promises aux zones dévastées n'atteignent-elles pas des niveaux disproportionnés par rapport aux besoins réels ? Ne doit-on pas redouter des effets d'éviction, l'argent pour l'Asie n'étant plus disponible pour d'autres régions du monde, plus nécessiteuses encore, dont l'Afrique ? La générosité, en plus d'être aveugle, n'est-elle pas un facteur d'injustice et un créateur d'inégalités ?
Le Nouvel Obs
Le ministre indonésien de la Défense a annoncé dimanche que Djakarta ne donnait plus trois mois aux troupes étrangères engagées dans les opérations de secours d'après-tsunami pour quitter l'archipel
L'organisation américaine des droits de l'homme parle de discriminations dans la distribution de l'aide envers les Dalits, ou intouchables.
L’Humanité
Libération
Les ONG doivent oeuvrer de concert avec les autorités publiques, étatiques et internationales
L'urgence passée, médecins et ONG médicales restent en grand nombre.
L’Express
Voilà deux ans que la guerre ravage l'ouest du Soudan. En apparence, un litige entre paysans africains et nomades arabes; en réalité, la campagne féroce d'un régime totalitaire qui, profitant de la faiblesse des réactions occidentales, joue l'enlisement du conflit
La pensée vole, et les mots vont à pieds.
-
Invité
Boris a écrit :En tout cas il cogite sévère Kétamix, l'a l'air loin d'être con le garçon.
Il part aussi dans tous les sens, astuce connue pour maîtriser un débat.
Onde de choc et reflux médiatique.
c'est clair que le débat est maitrisé ici ! et j'en suis fort étonné. Je comprends que l'actualité ait glissé ailleurs cependant il n'y a jamais eu foule ici... du moins pour discuter, débattre ou commenter
L'actualité, cette actualité a pourtant été riche en flux et reflux et pour l'instant on n'a pas encore cherché à noyer le poisson... même s'il est vrai que tout n'est pas dit et qu'il sera plus facile de le faire avec une certaine distance, distance dans le temps et distance par rapport aux évènements.
Il faudra m'expliquer comment le fait de partir dans tous les sens permet de maîtriser un débat !
La pensée vole, et les mots vont à pieds.
-
Invité
Mercredi 19 janvier 2005 : 24e jour
Il est de plus en plus difficile de trouver des informations en relation directe avec le séisme du 26/12 ou des informations concernant ce qui se passe actuellement concrètement dans les pays touchés.
L’Humanité
Ouverture hier, de la conférence de Kobé sur la prévention des catastrophes naturelles. Un système d'alerte global aux tsunamis sera étudié par plusieurs milliers d'experts, à l'occasion du dixième anniversaire du terrible séisme qui avait détruit ce port japonais en 1995 et provoqué la mort de 6 433 personnes
Entretien avec un physicien et tectonicien à l’Institut de physique du globe de Paris.
 Quelle prévention face aux séismes et aux tsunamis ?
Quelle prévention face aux séismes et aux tsunamis ?
 Le défi de la prévention
Le défi de la prévention
libération
 La planète tremble pour son avenir
La planète tremble pour son avenir
Les sismologues multiplient les rapports alarmants sur le Japon.
 Tokyo sous la menace du Big One
Tokyo sous la menace du Big One
RFI
Au nord de l’île de Sumatra, l’approvisionnement des populations rescapées du tremblement de terre et du tsunami du 26 décembre reste difficile. Loin des aéroports et de ce qu’il reste des centres urbains de la province d’Aceh, une équipe de l’organisation humanitaire Action contre la faim tente de ravitailler par bateau, trois villages de la côte ouest de l’île au sud de Banda Aceh.
 La difficile distribution de l’aide
La difficile distribution de l’aide
 Le tsunami a détruit un million d'emplois en Asie, a estimé mercredi le Bureau international du travail (BIT)
Le tsunami a détruit un million d'emplois en Asie, a estimé mercredi le Bureau international du travail (BIT)
En Indonésie, pays le plus touché par la catastrophe du 26 décembre, environ 600.000 personnes ont perdu leurs moyens de subsistance, principalement dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture et dans l'économie informelle.
Le taux de chômage dans les régions affectées pourrait augmenter de 30%.
Au Sri Lanka, plus de 400.000 personnes ont perdu leur emploi dans les mêmes secteurs qu'en Indonésie, auxquels il faut ajouter le tourisme. Le taux de chômage dans les provinces touchées dépasse probablement 20% contre 9,2% avant les raz de marée, selon le BIT.
Pour l'ensemble du pays, le nombre de chômeurs pourrait avoir temporairement augmenté de 55%.
Dans ces deux pays, l'organisation estime qu'entre 50% et 60% des personnes touchées par le tsunami auront retrouvé un moyen de subsistance d'ici à la fin de l'année grâce aux efforts de reconstruction. "Environ 85% des emplois pourraient être rétablis avant deux ans", selon le communiqué.
Face à la catastrophe, le BIT demande que "les créations d'emploi soient partie intégrante des efforts humanitaires et de reconstruction", avec des travaux de reconstruction "à forte intensité de main-d'oeuvre". L'institution demande aussi la mise en place de bureaux de recrutement d'urgence et de services de formation.
 Trois agences de l'Onu ont demandé mardi la même générosité contre la faim que pour les tsunamis
Trois agences de l'Onu ont demandé mardi la même générosité contre la faim que pour les tsunamis
"Dans un monde où d'abondantes ressources peuvent produire une nourriture suffisante pour nourrir tout le monde, l'extension de la faim est non seulement un outrage moral mais aussi la manifestation d'un échec collectif de la communauté mondiale", soulignent-elles.
La déclaration conjointe.a été faite par la FAO (organisation de l'Onu pour l'alimentation et l'agriculture), le PAM (Programme alimentaire mondial) et le FIDA (Fonds international pour le développement agricole), à l'occasion de la publication d'un rapport de l'ONU sur la réalisation des "Objectifs du Millénaire".
Le premier de ces objectifs est l'engagement de réduire de moitié d'ici 2015 le nombre des personnes souffrant de la faim dans le monde.
Pour Jacques Diouf, directeur général de la FAO, l'élan de solidarité provoqué par la catastrophe asiatique montre la voie.
"La souffrance et la destruction ont fait vibrer une corde dans le coeur de millions de personnes des pays plus riches qui ont témoigné d'une grande générosité et solidarité", a-t-il dit en soulignant que "très vite des centaines de millions de dollars d'aide avaient été promis".
"La grande leçon à en tirer (...) est que la volonté d'aider ceux qui sont défavorisés existe", a-t-il souligné avant d'ajouter: "On ne peut qu'espérer que ce message fort renforcera la volonté politique et l'engagement en faveur d'un investissement à long terme dans la réduction de la pauvreté et le développement durable".
"Plus de 1,2 milliard de personnes vivent toujours dans une extrême pauvreté aujourd'hui" dans le monde, soulignent les trois agences de l'Onu dans leur déclaration commune.
"Plus de 850 millions de personnes dans le monde souffrent d'une manière chronique de la faim, un nombre qui augmente actuellement après une décennie d'amélioration", ajoutent-elles en affirmant que "chaque année, plus de 5 millions d'enfants meurent de causes directement liées à la malnutrition".
Elles estiment néanmoins que les objectifs de développement du millénaire peuvent être réalisés d'ici 2015, "si les pays en développement et le monde développé engagent ensemble une action immédiate".
"Nous croyons que nous n'avons pas le choix (...) Le coût de l'inaction en termes de vies ruinées, de croissance économique perdue et de ressources naturelles gâchées irrémédiablement, est tout simplement trop élevé", concluent-elles.
 Trois semaines après le tsunami, les destinations asiatiques touchées ont été rouvertes au tourisme français
Trois semaines après le tsunami, les destinations asiatiques touchées ont été rouvertes au tourisme français
Les départs de touristes de France vers la région sinistrée - les Maldives, le Sri Lanka, Phuket en Thaïlande et l'Inde du sud - avaient été suspendus par les voyagistes jusqu'au 16 janvier.
Se rendre dans ces régions, c'est aussi permettre aux populations locales de retravailler et donc de les aider, soulignent les professionnels du tourisme.
Il est de plus en plus difficile de trouver des informations en relation directe avec le séisme du 26/12 ou des informations concernant ce qui se passe actuellement concrètement dans les pays touchés.
L’Humanité
Ouverture hier, de la conférence de Kobé sur la prévention des catastrophes naturelles. Un système d'alerte global aux tsunamis sera étudié par plusieurs milliers d'experts, à l'occasion du dixième anniversaire du terrible séisme qui avait détruit ce port japonais en 1995 et provoqué la mort de 6 433 personnes
Entretien avec un physicien et tectonicien à l’Institut de physique du globe de Paris.
libération
Les sismologues multiplient les rapports alarmants sur le Japon.
RFI
Au nord de l’île de Sumatra, l’approvisionnement des populations rescapées du tremblement de terre et du tsunami du 26 décembre reste difficile. Loin des aéroports et de ce qu’il reste des centres urbains de la province d’Aceh, une équipe de l’organisation humanitaire Action contre la faim tente de ravitailler par bateau, trois villages de la côte ouest de l’île au sud de Banda Aceh.
En Indonésie, pays le plus touché par la catastrophe du 26 décembre, environ 600.000 personnes ont perdu leurs moyens de subsistance, principalement dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture et dans l'économie informelle.
Le taux de chômage dans les régions affectées pourrait augmenter de 30%.
Au Sri Lanka, plus de 400.000 personnes ont perdu leur emploi dans les mêmes secteurs qu'en Indonésie, auxquels il faut ajouter le tourisme. Le taux de chômage dans les provinces touchées dépasse probablement 20% contre 9,2% avant les raz de marée, selon le BIT.
Pour l'ensemble du pays, le nombre de chômeurs pourrait avoir temporairement augmenté de 55%.
Dans ces deux pays, l'organisation estime qu'entre 50% et 60% des personnes touchées par le tsunami auront retrouvé un moyen de subsistance d'ici à la fin de l'année grâce aux efforts de reconstruction. "Environ 85% des emplois pourraient être rétablis avant deux ans", selon le communiqué.
Face à la catastrophe, le BIT demande que "les créations d'emploi soient partie intégrante des efforts humanitaires et de reconstruction", avec des travaux de reconstruction "à forte intensité de main-d'oeuvre". L'institution demande aussi la mise en place de bureaux de recrutement d'urgence et de services de formation.
"Dans un monde où d'abondantes ressources peuvent produire une nourriture suffisante pour nourrir tout le monde, l'extension de la faim est non seulement un outrage moral mais aussi la manifestation d'un échec collectif de la communauté mondiale", soulignent-elles.
La déclaration conjointe.a été faite par la FAO (organisation de l'Onu pour l'alimentation et l'agriculture), le PAM (Programme alimentaire mondial) et le FIDA (Fonds international pour le développement agricole), à l'occasion de la publication d'un rapport de l'ONU sur la réalisation des "Objectifs du Millénaire".
Le premier de ces objectifs est l'engagement de réduire de moitié d'ici 2015 le nombre des personnes souffrant de la faim dans le monde.
Pour Jacques Diouf, directeur général de la FAO, l'élan de solidarité provoqué par la catastrophe asiatique montre la voie.
"La souffrance et la destruction ont fait vibrer une corde dans le coeur de millions de personnes des pays plus riches qui ont témoigné d'une grande générosité et solidarité", a-t-il dit en soulignant que "très vite des centaines de millions de dollars d'aide avaient été promis".
"La grande leçon à en tirer (...) est que la volonté d'aider ceux qui sont défavorisés existe", a-t-il souligné avant d'ajouter: "On ne peut qu'espérer que ce message fort renforcera la volonté politique et l'engagement en faveur d'un investissement à long terme dans la réduction de la pauvreté et le développement durable".
"Plus de 1,2 milliard de personnes vivent toujours dans une extrême pauvreté aujourd'hui" dans le monde, soulignent les trois agences de l'Onu dans leur déclaration commune.
"Plus de 850 millions de personnes dans le monde souffrent d'une manière chronique de la faim, un nombre qui augmente actuellement après une décennie d'amélioration", ajoutent-elles en affirmant que "chaque année, plus de 5 millions d'enfants meurent de causes directement liées à la malnutrition".
Elles estiment néanmoins que les objectifs de développement du millénaire peuvent être réalisés d'ici 2015, "si les pays en développement et le monde développé engagent ensemble une action immédiate".
"Nous croyons que nous n'avons pas le choix (...) Le coût de l'inaction en termes de vies ruinées, de croissance économique perdue et de ressources naturelles gâchées irrémédiablement, est tout simplement trop élevé", concluent-elles.
Les départs de touristes de France vers la région sinistrée - les Maldives, le Sri Lanka, Phuket en Thaïlande et l'Inde du sud - avaient été suspendus par les voyagistes jusqu'au 16 janvier.
Se rendre dans ces régions, c'est aussi permettre aux populations locales de retravailler et donc de les aider, soulignent les professionnels du tourisme.
La pensée vole, et les mots vont à pieds.
jeudi 20 janvier
Au total, le raz de marée a fait dans les pays riverains de l'océan Indien près de 220 000 victimes, dont les trois quarts sont indonésiennes et majoritairement originaires d'Aceh. On ne saura sans doute jamais l'étendue exacte des pertes humaines dans cet archipel
Le Nouvel Obs
Les promesses de dons tenues, se félicite l'ONU
86% des 977 millions de dollars réclamés le 6 janvier par le secrétaire général des Nations unies pour répondre aux besoins des zones sinistrées dans les six prochains mois, ont été "couverts". 60% de cette somme ont déjà été transférés, a-t-il précisé.
Pas de seconde vague de maladies
"C'est la première fois que personne n'a eu faim et que personne n'a manqué de soins médicaux faute de ressources", s'est réjoui Jan Egeland.
"Il n'y a pas eu la seconde vague de maladies et de destruction que nous craignions", a-t-il dit.
"J'aimerais pouvoir en dire autant du Soudan, du Congo, de la Côte d'Ivoire et de bien d'autres situations d'urgence où les gens souffrent tout autant que sur les plages de l'océan Indien", a-t-il toutefois nuancé.
Le plus gros contributeur en faveur des rescapés des tsumanis asiatiques est le Japon.
Le séisme qui a déclenché le tsunami pourrait avoir réactivé une ligne de faille en mer, entre la Thaïlande et la Birmanie
 L'île de Phuket déplacée de 15 cm
L'île de Phuket déplacée de 15 cm
L'ONG s'inquiète de la mise en place de sites de regroupement par le gouvernement indonésien et redoute que les gens ne puissent les quitter
 Aceh : Médecins du Monde s'inquiète
Aceh : Médecins du Monde s'inquiète
Libération
 Tsunami et faux amis
Tsunami et faux amis
Le Monde
 Un système d'alerte aux raz de marée devra être créé, d'ici un an, dans l'océan Indien
Un système d'alerte aux raz de marée devra être créé, d'ici un an, dans l'océan Indien
Au total, le raz de marée a fait dans les pays riverains de l'océan Indien près de 220 000 victimes, dont les trois quarts sont indonésiennes et majoritairement originaires d'Aceh. On ne saura sans doute jamais l'étendue exacte des pertes humaines dans cet archipel
Le Nouvel Obs
Les promesses de dons tenues, se félicite l'ONU
86% des 977 millions de dollars réclamés le 6 janvier par le secrétaire général des Nations unies pour répondre aux besoins des zones sinistrées dans les six prochains mois, ont été "couverts". 60% de cette somme ont déjà été transférés, a-t-il précisé.
Pas de seconde vague de maladies
"C'est la première fois que personne n'a eu faim et que personne n'a manqué de soins médicaux faute de ressources", s'est réjoui Jan Egeland.
"Il n'y a pas eu la seconde vague de maladies et de destruction que nous craignions", a-t-il dit.
"J'aimerais pouvoir en dire autant du Soudan, du Congo, de la Côte d'Ivoire et de bien d'autres situations d'urgence où les gens souffrent tout autant que sur les plages de l'océan Indien", a-t-il toutefois nuancé.
Le plus gros contributeur en faveur des rescapés des tsumanis asiatiques est le Japon.
Le séisme qui a déclenché le tsunami pourrait avoir réactivé une ligne de faille en mer, entre la Thaïlande et la Birmanie
L'ONG s'inquiète de la mise en place de sites de regroupement par le gouvernement indonésien et redoute que les gens ne puissent les quitter
Libération
Le Monde
La pensée vole, et les mots vont à pieds.
Dimanche 23 janvier : 28 jours ou 4 semaines ?
Alors que selon un nouveau bilan, le tsunami a fait plus de 227.000 morts dont au moins 173.981 morts en Indonésie, le Programme alimentaire mondial affirme que 200.000 survivants ne sont toujours pas nourri de façon adéquate dans la province d'Aceh
Le Monde
Les divergences entre Etats freinent la création d'un système d'alerte mondial aux désastres naturels.
 La conférence de Kobé s'achève dans la dissension
La conférence de Kobé s'achève dans la dissension
Les militaires s'imposent pour diriger les opérations dans cette région qu'ils tiennent pour leur chasse gardée. Ils annoncent avoir tué 120 rebelles lors des deux dernières semaines
 Malgré l'ampleur des secours internationaux, l'armée indonésienne contrôle strictement Atjeh
Malgré l'ampleur des secours internationaux, l'armée indonésienne contrôle strictement Atjeh
Le Nouvel Obs
Le Sri Lanka a annoncé un plan de réhabilitation de l'industrie du tourisme et le lancement d'une campagne de promotion.
 Colombo veut séduire les touristes
Colombo veut séduire les touristes
Ouest-France
L'aide en Asie dépasse largement celle pour les autres causes humanitaires.
L'immense élan de générosité après le raz-de-marée en Asie ne doit pas faire oublier les autres drames qui déchirent la planète. Sida, famine, pauvreté, guerre : des millions d'humains souffrent en silence. Une nouvelle solidarité planétaire est peut-être en train de naître, mais il ne faudrait pas qu'elle oublie les causes délaissées.
 Une catastrophe peut en cacher d'autres
Une catastrophe peut en cacher d'autres
Libération
Selon les experts présents à Kobe, les dévastations causées dans les mégalopoles par une catastrophe naturelle pourraient être bien plus grandes que celles du tsunami en Asie du Sud, en raison de la densité très élevée de la population. Les cinq plus grandes mégalopoles sont le grand Tokyo (35,3 millions d'habitants), Mexico (19 millions), New York-Newark (18,5 millions), Bombay (18,3 millions) et São Paulo (18,3 millions).
Se préparer, par Patrick Sabatier (samedi 22 janvier 2005)
Nul ne pourra jamais empêcher la Terre en furie, sous l'aspect de tsunami, séisme, ouragan, éruption volcanique, inondation ou avalanche, de balayer comme fétus de paille les hommes qui s'agitent à sa surface. On peut donc juger aussi utopique que vaine l'ambition affichée à Kobe par les Nations unies de prévenir, et réduire, les ravages infligés à l'humanité par les catastrophes naturelles. Il faut pourtant se préparer au pire.
Certes, le spectacle donné par les milliers d'experts et diplomates rassemblés dans la cité japonaise n'a pas été très édifiant. Alors qu'on s'emploie encore à porter secours aux victimes du tsunami de l'océan Indien, tout ce beau monde, unanime pour vouloir faire quelque chose, et d'urgence, a conclu, au terme d'une longue palabre, qu'il était urgent de se donner encore un peu de temps pour organiser une autre palabre, et décider à quel pays reviendra le prestige de doter l'Asie du Sud d'un système d'alerte aux tsunamis.
Seule la coopération internationale, dont l'ONU est l'unique incarnation légitime, peut prétendre oeuvrer à prévenir et réduire autant que possible des fléaux par nature indifférents aux frontières. Mais l'ONU est handicapée par le manque de volonté politique des Etats qui la composent, et trop souvent paralysée par l'affrontement d'ambitions nationales, sans parler de sa propre bureaucratie. L'urgence suscite de grands élans de solidarité et la mobilisation de grands moyens. Il faut souhaiter qu'elle accélère une prise de conscience. Car on doit se préoccuper des catastrophes naturelles bien avant qu'elles ne frappent si on veut en amortir les chocs. Et ce d'autant plus que la croissance démographique et l'urbanisation galopante de la planète entraîneront une multiplication exponentielle des victimes lorsque d'autres catastrophes naturelles, inévitables, ravageront des mégalopoles. Le pire n'est jamais sûr, à condition de s'y préparer.
L'ONU n'a pas les moyens de contrôler l'origine des sommes versées après les tsunamis
 Asie: des dons garantis, pas leur transparence
Asie: des dons garantis, pas leur transparence
L'ONU n'a reçu que 17,7 millions de dollars sur les 115 promis.
 Un an après, les survivants de Bam campent dans des préfabriqués
Un an après, les survivants de Bam campent dans des préfabriqués
RFI
Indonésie : La vie reprend mais l’odeur de mort demeure
Premières reconstructions
Le processus de reconstruction prendra des mois, peut-être des années, dans la province d’Aceh au nord de l’Indonésie. Les premières étapes ont déjà commencé. Il s’agit tout d’abord de trouver des solutions d’urgence pour loger les centaines de milliers de rescapés qui ont tout perdu
La recherche des cadavres continue
Dans les monceaux de gravats créés par le tsunami gisent encore les corps de nombreuses victimes de la catastrophe. Un mois après le tsunami, le ramassage des corps continue à Banda Aceh
Les sectes sont à l’affût
La catastrophe engendrée par le tsunami dans la province d’Aceh n’a pas engendré qu’un élan de générosité à l’échelle de la planète. Les organisations humanitaires ne sont pas les seules à s’être précipitées sur place. De nombreuses organisations religieuses, mais aussi des sectes, multiplient les actions sur place à la recherche de nouveaux adeptes. C’est le cas de l’Eglise de scientologie
L’Humanité
Le marché de la mort
On était bien un peu choqué de voir les touristes faire à nouveau bronzette sur les plages où le tsunami venait de semer mort et désolation. D’autant que, parfois, ils se félicitaient d’avoir la grande bleue pour eux seuls... Mais ne nous expliquait-on pas que la meilleure façon d’aider les survivants était de relancer ce tout-tourisme, devenue, au fil du temps, à la fois l’unique activité nourricière et le cache-sexe d’un capitalisme mondialisé prédateur de matières premières au détriment de l’activité industrielle ou transformatrice locale. Avouons-le : le choc a fait place à du dégoût quand on a appris qu’un commerce de souvenirs de la vague meurtrière, d’un goût plus que douteux, a vu le jour, en particulier dans l’île thaïlandaise de Phuket. Tee-shirts, photos macabres de corps gorgés d’eau. Bref, les affaires reprennent. En l’occurrence dès le soir même du drame, le 26 décembre. La plus grande boutique de photographies de la ville de Phuket vend des tirages, à 50 dollars l’unité, d’une trentaine de scènes de destruction, à l’instar de celle où l’on voit des dizaines de corps noircis dans les décombres d’un bâtiment. D’autres montrent le travail macabre des sauveteurs. L’une cadre l’un de ceux-ci tirant sur une corde à laquelle ont été attachés plusieurs cadavres. Des CD vidéo sont en vente à 3 dollars pièce. Des posters à 2,50 dollars. Sans compter le must : les tatouages. Multicolores, ils coûtent 100 dollars. Le plus grave n’étant pas ceux qui les font ou qui les vendent, il faut bien vivre. Mais ceux qui les achètent. Quand il y a une demande, pourquoi refuser l’offre ?...
D. B
D’autre part des tour opérators asiatiques (Indonésie du Nord, semble-t’il) ont mis en place des visites guidées de l’Indonésie du Sud où le touriste moyennant 60 à 70 dollars peut à travers les vitres de son autocar climatisé, visiter les décombres et regarder ses concitoyens dans la détresse en se disant qu’il contribue à l’effort d’aide et de reconstruction.
Alors que selon un nouveau bilan, le tsunami a fait plus de 227.000 morts dont au moins 173.981 morts en Indonésie, le Programme alimentaire mondial affirme que 200.000 survivants ne sont toujours pas nourri de façon adéquate dans la province d'Aceh
Le Monde
Les divergences entre Etats freinent la création d'un système d'alerte mondial aux désastres naturels.
Les militaires s'imposent pour diriger les opérations dans cette région qu'ils tiennent pour leur chasse gardée. Ils annoncent avoir tué 120 rebelles lors des deux dernières semaines
Le Nouvel Obs
Le Sri Lanka a annoncé un plan de réhabilitation de l'industrie du tourisme et le lancement d'une campagne de promotion.
Ouest-France
L'aide en Asie dépasse largement celle pour les autres causes humanitaires.
L'immense élan de générosité après le raz-de-marée en Asie ne doit pas faire oublier les autres drames qui déchirent la planète. Sida, famine, pauvreté, guerre : des millions d'humains souffrent en silence. Une nouvelle solidarité planétaire est peut-être en train de naître, mais il ne faudrait pas qu'elle oublie les causes délaissées.
Libération
Selon les experts présents à Kobe, les dévastations causées dans les mégalopoles par une catastrophe naturelle pourraient être bien plus grandes que celles du tsunami en Asie du Sud, en raison de la densité très élevée de la population. Les cinq plus grandes mégalopoles sont le grand Tokyo (35,3 millions d'habitants), Mexico (19 millions), New York-Newark (18,5 millions), Bombay (18,3 millions) et São Paulo (18,3 millions).
Se préparer, par Patrick Sabatier (samedi 22 janvier 2005)
Nul ne pourra jamais empêcher la Terre en furie, sous l'aspect de tsunami, séisme, ouragan, éruption volcanique, inondation ou avalanche, de balayer comme fétus de paille les hommes qui s'agitent à sa surface. On peut donc juger aussi utopique que vaine l'ambition affichée à Kobe par les Nations unies de prévenir, et réduire, les ravages infligés à l'humanité par les catastrophes naturelles. Il faut pourtant se préparer au pire.
Certes, le spectacle donné par les milliers d'experts et diplomates rassemblés dans la cité japonaise n'a pas été très édifiant. Alors qu'on s'emploie encore à porter secours aux victimes du tsunami de l'océan Indien, tout ce beau monde, unanime pour vouloir faire quelque chose, et d'urgence, a conclu, au terme d'une longue palabre, qu'il était urgent de se donner encore un peu de temps pour organiser une autre palabre, et décider à quel pays reviendra le prestige de doter l'Asie du Sud d'un système d'alerte aux tsunamis.
Seule la coopération internationale, dont l'ONU est l'unique incarnation légitime, peut prétendre oeuvrer à prévenir et réduire autant que possible des fléaux par nature indifférents aux frontières. Mais l'ONU est handicapée par le manque de volonté politique des Etats qui la composent, et trop souvent paralysée par l'affrontement d'ambitions nationales, sans parler de sa propre bureaucratie. L'urgence suscite de grands élans de solidarité et la mobilisation de grands moyens. Il faut souhaiter qu'elle accélère une prise de conscience. Car on doit se préoccuper des catastrophes naturelles bien avant qu'elles ne frappent si on veut en amortir les chocs. Et ce d'autant plus que la croissance démographique et l'urbanisation galopante de la planète entraîneront une multiplication exponentielle des victimes lorsque d'autres catastrophes naturelles, inévitables, ravageront des mégalopoles. Le pire n'est jamais sûr, à condition de s'y préparer.
L'ONU n'a pas les moyens de contrôler l'origine des sommes versées après les tsunamis
L'ONU n'a reçu que 17,7 millions de dollars sur les 115 promis.
RFI
Indonésie : La vie reprend mais l’odeur de mort demeure
Premières reconstructions
Le processus de reconstruction prendra des mois, peut-être des années, dans la province d’Aceh au nord de l’Indonésie. Les premières étapes ont déjà commencé. Il s’agit tout d’abord de trouver des solutions d’urgence pour loger les centaines de milliers de rescapés qui ont tout perdu
La recherche des cadavres continue
Dans les monceaux de gravats créés par le tsunami gisent encore les corps de nombreuses victimes de la catastrophe. Un mois après le tsunami, le ramassage des corps continue à Banda Aceh
Les sectes sont à l’affût
La catastrophe engendrée par le tsunami dans la province d’Aceh n’a pas engendré qu’un élan de générosité à l’échelle de la planète. Les organisations humanitaires ne sont pas les seules à s’être précipitées sur place. De nombreuses organisations religieuses, mais aussi des sectes, multiplient les actions sur place à la recherche de nouveaux adeptes. C’est le cas de l’Eglise de scientologie
L’Humanité
Le marché de la mort
On était bien un peu choqué de voir les touristes faire à nouveau bronzette sur les plages où le tsunami venait de semer mort et désolation. D’autant que, parfois, ils se félicitaient d’avoir la grande bleue pour eux seuls... Mais ne nous expliquait-on pas que la meilleure façon d’aider les survivants était de relancer ce tout-tourisme, devenue, au fil du temps, à la fois l’unique activité nourricière et le cache-sexe d’un capitalisme mondialisé prédateur de matières premières au détriment de l’activité industrielle ou transformatrice locale. Avouons-le : le choc a fait place à du dégoût quand on a appris qu’un commerce de souvenirs de la vague meurtrière, d’un goût plus que douteux, a vu le jour, en particulier dans l’île thaïlandaise de Phuket. Tee-shirts, photos macabres de corps gorgés d’eau. Bref, les affaires reprennent. En l’occurrence dès le soir même du drame, le 26 décembre. La plus grande boutique de photographies de la ville de Phuket vend des tirages, à 50 dollars l’unité, d’une trentaine de scènes de destruction, à l’instar de celle où l’on voit des dizaines de corps noircis dans les décombres d’un bâtiment. D’autres montrent le travail macabre des sauveteurs. L’une cadre l’un de ceux-ci tirant sur une corde à laquelle ont été attachés plusieurs cadavres. Des CD vidéo sont en vente à 3 dollars pièce. Des posters à 2,50 dollars. Sans compter le must : les tatouages. Multicolores, ils coûtent 100 dollars. Le plus grave n’étant pas ceux qui les font ou qui les vendent, il faut bien vivre. Mais ceux qui les achètent. Quand il y a une demande, pourquoi refuser l’offre ?...
D. B
D’autre part des tour opérators asiatiques (Indonésie du Nord, semble-t’il) ont mis en place des visites guidées de l’Indonésie du Sud où le touriste moyennant 60 à 70 dollars peut à travers les vitres de son autocar climatisé, visiter les décombres et regarder ses concitoyens dans la détresse en se disant qu’il contribue à l’effort d’aide et de reconstruction.
La pensée vole, et les mots vont à pieds.
Simoco a écrit :entendu au JT ce midi : "nouveau tremblement de terre en Indonésie de magnitude 6....."
Ils devraient attendre un peu avant de reconstruire...
Des tremblements de terre ou des séïsmes en mer, il y en a tous les jours depuis le 26 décembre, ce sont les répliques attendues.
Quand à attendre, n'oublie pas que c'est la saison des pluie, que des milliers de gens sont sans abris, sans travail, sans ressource... et que d'autre part les conférences qui se tiennent depuis n'ont accouché que de résolutions visant à programmer d'autres colloques ou réunions internationales...qu'aucun objectif précis n'a été défini !
La pensée vole, et les mots vont à pieds.